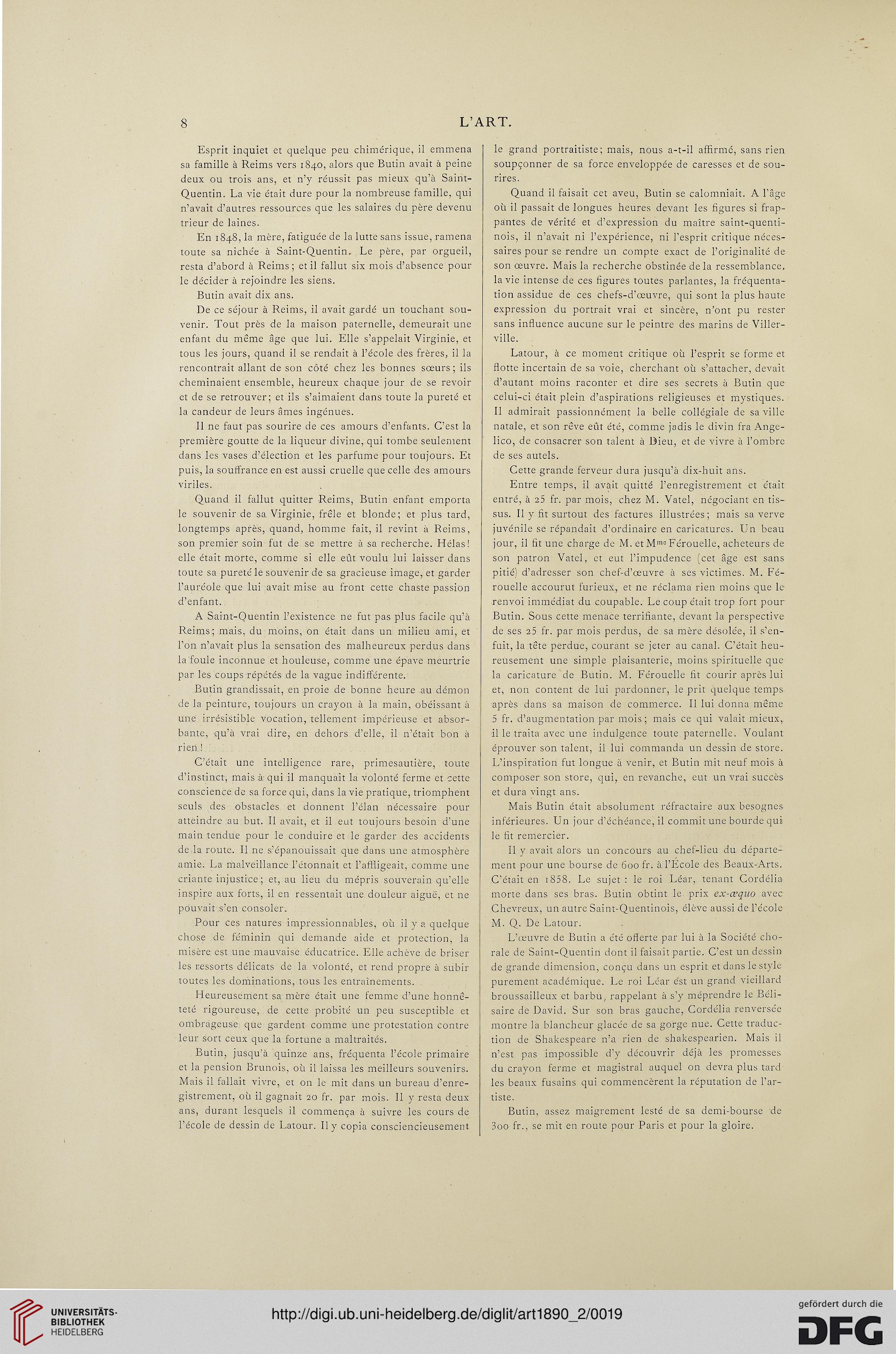L’ART.
Esprit inquiet et quelque peu chimérique, il emmena
sa famille à Reims vers 1840, alors que Butin avait à peine
deux ou trois ans, et n’y réussit pas mieux qu’à Saint-
Quentin. La vie était dure pour la nombreuse famille, qui
n’avait d’autres ressources que les salaires du père devenu
trieur de laines.
En 1848, la mère, fatiguée de la lutte sans issue, ramena
toute sa nichée à Saint-Quentin. Le père, par orgueil,
resta d’abord à Reims; et il fallut six mois d’absence pour
le décider à rejoindre les siens.
Butin avait dix ans.
De ce séjour à Reims, il avait gardé un touchant sou-
venir. Tout près de la maison paternelle, demeurait une
enfant du même âge que lui. Elle s’appelait Virginie, et
tous les jours, quand il se rendait à l’école des frères, il la
rencontrait allant de son côté chez les bonnes sœurs; ils
cheminaient ensemble, heureux chaque jour de se revoir
et de se retrouver; et ils s’aimaient dans toute la pureté et
la candeur de leurs âmes ingénues.
Il ne faut pas sourire de ces amours d’enfants. C’est la
première goutte de la liqueur divine, qui tombe seulement
dans les vases d’élection et les parfume pour toujours. Et
puis, la souffrance en est aussi cruelle que celle des amours
viriles.
Quand il fallut quitter Reims, Butin enfant emporta
le souvenir de sa Virginie, frêle et blonde; et plus tard,
longtemps après, quand, homme fait, il revint à Reims,
son premier soin fut de se mettre à sa recherche. Hélas!
elle était morte, comme si elle eût voulu lui laisser dans
toute sa pureté le souvenir de sa gracieuse image, et garder
l’auréole que lui avait mise au front cette chaste passion
d’enfant.
A Saint-Quentin l’existence ne fut pas plus facile qu’à
Reims; mais, du moins, on était dans un milieu ami, et
l’on n’avait plus la sensation des malheureux perdus dans
la foule inconnue et houleuse, comme une épave meurtrie
par les coups répétés de la vague indifférente.
Butin grandissait, en proie de bonne heure au démon
de la peinture, toujours un crayon à la main, obéissant à
une irrésistible vocation, tellement impérieuse et absor-
bante, qu’à vrai dire, en dehors d’elle, il n’était bon à
rien !
C’était une intelligence rare, primesautière, toute
d’instinct, mais à qui il manquait la volonté ferme et cette
conscience de sa force qui, dans la vie pratique, triomphent
seuls des obstacles et donnent l’élan nécessaire pour
atteindre au but. Il avait, et il eut toujours besoin d’une
main tendue pour le conduire et le garder des accidents
de la route. Il ne s’épanouissait que dans une atmosphère
amie. La malveillance l’étonnait et l’affligeait, comme une
criante injustice; et, au lieu du mépris souverain qu’elle
inspire aux forts, il en ressentait une douleur aiguë, et ne
pouvait s’en consoler.
Pour ces natures impressionnables, où il y a quelque
chose de féminin qui demande aide et protection, la
misère est une mauvaise éducatrice. Elle achève de briser
les ressorts délicats de la volonté, et rend propre à subir
toutes les dominations, tous les entraînements.
Heureusement sa mère était une femme d’une honnê-
teté rigoureuse, de cette probité un peu susceptible et
ombrageuse que gardent comme une protestation contre
leur sort ceux que la fortune a maltraités.
Butin, jusqu’à quinze ans, fréquenta l’école primaire
et la pension Brunois, où il laissa les meilleurs souvenirs.
Mais il fallait vivre, et on le mit dans un bureau d’enre-
gistrement, où il gagnait 20 fr. par mois. Il y resta deux
ans, durant lesquels il commença à suivre les cours de
l’école de dessin de Latour. Il y copia consciencieusement
le grand portraitiste; mais, nous a-t-il affirmé, sans rien
soupçonner de sa force enveloppée de caresses et de sou-
rires.
Quand il faisait cet aveu, Butin se calomniait. A l’âge
où il passait de longues heures devant les figures si frap-
pantes de vérité et d’expression du maître saint-quenti-
nois, il n’avait ni l’expérience, ni l’esprit critique néces-
saires pour se rendre un compte exact de l’originalité de
son œuvre. Mais la recherche obstinée de la ressemblance,
la vie intense de ces figures toutes parlantes, la fréquenta-
tion assidue de ces chefs-d’œuvre, qui sont la plus haute
expression du portrait vrai et sincère, n’ont pu rester
sans influence aucune sur le peintre des marins de Viller-
ville.
Latour, à ce moment critique où l’esprit se forme et
flotte incertain de sa voie, cherchant où s’attacher, devait
d’autant moins raconter et dire ses secrets à Butin que
celui-ci était plein d’aspirations religieuses et mystiques.
Il admirait passionnément la belle collégiale de sa ville
natale, et son rêve eût été, comme jadis le divin fra Ange-
lico, de consacrer son talent à Dieu, et de vivre à l’ombre
de ses autels.
Cette grande ferveur dura jusqu’à dix-huit ans.
Entre temps, il avait quitté l’enregistrement et était
entré, à 25 fr. par mois, chez M. Vatel, négociant en tis-
sus. Il y fit surtout des factures illustrées; mais sa verve
juvénile se répandait d’ordinaire en caricatures. Un beau
jour, il fit une charge de M. et Mme Férouelle, acheteurs de
son patron Vatel, et eut l’impudence (cet âge est sans
pitié) d’adresser son chef-d’œuvre à ses victimes. M. Fé-
rouelle accourut furieux, et ne réclama rien moins que le
renvoi immédiat du coupable. Le coup était trop fort pour
Butin. Sous cette menace terrifiante, devant la perspective
de ses 25 fr. par mois perdus, de sa mère désolée, il s’en-
fuit, la tête perdue, courant se jeter au canal. C’était heu-
reusement une simple plaisanterie, moins spirituelle que-
la caricature de Butin. M. Férouelle fit courir après lui
et, non content de lui pardonner, le prit quelque temps-
après dans sa maison de commerce. Il lui donna même
5 fr. d’augmentation par mois; mais ce qui valait mieux,,
il le traita avec une indulgence toute paternelle. Voulant
éprouver son talent, il lui commanda un dessin de store.
L’inspiration fut longue à venir, et Butin mit neuf mois à
composer son store, qui, en revanche, eut un vrai succès
et dura vingt ans.
Mais Butin était absolument réfractaire aux besognes
inférieures. Un jour d’échéance, il commit une bourde qui
le fit remercier.
Il y avait alors un concours au chef-lieu du départe-
ment pour une bourse de 600 fr. à l’Ecole des Beaux-Arts.
C’était en i858. Le sujet : le roi Léar, tenant Cordélia
morte dans ses bras. Butin obtint le prix ex-œquo avec
Chevreux, un autre Saint-Quentinois, élève aussi de l’école
M. Q. De Latour.
L’œuvre de Butin a été offerte par lui à la Société cho-
rale de Saint-Quentin dont il faisait partie. C’est un dessin
de grande dimension, conçu dans un esprit et dans le style
purement académique. Le roi Léar est un grand vieillard
broussailleux et barbu, rappelant à s’y méprendre le Béli-
saire de David, Sur son bras gauche, Cordélia renversée
montre la blancheur glacée de sa gorge nue. Cette traduc-
tion de Shakespeare n’a rien de shakespearien. Mais il
n’est pas impossible d’y découvrir déjà les promesses
du crayon ferme et magistral auquel on devra plus tard
les beaux fusains qui commencèrent la réputation de l’ar-
tiste.
Butin, assez maigrement lesté de sa demi-bourse de
3oo fr., se mit en route pour Paris et pour la gloire.
Esprit inquiet et quelque peu chimérique, il emmena
sa famille à Reims vers 1840, alors que Butin avait à peine
deux ou trois ans, et n’y réussit pas mieux qu’à Saint-
Quentin. La vie était dure pour la nombreuse famille, qui
n’avait d’autres ressources que les salaires du père devenu
trieur de laines.
En 1848, la mère, fatiguée de la lutte sans issue, ramena
toute sa nichée à Saint-Quentin. Le père, par orgueil,
resta d’abord à Reims; et il fallut six mois d’absence pour
le décider à rejoindre les siens.
Butin avait dix ans.
De ce séjour à Reims, il avait gardé un touchant sou-
venir. Tout près de la maison paternelle, demeurait une
enfant du même âge que lui. Elle s’appelait Virginie, et
tous les jours, quand il se rendait à l’école des frères, il la
rencontrait allant de son côté chez les bonnes sœurs; ils
cheminaient ensemble, heureux chaque jour de se revoir
et de se retrouver; et ils s’aimaient dans toute la pureté et
la candeur de leurs âmes ingénues.
Il ne faut pas sourire de ces amours d’enfants. C’est la
première goutte de la liqueur divine, qui tombe seulement
dans les vases d’élection et les parfume pour toujours. Et
puis, la souffrance en est aussi cruelle que celle des amours
viriles.
Quand il fallut quitter Reims, Butin enfant emporta
le souvenir de sa Virginie, frêle et blonde; et plus tard,
longtemps après, quand, homme fait, il revint à Reims,
son premier soin fut de se mettre à sa recherche. Hélas!
elle était morte, comme si elle eût voulu lui laisser dans
toute sa pureté le souvenir de sa gracieuse image, et garder
l’auréole que lui avait mise au front cette chaste passion
d’enfant.
A Saint-Quentin l’existence ne fut pas plus facile qu’à
Reims; mais, du moins, on était dans un milieu ami, et
l’on n’avait plus la sensation des malheureux perdus dans
la foule inconnue et houleuse, comme une épave meurtrie
par les coups répétés de la vague indifférente.
Butin grandissait, en proie de bonne heure au démon
de la peinture, toujours un crayon à la main, obéissant à
une irrésistible vocation, tellement impérieuse et absor-
bante, qu’à vrai dire, en dehors d’elle, il n’était bon à
rien !
C’était une intelligence rare, primesautière, toute
d’instinct, mais à qui il manquait la volonté ferme et cette
conscience de sa force qui, dans la vie pratique, triomphent
seuls des obstacles et donnent l’élan nécessaire pour
atteindre au but. Il avait, et il eut toujours besoin d’une
main tendue pour le conduire et le garder des accidents
de la route. Il ne s’épanouissait que dans une atmosphère
amie. La malveillance l’étonnait et l’affligeait, comme une
criante injustice; et, au lieu du mépris souverain qu’elle
inspire aux forts, il en ressentait une douleur aiguë, et ne
pouvait s’en consoler.
Pour ces natures impressionnables, où il y a quelque
chose de féminin qui demande aide et protection, la
misère est une mauvaise éducatrice. Elle achève de briser
les ressorts délicats de la volonté, et rend propre à subir
toutes les dominations, tous les entraînements.
Heureusement sa mère était une femme d’une honnê-
teté rigoureuse, de cette probité un peu susceptible et
ombrageuse que gardent comme une protestation contre
leur sort ceux que la fortune a maltraités.
Butin, jusqu’à quinze ans, fréquenta l’école primaire
et la pension Brunois, où il laissa les meilleurs souvenirs.
Mais il fallait vivre, et on le mit dans un bureau d’enre-
gistrement, où il gagnait 20 fr. par mois. Il y resta deux
ans, durant lesquels il commença à suivre les cours de
l’école de dessin de Latour. Il y copia consciencieusement
le grand portraitiste; mais, nous a-t-il affirmé, sans rien
soupçonner de sa force enveloppée de caresses et de sou-
rires.
Quand il faisait cet aveu, Butin se calomniait. A l’âge
où il passait de longues heures devant les figures si frap-
pantes de vérité et d’expression du maître saint-quenti-
nois, il n’avait ni l’expérience, ni l’esprit critique néces-
saires pour se rendre un compte exact de l’originalité de
son œuvre. Mais la recherche obstinée de la ressemblance,
la vie intense de ces figures toutes parlantes, la fréquenta-
tion assidue de ces chefs-d’œuvre, qui sont la plus haute
expression du portrait vrai et sincère, n’ont pu rester
sans influence aucune sur le peintre des marins de Viller-
ville.
Latour, à ce moment critique où l’esprit se forme et
flotte incertain de sa voie, cherchant où s’attacher, devait
d’autant moins raconter et dire ses secrets à Butin que
celui-ci était plein d’aspirations religieuses et mystiques.
Il admirait passionnément la belle collégiale de sa ville
natale, et son rêve eût été, comme jadis le divin fra Ange-
lico, de consacrer son talent à Dieu, et de vivre à l’ombre
de ses autels.
Cette grande ferveur dura jusqu’à dix-huit ans.
Entre temps, il avait quitté l’enregistrement et était
entré, à 25 fr. par mois, chez M. Vatel, négociant en tis-
sus. Il y fit surtout des factures illustrées; mais sa verve
juvénile se répandait d’ordinaire en caricatures. Un beau
jour, il fit une charge de M. et Mme Férouelle, acheteurs de
son patron Vatel, et eut l’impudence (cet âge est sans
pitié) d’adresser son chef-d’œuvre à ses victimes. M. Fé-
rouelle accourut furieux, et ne réclama rien moins que le
renvoi immédiat du coupable. Le coup était trop fort pour
Butin. Sous cette menace terrifiante, devant la perspective
de ses 25 fr. par mois perdus, de sa mère désolée, il s’en-
fuit, la tête perdue, courant se jeter au canal. C’était heu-
reusement une simple plaisanterie, moins spirituelle que-
la caricature de Butin. M. Férouelle fit courir après lui
et, non content de lui pardonner, le prit quelque temps-
après dans sa maison de commerce. Il lui donna même
5 fr. d’augmentation par mois; mais ce qui valait mieux,,
il le traita avec une indulgence toute paternelle. Voulant
éprouver son talent, il lui commanda un dessin de store.
L’inspiration fut longue à venir, et Butin mit neuf mois à
composer son store, qui, en revanche, eut un vrai succès
et dura vingt ans.
Mais Butin était absolument réfractaire aux besognes
inférieures. Un jour d’échéance, il commit une bourde qui
le fit remercier.
Il y avait alors un concours au chef-lieu du départe-
ment pour une bourse de 600 fr. à l’Ecole des Beaux-Arts.
C’était en i858. Le sujet : le roi Léar, tenant Cordélia
morte dans ses bras. Butin obtint le prix ex-œquo avec
Chevreux, un autre Saint-Quentinois, élève aussi de l’école
M. Q. De Latour.
L’œuvre de Butin a été offerte par lui à la Société cho-
rale de Saint-Quentin dont il faisait partie. C’est un dessin
de grande dimension, conçu dans un esprit et dans le style
purement académique. Le roi Léar est un grand vieillard
broussailleux et barbu, rappelant à s’y méprendre le Béli-
saire de David, Sur son bras gauche, Cordélia renversée
montre la blancheur glacée de sa gorge nue. Cette traduc-
tion de Shakespeare n’a rien de shakespearien. Mais il
n’est pas impossible d’y découvrir déjà les promesses
du crayon ferme et magistral auquel on devra plus tard
les beaux fusains qui commencèrent la réputation de l’ar-
tiste.
Butin, assez maigrement lesté de sa demi-bourse de
3oo fr., se mit en route pour Paris et pour la gloire.