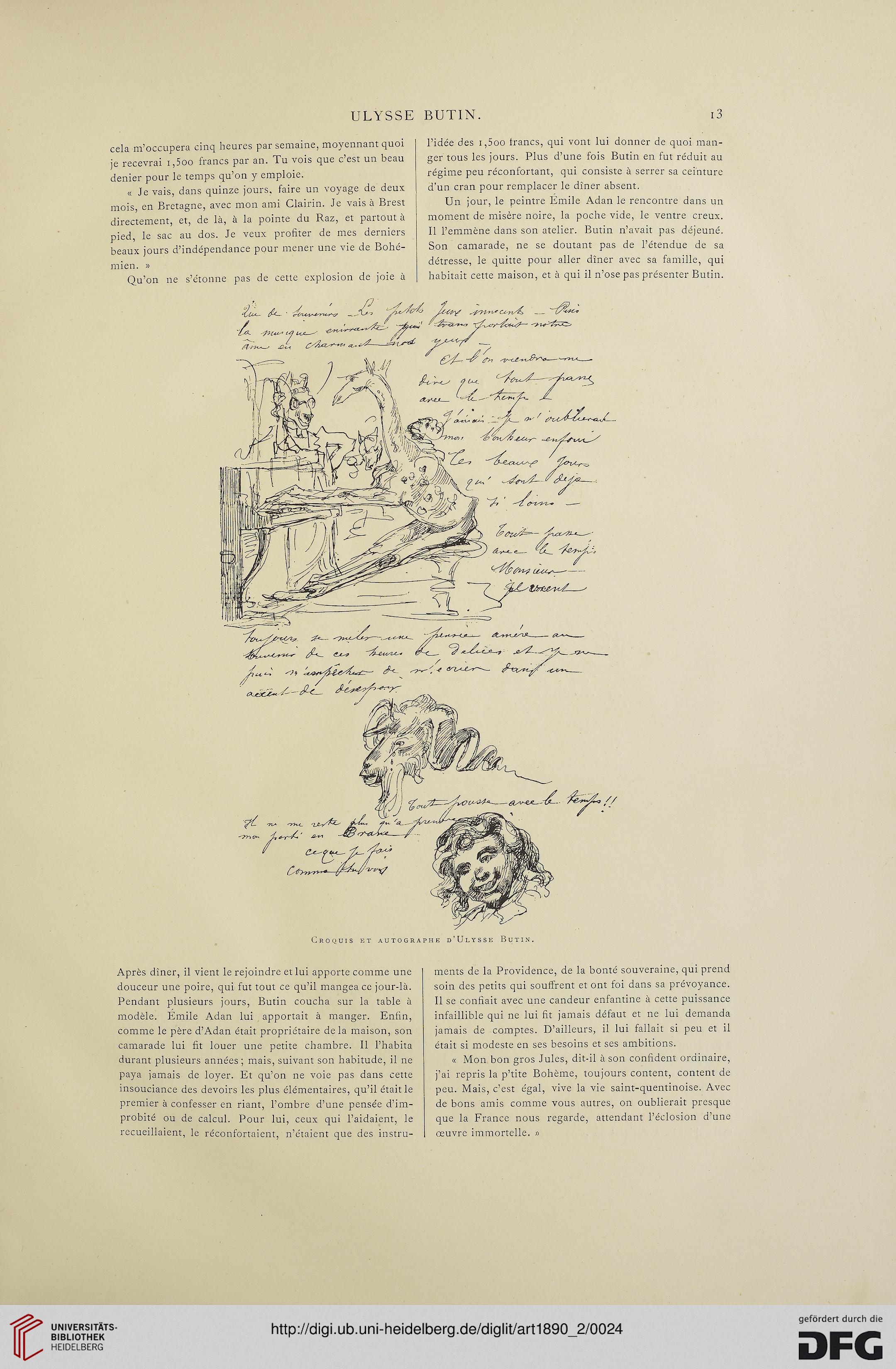ULYSSE BUTIN.
i3
cela m’occupera cinq heures par semaine, moyennant quoi
je recevrai i,5oo francs par an. Tu vois que c’est un beau
denier pour le temps qu’on y emploie.
« Je vais, dans quinze jours, faire un voyage de deux
mois, en Bretagne, avec mon ami Clairin. Je vais à Brest
directement, et, de là, à la pointe du Raz, et partout à
pied, le sac au dos. Je veux profiter de mes derniers
beaux jours d’indépendance pour mener une vie de Bohé-
mien. »
Qu’on ne s’étonne pas de cette explosion de joie à
l’idée des i,5oo Irancs, qui vont lui donner de quoi man-
ger tous les jours. Plus d’une fois Butin en fut réduit au
régime peu réconfortant, qui consiste à serrer sa ceinture
d’un cran pour remplacer le dîner absent.
Un jour, le peintre Emile Adan le rencontre dans un
moment de misère noire, la poche vide, le ventre creux.
Il l’emmène dans son atelier. Butin n’avait pas déjeuné.
Son camarade, ne se doutant pas de l’étendue de sa
détresse, le quitte pour aller dîner avec sa famille, qui
habitait cette maison, et à qui il n’ose pas présenter Butin.
Croquis et autographe d’Ulysse Butin.
Après dîner, il vient le rejoindre et lui apporte comme une
douceur une poire, qui fut tout ce qu’il mangea ce jour-là.
Pendant plusieurs jours, Butin coucha sur la table à
modèle. Emile Adan lui apportait à manger. Enfin,
comme le père d’Adan était propriétaire de la maison, son
camarade lui fit louer une petite chambre. Il l’habita
durant plusieurs années; mais, suivant son habitude, il ne
paya jamais de loyer. Et qu’on ne voie pas dans cette
insouciance des devoirs les plus élémentaires, qu’il était le
premier à confesser en riant, l’ombre d’une pensée d’im-
probité ou de calcul. Pour lui, ceux qui l’aidaient, le
recueillaient, le réconfortaient, n’étaient que des instru-
ments de la Providence, de la bonté souveraine, qui prend
soin des petits qui souffrent et ont foi dans sa prévoyance.
Il se confiait avec une candeur enfantine à cette puissance
infaillible qui ne lui fit jamais défaut et ne lui demanda
jamais de comptes. D’ailleurs, il lui fallait si peu et il
était si modeste en ses besoins et ses ambitions.
« Mon bon gros Jules, dit-il à son confident ordinaire,
j’ai repris la p’tite Bohème, toujours content, content de
peu. Mais, c’est égal, vive la vie saint-quentinoise. Avec
de bons amis comme vous autres, on oublierait presque
que la France nous regarde, attendant l’éclosion d’une
œuvre immortelle. »
i3
cela m’occupera cinq heures par semaine, moyennant quoi
je recevrai i,5oo francs par an. Tu vois que c’est un beau
denier pour le temps qu’on y emploie.
« Je vais, dans quinze jours, faire un voyage de deux
mois, en Bretagne, avec mon ami Clairin. Je vais à Brest
directement, et, de là, à la pointe du Raz, et partout à
pied, le sac au dos. Je veux profiter de mes derniers
beaux jours d’indépendance pour mener une vie de Bohé-
mien. »
Qu’on ne s’étonne pas de cette explosion de joie à
l’idée des i,5oo Irancs, qui vont lui donner de quoi man-
ger tous les jours. Plus d’une fois Butin en fut réduit au
régime peu réconfortant, qui consiste à serrer sa ceinture
d’un cran pour remplacer le dîner absent.
Un jour, le peintre Emile Adan le rencontre dans un
moment de misère noire, la poche vide, le ventre creux.
Il l’emmène dans son atelier. Butin n’avait pas déjeuné.
Son camarade, ne se doutant pas de l’étendue de sa
détresse, le quitte pour aller dîner avec sa famille, qui
habitait cette maison, et à qui il n’ose pas présenter Butin.
Croquis et autographe d’Ulysse Butin.
Après dîner, il vient le rejoindre et lui apporte comme une
douceur une poire, qui fut tout ce qu’il mangea ce jour-là.
Pendant plusieurs jours, Butin coucha sur la table à
modèle. Emile Adan lui apportait à manger. Enfin,
comme le père d’Adan était propriétaire de la maison, son
camarade lui fit louer une petite chambre. Il l’habita
durant plusieurs années; mais, suivant son habitude, il ne
paya jamais de loyer. Et qu’on ne voie pas dans cette
insouciance des devoirs les plus élémentaires, qu’il était le
premier à confesser en riant, l’ombre d’une pensée d’im-
probité ou de calcul. Pour lui, ceux qui l’aidaient, le
recueillaient, le réconfortaient, n’étaient que des instru-
ments de la Providence, de la bonté souveraine, qui prend
soin des petits qui souffrent et ont foi dans sa prévoyance.
Il se confiait avec une candeur enfantine à cette puissance
infaillible qui ne lui fit jamais défaut et ne lui demanda
jamais de comptes. D’ailleurs, il lui fallait si peu et il
était si modeste en ses besoins et ses ambitions.
« Mon bon gros Jules, dit-il à son confident ordinaire,
j’ai repris la p’tite Bohème, toujours content, content de
peu. Mais, c’est égal, vive la vie saint-quentinoise. Avec
de bons amis comme vous autres, on oublierait presque
que la France nous regarde, attendant l’éclosion d’une
œuvre immortelle. »