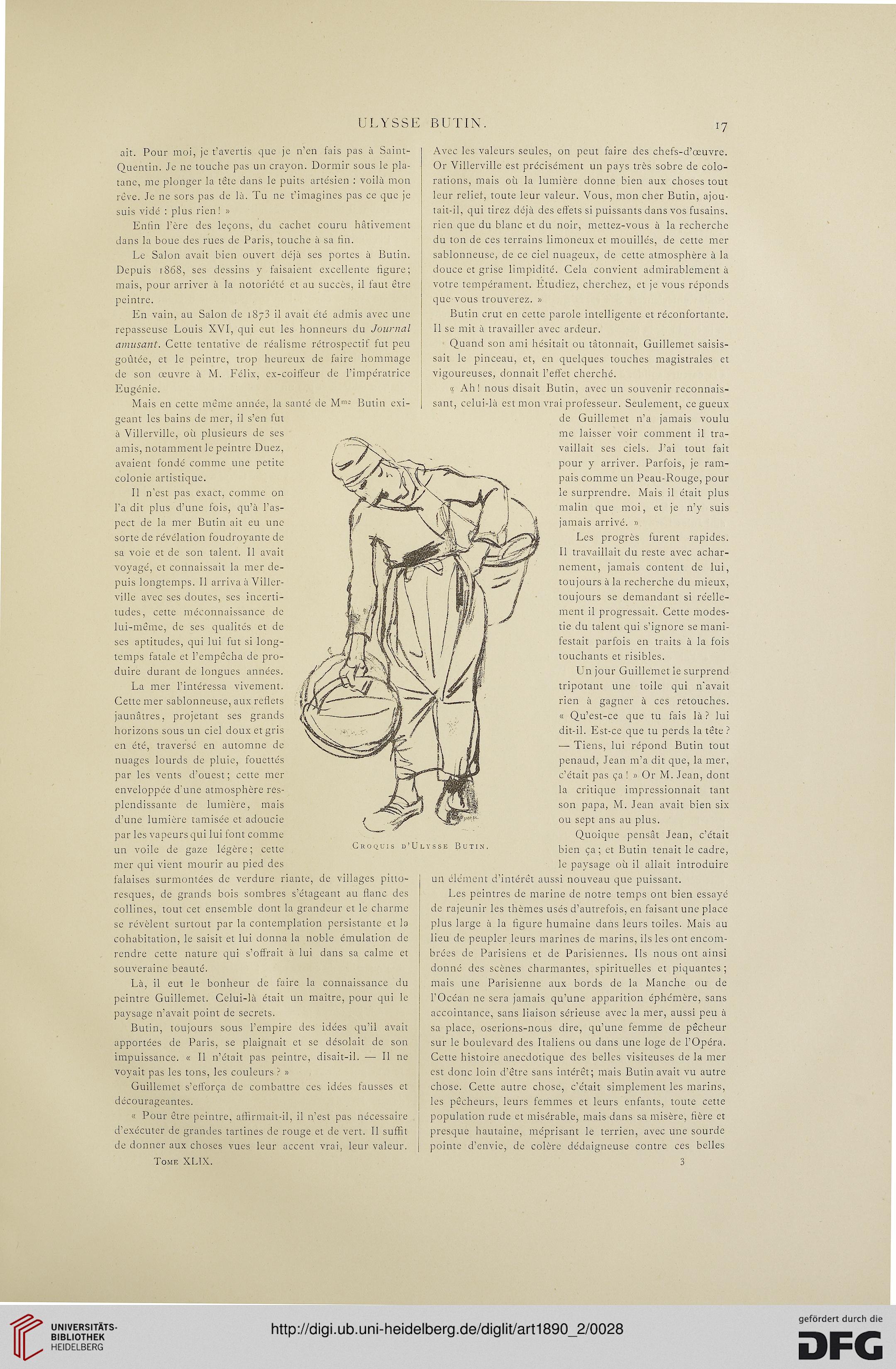ULYSSE BUTIN.
l7
ait. Pour moi, je t’avertis que je n’en fais pas à Saint-
Quentin. Je 11e touche pas un crayon. Dormir sous le pla-
tane, me plonger la tête dans le puits artésien : voilà mon
rêve. Je ne sors pas de là. Tu ne t’imagines pas ce que je
suis vidé : plus rien! »
Enfin l’ère des leçons, du cachet couru hâtivement
dans la boue des rues de Paris, touche à sa fin.
Le Salon avait bien ouvert déjà ses portes à Butin.
Depuis 1868, ses dessins y faisaient excellente figure;
mais, pour arriver à la notoriété et au succès, il faut être
peintre.
En vain, au Salon de 1878 il avait été admis avec une
repasseuse Louis XVI, qui eut les honneurs du Journal
amusant. Cette tentative de réalisme rétrospectif fut peu
goûtée, et le peintre, trop heureux de faire hommage
de son œuvre à M. Félix, ex-coiffeur de l’impératrice
Eugénie.
Mais en cette même année, la santé de Mms Butin exi-
geant les bains de mer, il s’en fut
à Villerville, où plusieurs de ses
amis, notamment le peintre Duez,
avaient fondé comme une petite
colonie artistique.
Il n’est pas exact, comme on
l’a dit plus d’une fois, qu’à l’as-
pect de la mer Butin ait eu une
sorte de révélation foudroyante de
sa voie et de son talent. 11 avait
voyagé, et connaissait la mer de-
puis longtemps. Il arriva à Viller-
ville avec ses doutes, ses incerti-
tudes, cette méconnaissance de
lui-même, de ses qualités et de
ses aptitudes, qui lui fut si long-
temps fatale et l’empêcha de pro-
duire durant de longues années.
La mer l’intéressa vivement.
Cette mer sablonneuse, aux reflets
jaunâtres, projetant ses grands
horizons sous un ciel doux et gris
en été, traversé en automne de
nuages lourds de pluie, fouettés
par les vents d’ouest; cette mer
enveloppée d'une atmosphère res-
plendissante de lumière, mais
d’une lumière tamisée et adoucie
par les vapeurs qui lui font comme
un voile de gaze légère ; cette
mer qui vient mourir au pied des
falaises surmontées de verdure riante, de villages pitto-
resques, de grands bois sombres s’étageant au flanc des
collines, tout cet ensemble dont la grandeur et le charme
se révèlent surtout par la contemplation persistante et la
cohabitation, le saisit et lui donna la noble émulation de
rendre cette nature qui s’offrait à lui dans sa calme et
souveraine beauté.
Là, il eut le bonheur de faire la connaissance du
peintre Guillemet. Celui-là était un maître, pour qui le
paysage n’avait point de secrets.
Butin, toujours sous l’empire des idées qu’il avait
apportées de Paris, se plaignait et se désolait de son
impuissance. « Il n’était pas peintre, disait-il. — Il ne
voyait pas les tons, les couleurs ? »
Guillemet s’efforça de combattre ces idées fausses et
décourageantes.
« Pour être peintre, affirmait-il, il n’est pas nécessaire
d’exécuter de grandes tartines de rouge et de vert. Il suffit
de donner aux choses vues leur accent vrai, leur valeur.
Tome XLIX.
Avec les valeurs seules, on peut faire des chefs-d’œuvre.
Or Villerville est précisément un pays très sobre de colo-
rations, mais où la lumière donne bien aux choses tout
leur relief, toute leur valeur. Vous, mon cher Butin, ajou-
tait-il, qui tirez déjà des effets si puissants dans vos fusains,
rien que du blanc et du noir, mettez-vous à la recherche
du ton de ces terrains limoneux et mouillés, de cette mer
sablonneuse, de ce ciel nuageux, de cette atmosphère à la
douce et grise limpidité. Cela convient admirablement à
votre tempérament. Etudiez, cherchez, et je vous réponds
que vous trouverez. »
Butin crut en cette parole intelligente et réconfortante.
11 se mit à travailler avec ardeur.
Quand son ami hésitait ou tâtonnait, Guillemet saisis-
sait le pinceau, et, en quelques touches magistrales et
vigoureuses, donnait l’effet cherché.
« Ah! nous disait Butin, avec un souvenir reconnais-
sant, celui-là est mon vrai professeur. Seulement, ce gueux
de Guillemet n’a jamais voulu
me laisser voir comment il tra-
vaillait ses ciels. J’ai tout fait
pour y arriver. Parfois, je ram-
pais comme un Peau-Rouge, pour
le surprendre. Mais il était plus
malin que moi, et je n’y suis
jamais arrivé. »
Les progrès furent rapides.
Il travaillait du reste avec achar-
nement, jamais content de lui,
toujours à la recherche du mieux,
toujours se demandant si réelle-
ment il progressait. Cette modes-
tie du talent qui s’ignore se mani-
festait parfois en traits à la fois
touchants et risibles.
Un jour Guillemet le surprend
tripotant une toile qui n’avait
rien à gagner à ces retouches.
« Qu’est-ce que tu fais là ? lui
dit-il. Est-ce que tu perds la tête ?
— Tiens, lui répond Butin tout
penaud, Jean m’a dit que, la mer,
c’était pas ça ! « Or M. Jean, dont
la critique impressionnait tant
son papa, M. Jean avait bien six
ou sept ans au plus.
Quoique pensât Jean, c’était
bien ça; et Butin tenait le cadre,
le paysage où il allait introduire
un élément d’intérêt aussi nouveau que puissant.
Les peintres de marine de notre temps ont bien essayé
de rajeunir les thèmes usés d’autrefois, en faisant une place
plus large à la figure humaine dans leurs toiles. Mais au
lieu de peupler leurs marines de marins, ils les ont encom-
brées de Parisiens et de Parisiennes. Ils nous ont ainsi
donné des scènes charmantes, spirituelles et piquantes ;
mais une Parisienne aux bords de la Manche ou de
l’Océan ne sera jamais qu’une apparition éphémère, sans
accointance, sans liaison sérieuse avec la mer, aussi peu à
sa place, oserions-nous dire, qu’une femme de pêcheur
sur le boulevard des Italiens ou dans une loge de l’Opéra.
Cette histoire anecdotique des belles visiteuses de la mer
est donc loin d’être sans intérêt; mais Butin avait vu autre
chose. Cette autre chose, c’était simplement les marins,
les pêcheurs, leurs femmes et leurs enfants, toute cette
population rude et misérable, mais dans sa misère, hère et
presque hautaine, méprisant le terrien, avec une sourde
pointe d’envie, de colère dédaigneuse contre ces belles
3
l7
ait. Pour moi, je t’avertis que je n’en fais pas à Saint-
Quentin. Je 11e touche pas un crayon. Dormir sous le pla-
tane, me plonger la tête dans le puits artésien : voilà mon
rêve. Je ne sors pas de là. Tu ne t’imagines pas ce que je
suis vidé : plus rien! »
Enfin l’ère des leçons, du cachet couru hâtivement
dans la boue des rues de Paris, touche à sa fin.
Le Salon avait bien ouvert déjà ses portes à Butin.
Depuis 1868, ses dessins y faisaient excellente figure;
mais, pour arriver à la notoriété et au succès, il faut être
peintre.
En vain, au Salon de 1878 il avait été admis avec une
repasseuse Louis XVI, qui eut les honneurs du Journal
amusant. Cette tentative de réalisme rétrospectif fut peu
goûtée, et le peintre, trop heureux de faire hommage
de son œuvre à M. Félix, ex-coiffeur de l’impératrice
Eugénie.
Mais en cette même année, la santé de Mms Butin exi-
geant les bains de mer, il s’en fut
à Villerville, où plusieurs de ses
amis, notamment le peintre Duez,
avaient fondé comme une petite
colonie artistique.
Il n’est pas exact, comme on
l’a dit plus d’une fois, qu’à l’as-
pect de la mer Butin ait eu une
sorte de révélation foudroyante de
sa voie et de son talent. 11 avait
voyagé, et connaissait la mer de-
puis longtemps. Il arriva à Viller-
ville avec ses doutes, ses incerti-
tudes, cette méconnaissance de
lui-même, de ses qualités et de
ses aptitudes, qui lui fut si long-
temps fatale et l’empêcha de pro-
duire durant de longues années.
La mer l’intéressa vivement.
Cette mer sablonneuse, aux reflets
jaunâtres, projetant ses grands
horizons sous un ciel doux et gris
en été, traversé en automne de
nuages lourds de pluie, fouettés
par les vents d’ouest; cette mer
enveloppée d'une atmosphère res-
plendissante de lumière, mais
d’une lumière tamisée et adoucie
par les vapeurs qui lui font comme
un voile de gaze légère ; cette
mer qui vient mourir au pied des
falaises surmontées de verdure riante, de villages pitto-
resques, de grands bois sombres s’étageant au flanc des
collines, tout cet ensemble dont la grandeur et le charme
se révèlent surtout par la contemplation persistante et la
cohabitation, le saisit et lui donna la noble émulation de
rendre cette nature qui s’offrait à lui dans sa calme et
souveraine beauté.
Là, il eut le bonheur de faire la connaissance du
peintre Guillemet. Celui-là était un maître, pour qui le
paysage n’avait point de secrets.
Butin, toujours sous l’empire des idées qu’il avait
apportées de Paris, se plaignait et se désolait de son
impuissance. « Il n’était pas peintre, disait-il. — Il ne
voyait pas les tons, les couleurs ? »
Guillemet s’efforça de combattre ces idées fausses et
décourageantes.
« Pour être peintre, affirmait-il, il n’est pas nécessaire
d’exécuter de grandes tartines de rouge et de vert. Il suffit
de donner aux choses vues leur accent vrai, leur valeur.
Tome XLIX.
Avec les valeurs seules, on peut faire des chefs-d’œuvre.
Or Villerville est précisément un pays très sobre de colo-
rations, mais où la lumière donne bien aux choses tout
leur relief, toute leur valeur. Vous, mon cher Butin, ajou-
tait-il, qui tirez déjà des effets si puissants dans vos fusains,
rien que du blanc et du noir, mettez-vous à la recherche
du ton de ces terrains limoneux et mouillés, de cette mer
sablonneuse, de ce ciel nuageux, de cette atmosphère à la
douce et grise limpidité. Cela convient admirablement à
votre tempérament. Etudiez, cherchez, et je vous réponds
que vous trouverez. »
Butin crut en cette parole intelligente et réconfortante.
11 se mit à travailler avec ardeur.
Quand son ami hésitait ou tâtonnait, Guillemet saisis-
sait le pinceau, et, en quelques touches magistrales et
vigoureuses, donnait l’effet cherché.
« Ah! nous disait Butin, avec un souvenir reconnais-
sant, celui-là est mon vrai professeur. Seulement, ce gueux
de Guillemet n’a jamais voulu
me laisser voir comment il tra-
vaillait ses ciels. J’ai tout fait
pour y arriver. Parfois, je ram-
pais comme un Peau-Rouge, pour
le surprendre. Mais il était plus
malin que moi, et je n’y suis
jamais arrivé. »
Les progrès furent rapides.
Il travaillait du reste avec achar-
nement, jamais content de lui,
toujours à la recherche du mieux,
toujours se demandant si réelle-
ment il progressait. Cette modes-
tie du talent qui s’ignore se mani-
festait parfois en traits à la fois
touchants et risibles.
Un jour Guillemet le surprend
tripotant une toile qui n’avait
rien à gagner à ces retouches.
« Qu’est-ce que tu fais là ? lui
dit-il. Est-ce que tu perds la tête ?
— Tiens, lui répond Butin tout
penaud, Jean m’a dit que, la mer,
c’était pas ça ! « Or M. Jean, dont
la critique impressionnait tant
son papa, M. Jean avait bien six
ou sept ans au plus.
Quoique pensât Jean, c’était
bien ça; et Butin tenait le cadre,
le paysage où il allait introduire
un élément d’intérêt aussi nouveau que puissant.
Les peintres de marine de notre temps ont bien essayé
de rajeunir les thèmes usés d’autrefois, en faisant une place
plus large à la figure humaine dans leurs toiles. Mais au
lieu de peupler leurs marines de marins, ils les ont encom-
brées de Parisiens et de Parisiennes. Ils nous ont ainsi
donné des scènes charmantes, spirituelles et piquantes ;
mais une Parisienne aux bords de la Manche ou de
l’Océan ne sera jamais qu’une apparition éphémère, sans
accointance, sans liaison sérieuse avec la mer, aussi peu à
sa place, oserions-nous dire, qu’une femme de pêcheur
sur le boulevard des Italiens ou dans une loge de l’Opéra.
Cette histoire anecdotique des belles visiteuses de la mer
est donc loin d’être sans intérêt; mais Butin avait vu autre
chose. Cette autre chose, c’était simplement les marins,
les pêcheurs, leurs femmes et leurs enfants, toute cette
population rude et misérable, mais dans sa misère, hère et
presque hautaine, méprisant le terrien, avec une sourde
pointe d’envie, de colère dédaigneuse contre ces belles
3