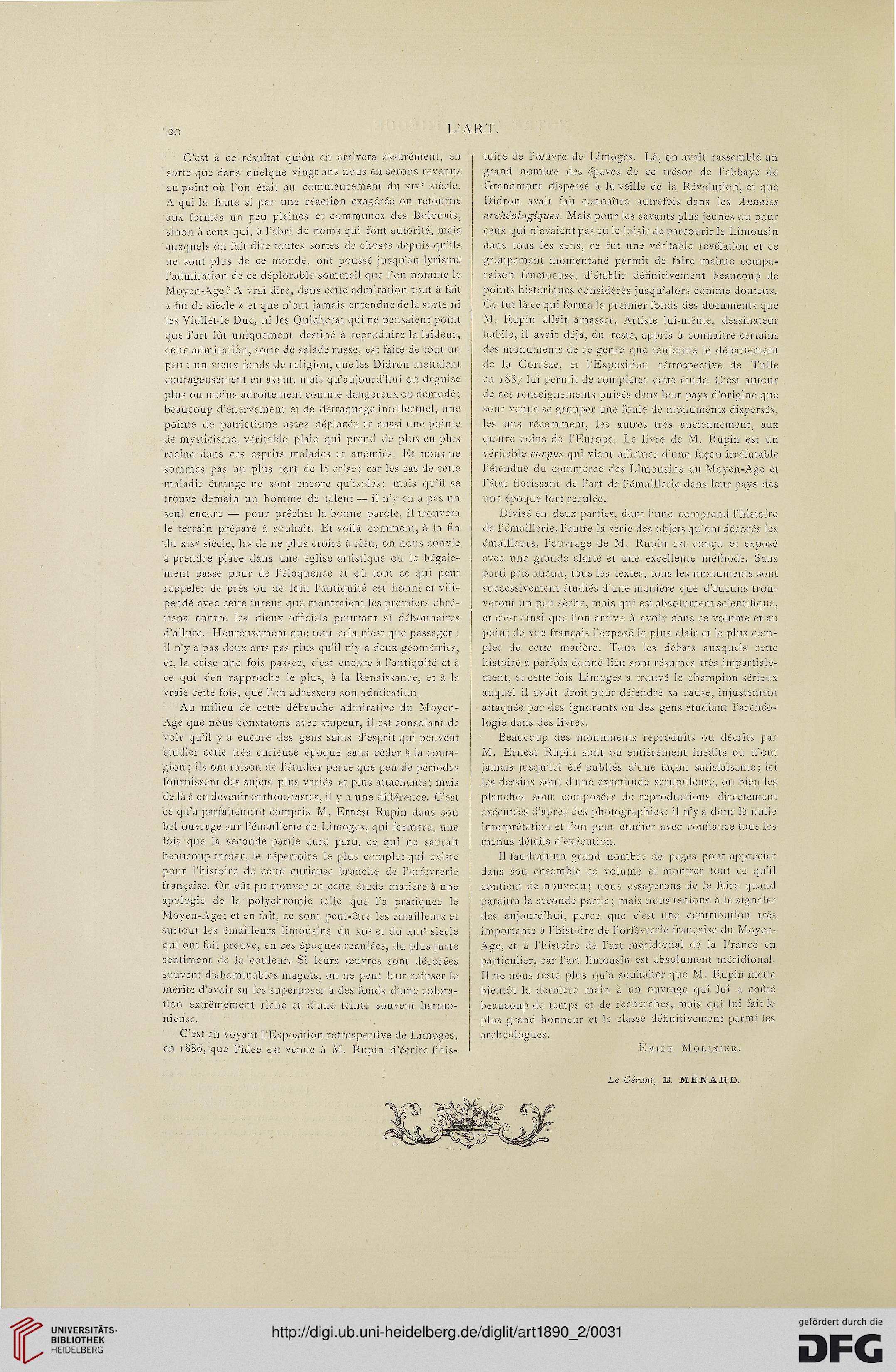20
L'ART.
C’est à ce résultat qu’on en arrivera assurément, en
sorte que dans quelque vingt ans nous en serons revenus
au point où l’on était au commencement du xixc siècle.
A qui la faute si par une réaction exagérée on retourne
aux formes un peu pleines et communes des Bolonais,
sinon à ceux qui, à l’abri de noms qui font autorité, mais
auxquels on fait dire toutes sortes de choses depuis qu’ils
ne sont plus de ce monde, ont poussé jusqu’au lyrisme
l’admiration de ce déplorable sommeil que l’on nomme le
Moyen-Age ? A vrai dire., dans cette admiration tout à fait
« fin de siècle » et que n’ont jamais entendue de la sorte ni
les Viollet-le Duc, ni les Quicherat qui ne pensaient point
que l’art fût uniquement destiné à reproduire la laideur,
cette admiration, sorte de salade russe, est faite de tout un
peu : un vieux fonds de religion, que les Didron mettaient
courageusement en avant, mais qu’aujourd’hui on déguise
plus ou moins adroitement comme dangereux ou démodé;
beaucoup d’énervement et de détraquage intellectuel, une
pointe de patriotisme assez déplacée et aussi une pointe
de mysticisme, véritable plaie qui prend de plus en plus
racine dans ces esprits malades et anémiés. Et nous ne
sommes pas au plus tort de la crise; car les cas de cette
maladie étrange ne sont encore qu’isolés; mais qu’il se
trouve demain un homme de talent — il n’y en a pas un
seul encore — pour prêcher la bonne parole, il trouvera
le terrain préparé à souhait. Et voilà comment, à la fin
du xixe siècle, las de ne plus croire à rien, on nous convie
à prendre place dans une église artistique où le bégaie-
ment passe pour de l’éloquence et où tout ce qui peut
rappeler de près ou de loin l’antiquité est honni et vili-
pendé avec cette fureur que montraient les premiers chré-
tiens contre les dieux officiels pourtant si débonnaires
d’allure. Heureusement que tout cela n’est que passager :
il n’y a pas deux arts pas plus qu’il n’y a deux géométries,
et, la crise une fois passée, c’est encore à l’antiquité et à
ce qui s’en rapproche le plus, à la Renaissance, et à la
vraie cette fois, que l’on adressera son admiration.
Au milieu de cette débauche admirative du Moyen-
Age que nous constatons avec stupeur, il est consolant de
voir qu’il y a encore des gens sains d’esprit qui peuvent
étudier cette très curieuse époque sans céder à la conta-
gion ; ils ont raison de l’étudier parce que peu de périodes
fournissent des sujets plus variés et plus attachants; mais
de là à en devenir enthousiastes, il y a une différence. C’est
ce qu’a parfaitement compris M. Ernest Rupin dans son
bel ouvrage sur l’émaillerie de Limoges, qui formera, une
fois que la seconde partie aura paru, ce qui ne saurait
beaucoup tarder, le répertoire le plus complet qui existe
pour l’histoire de cette curieuse branche de l’orfèvrerie
française. On eut pu trouver en cette étude matière à une
apologie de la polychromie telle que l'a pratiquée le
Moyen-Age; et en fait, ce sont peut-être les émailleurs et
surtout les émailleurs limousins du xne et du xme siècle
qui ont fait preuve, en ces époques reculées, du plus juste
sentiment de la couleur. Si leurs œuvres sont décorées
souvent d’abominables magots, on ne peut leur refuser le
mérite d’avoir su les superposer à des fonds d’une colora-
tion extrêmement riche et d’une teinte souvent harmo-
nieuse.
C est en voyant l’Exposition rétrospective de Limoges,
en 1886, que l’idée est venue à M. Rupin d’écrire l’his-
toire de l’œuvre de Limoges. Là, on avait rassemblé un
grand nombre des épaves de ce trésor de l’abbaye de
Grandmont dispersé à la veille de la Révolution, et que
Didron avait fait connaître autrefois dans les Annales
archéologiques. Mais pour les savants plus jeunes ou pour
ceux qui n’avaient pas eu le loisir de parcourir le Limousin
dans tous les sens, ce fut une véritable révélation et ce
groupement momentané permit de faire mainte compa-
raison fructueuse, d’établir définitivement beaucoup de
points historiques considérés jusqu’alors comme douteux.
Ce fut là ce qui forma le premier fonds des documents que
M. Rupin allait amasser. Artiste lui-même, dessinateur
habile, il avait déjà, du reste, appris à connaître certains
des monuments de ce genre que renferme le département
de la Corrèze, et l’Exposition rétrospective de Tulle
en 1S87 lui permit de compléter cette étude. C’est autour
de ces renseignements puisés dans leur pays d’origine que
sont venus se grouper une foule de monuments dispersés,
les uns récemment, les autres très anciennement, aux
quatre coins de l’Europe. Le livre de M. Rupin est un
véritable corpus qui vient affirmer d’une façon irréfutable
l’étendue du commerce des Limousins au Moyen-Age et
l’état florissant de l’art de l’émaillerie dans leur pays dès
une époque fort reculée.
Divisé en deux parties, dont l’une comprend l’histoire
de l’émaillerie, l’autre la série des objets qu’ont décorés les
émailleurs, l’ouvrage de M. Rupin est conçu et exposé
avec une grande clarté et une excellente méthode. Sans
parti pris aucun, tous les textes, tous les monuments sont
successivement étudiés d’une manière que d’aucuns trou-
veront un peu sèche, mais qui est absolument scientifique,
et c’est ainsi que l’on arrive à avoir dans ce volume et au
point de vue français l’exposé le plus clair et le plus com-
plet de cette matière. Tous les débats auxquels cette
histoire a parfois donné lieu sont résumés très impartiale-
ment, et cette fois Limoges a trouvé le champion sérieux
auquel il avait droit pour défendre sa cause, injustement
attaquée par des ignorants ou des gens étudiant l’archéo-
logie dans des livres.
Beaucoup des monuments reproduits ou décrits par
AL Ernest Rupin sont ou entièrement inédits ou n’ont
jamais jusqu’ici été publiés d’une façon satisfaisante; ici
les dessins sont d’une exactitude scrupuleuse, ou bien les
planches sont composées de reproductions directement
exécutées d’après des photographies; il n’y a donc là nulle
interprétation et l’on peut étudier avec confiance tous les
menus détails d’exécution.
Il faudrait un grand nombre de pages pour apprécier
dans son ensemble ce volume et montrer tout ce qu’il
contient de nouveau; nous essayerons de le faire quand
paraîtra la seconde partie; mais nous tenions à le signaler
dès aujourd’hui, parce que c’est une contribution très
importante à l’histoire de l’orfèvrerie française du Moyen-
Age, et à l’histoire de l’art méridional de la France en
particulier, car l’art limousin est absolument méridional.
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter que M. Rupin mette
bientôt la dernière main à un ouvrage qui lui a coûté
beaucoup de temps et de recherches, mais qui lui fait le
plus grand honneur et le classe définitivement parmi les
archéologues.
Emile Molinier.
Le Gérant, E. MÉNARD.
L'ART.
C’est à ce résultat qu’on en arrivera assurément, en
sorte que dans quelque vingt ans nous en serons revenus
au point où l’on était au commencement du xixc siècle.
A qui la faute si par une réaction exagérée on retourne
aux formes un peu pleines et communes des Bolonais,
sinon à ceux qui, à l’abri de noms qui font autorité, mais
auxquels on fait dire toutes sortes de choses depuis qu’ils
ne sont plus de ce monde, ont poussé jusqu’au lyrisme
l’admiration de ce déplorable sommeil que l’on nomme le
Moyen-Age ? A vrai dire., dans cette admiration tout à fait
« fin de siècle » et que n’ont jamais entendue de la sorte ni
les Viollet-le Duc, ni les Quicherat qui ne pensaient point
que l’art fût uniquement destiné à reproduire la laideur,
cette admiration, sorte de salade russe, est faite de tout un
peu : un vieux fonds de religion, que les Didron mettaient
courageusement en avant, mais qu’aujourd’hui on déguise
plus ou moins adroitement comme dangereux ou démodé;
beaucoup d’énervement et de détraquage intellectuel, une
pointe de patriotisme assez déplacée et aussi une pointe
de mysticisme, véritable plaie qui prend de plus en plus
racine dans ces esprits malades et anémiés. Et nous ne
sommes pas au plus tort de la crise; car les cas de cette
maladie étrange ne sont encore qu’isolés; mais qu’il se
trouve demain un homme de talent — il n’y en a pas un
seul encore — pour prêcher la bonne parole, il trouvera
le terrain préparé à souhait. Et voilà comment, à la fin
du xixe siècle, las de ne plus croire à rien, on nous convie
à prendre place dans une église artistique où le bégaie-
ment passe pour de l’éloquence et où tout ce qui peut
rappeler de près ou de loin l’antiquité est honni et vili-
pendé avec cette fureur que montraient les premiers chré-
tiens contre les dieux officiels pourtant si débonnaires
d’allure. Heureusement que tout cela n’est que passager :
il n’y a pas deux arts pas plus qu’il n’y a deux géométries,
et, la crise une fois passée, c’est encore à l’antiquité et à
ce qui s’en rapproche le plus, à la Renaissance, et à la
vraie cette fois, que l’on adressera son admiration.
Au milieu de cette débauche admirative du Moyen-
Age que nous constatons avec stupeur, il est consolant de
voir qu’il y a encore des gens sains d’esprit qui peuvent
étudier cette très curieuse époque sans céder à la conta-
gion ; ils ont raison de l’étudier parce que peu de périodes
fournissent des sujets plus variés et plus attachants; mais
de là à en devenir enthousiastes, il y a une différence. C’est
ce qu’a parfaitement compris M. Ernest Rupin dans son
bel ouvrage sur l’émaillerie de Limoges, qui formera, une
fois que la seconde partie aura paru, ce qui ne saurait
beaucoup tarder, le répertoire le plus complet qui existe
pour l’histoire de cette curieuse branche de l’orfèvrerie
française. On eut pu trouver en cette étude matière à une
apologie de la polychromie telle que l'a pratiquée le
Moyen-Age; et en fait, ce sont peut-être les émailleurs et
surtout les émailleurs limousins du xne et du xme siècle
qui ont fait preuve, en ces époques reculées, du plus juste
sentiment de la couleur. Si leurs œuvres sont décorées
souvent d’abominables magots, on ne peut leur refuser le
mérite d’avoir su les superposer à des fonds d’une colora-
tion extrêmement riche et d’une teinte souvent harmo-
nieuse.
C est en voyant l’Exposition rétrospective de Limoges,
en 1886, que l’idée est venue à M. Rupin d’écrire l’his-
toire de l’œuvre de Limoges. Là, on avait rassemblé un
grand nombre des épaves de ce trésor de l’abbaye de
Grandmont dispersé à la veille de la Révolution, et que
Didron avait fait connaître autrefois dans les Annales
archéologiques. Mais pour les savants plus jeunes ou pour
ceux qui n’avaient pas eu le loisir de parcourir le Limousin
dans tous les sens, ce fut une véritable révélation et ce
groupement momentané permit de faire mainte compa-
raison fructueuse, d’établir définitivement beaucoup de
points historiques considérés jusqu’alors comme douteux.
Ce fut là ce qui forma le premier fonds des documents que
M. Rupin allait amasser. Artiste lui-même, dessinateur
habile, il avait déjà, du reste, appris à connaître certains
des monuments de ce genre que renferme le département
de la Corrèze, et l’Exposition rétrospective de Tulle
en 1S87 lui permit de compléter cette étude. C’est autour
de ces renseignements puisés dans leur pays d’origine que
sont venus se grouper une foule de monuments dispersés,
les uns récemment, les autres très anciennement, aux
quatre coins de l’Europe. Le livre de M. Rupin est un
véritable corpus qui vient affirmer d’une façon irréfutable
l’étendue du commerce des Limousins au Moyen-Age et
l’état florissant de l’art de l’émaillerie dans leur pays dès
une époque fort reculée.
Divisé en deux parties, dont l’une comprend l’histoire
de l’émaillerie, l’autre la série des objets qu’ont décorés les
émailleurs, l’ouvrage de M. Rupin est conçu et exposé
avec une grande clarté et une excellente méthode. Sans
parti pris aucun, tous les textes, tous les monuments sont
successivement étudiés d’une manière que d’aucuns trou-
veront un peu sèche, mais qui est absolument scientifique,
et c’est ainsi que l’on arrive à avoir dans ce volume et au
point de vue français l’exposé le plus clair et le plus com-
plet de cette matière. Tous les débats auxquels cette
histoire a parfois donné lieu sont résumés très impartiale-
ment, et cette fois Limoges a trouvé le champion sérieux
auquel il avait droit pour défendre sa cause, injustement
attaquée par des ignorants ou des gens étudiant l’archéo-
logie dans des livres.
Beaucoup des monuments reproduits ou décrits par
AL Ernest Rupin sont ou entièrement inédits ou n’ont
jamais jusqu’ici été publiés d’une façon satisfaisante; ici
les dessins sont d’une exactitude scrupuleuse, ou bien les
planches sont composées de reproductions directement
exécutées d’après des photographies; il n’y a donc là nulle
interprétation et l’on peut étudier avec confiance tous les
menus détails d’exécution.
Il faudrait un grand nombre de pages pour apprécier
dans son ensemble ce volume et montrer tout ce qu’il
contient de nouveau; nous essayerons de le faire quand
paraîtra la seconde partie; mais nous tenions à le signaler
dès aujourd’hui, parce que c’est une contribution très
importante à l’histoire de l’orfèvrerie française du Moyen-
Age, et à l’histoire de l’art méridional de la France en
particulier, car l’art limousin est absolument méridional.
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter que M. Rupin mette
bientôt la dernière main à un ouvrage qui lui a coûté
beaucoup de temps et de recherches, mais qui lui fait le
plus grand honneur et le classe définitivement parmi les
archéologues.
Emile Molinier.
Le Gérant, E. MÉNARD.