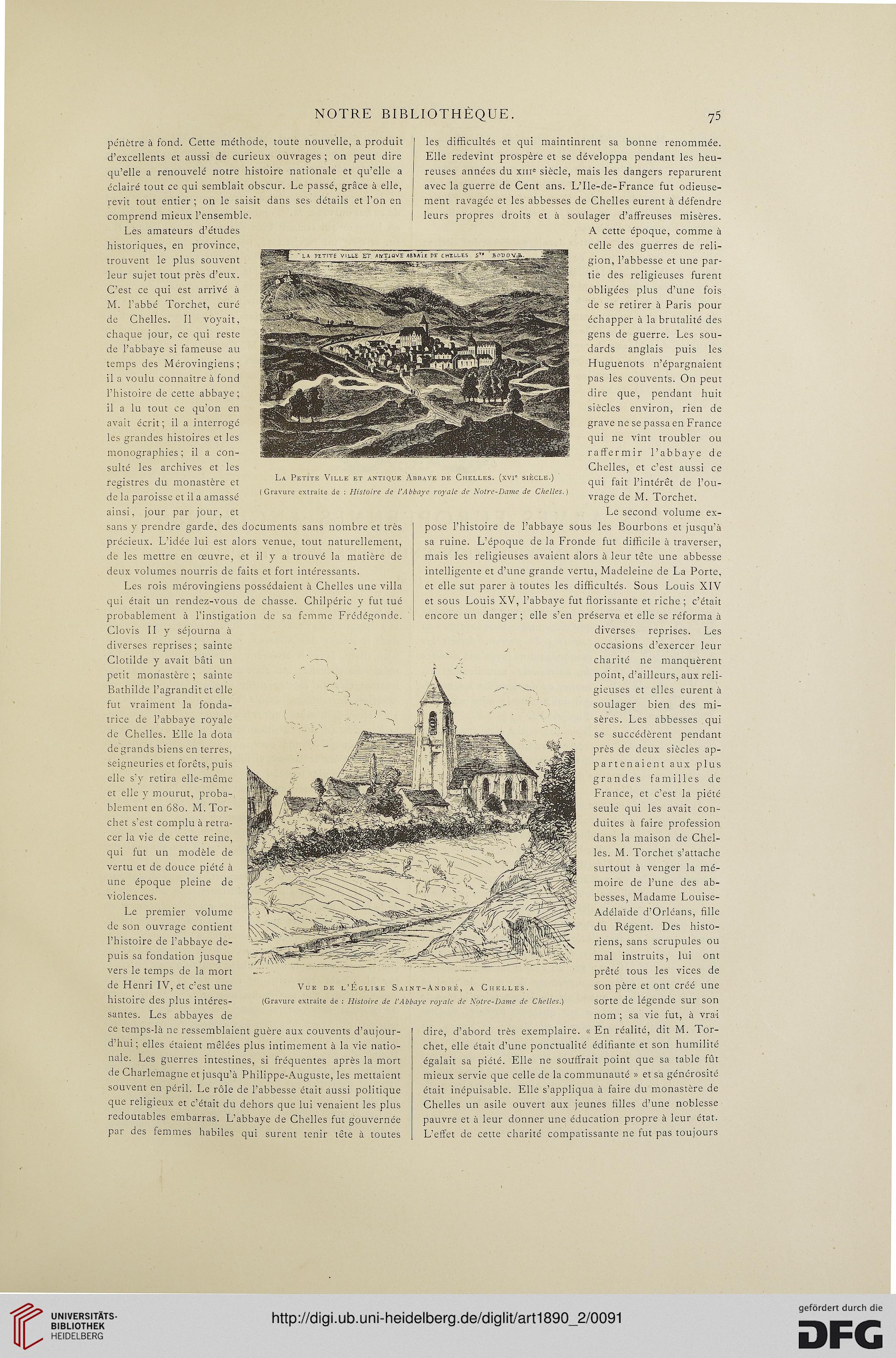NOTRE BIBLIOTHÈQUE
pénètre à fond. Cette méthode, toute nouvelle, a produit
d’excellents et aussi de curieux ouvrages ; on peut dire
qu’elle a renouvelé notre histoire nationale et qu’elle a
éclairé tout ce qui semblait obscur. Le passé, grâce à elle,
revit tout entier ; on le saisit dans ses détails et l’on en
comprend mieux l’ensemble.
Les amateurs d’études
historiques, en province,
trouvent le plus souvent
leur sujet tout près d’eux.
C’est ce qui est arrivé à
M. l’abbé Torchet, curé
de Chelles. 11 voyait,
chaque jour, ce qui reste
de l’abbaye si fameuse au
temps des Mérovingiens;
il a voulu connaître à fond
l’histoire de cette abbaye;
il a lu tout ce qu’on en
avait écrit; il a interrogé
les grandes histoires et les
monographies; il a con-
sulté les archives et les
registres du monastère et
de la paroisse et il a amassé
ainsi, jour par jour, et
sans y prendre garde, des documents sans nombre et très
précieux. L’idée lui est alors venue, tout naturellement,
de les mettre en œuvre, et il y a trouvé la matière de
deux volumes nourris de faits et fort intéressants.
Les rois mérovingiens possédaient à Chelles une villa
qui était un rendez-vous de chasse. Chilpéric y fut tué
probablement à l’instigation de sa femme Frédégonde.
Clovis II y séjourna à
diverses reprises; sainte
Clotilde y avait bâti un
petit monastère ; sainte
Bathilde l’agrandit et elle
fut vraiment la fonda-
trice de l’abbaye royale
de Chelles. Elle la dota
de grands biens en terres,
seigneuries et forêts, puis
elle s’y retira elle-même
et elle y mourut, proba-
blement en 680. M. Tor-
chet s’est complu à retra-
cer la vie de cette reine,
qui fut un modèle de
vertu et de douce piété à
une époque pleine de
violences.
Le premier volume
de son ouvrage contient
l’histoire de l’abbaye de-
puis sa fondation jusque
vers le temps de la mort
de Henri IV, et c’est une
histoire des plus intéres-
santes. Les abbayes de
ce temps-là ne ressemblaient guère aux couvents d’aujour-
d’hui; elles étaient mêlées plus intimement à la vie natio-
nale. Les guerres intestines, si fréquentes après la mort
de Charlemagne et jusqu’à Philippe-Auguste, les mettaient
souvent en péril. Le rôle de l’abbesse était aussi politique
que religieux et c’était du dehors que lui venaient les plus
redoutables embarras. L’abbaye de Chelles fut gouvernée
par des femmes habiles qui surent tenir tête à toutes
La Petite Ville et antique Abbaye de Chelles. (xvi° siècle.)
(Gravure extraite de : Histoire de l’Abbaye royale de Notre-Dame de Chelles.)
Vue de l’Eglise Saint-André, a Chelles.
(Gravure extraite de : Histoire de l’Abbaye royale de Notre-Dame de Chelles.)
les difficultés et qui maintinrent sa bonne renommée.
Elle redevint prospère et se développa pendant les heu-
reuses années du xme siècle, mais les dangers reparurent
avec la guerre de Cent ans. L’Ile-de-France fut odieuse-
ment ravagée et les abbesses de Chelles eurent à défendre
leurs propres droits et à soulager d’affreuses misères.
A cette époque, comme à
celle des guerres de reli-
gion, l’abbesse et une par-
tie des religieuses furent
obligées plus d’une fois
de se retirer à Paris pour
échapper à la brutalité des
gens de guerre. Les sou-
dards anglais puis les
Huguenots n’épargnaient
pas les couvents. On peut
dire que, pendant huit
siècles environ, rien de
grave ne se passa en France
qui ne vînt troubler ou
raffermir l’abbaye de
Chelles, et c’est aussi ce
qui fait l’intérêt de l’ou-
vrage de M. Torchet.
Le second volume ex-
pose l’histoire de l’abbaye sous les Bourbons et jusqu’à
sa ruine. L’époque de la Fronde fut difficile à traverser,
mais les religieuses avaient alors à leur tête une abbesse
intelligente et d’une grande vertu, Madeleine de La Porte,
et elle sut parer à toutes les difficultés. Sous Louis XIV
et sous Louis XV, l’abbaye fut florissante et riche ; c’était
encore un danger ; elle s’en préserva et elle se réforma à
diverses reprises. Les
occasions d’exercer leur
charité ne manquèrent
point, d’ailleurs, aux reli-
gieuses et elles eurent à
soulager bien des mi-
sères. Les abbesses qui
se succédèrent pendant
près de deux siècles ap-
partenaient aux plus
grandes familles de
France, et c’est la piété
seule qui les avait con-
duites à faire profession
dans la maison de Chel-
les. M. Torchet s’attache
surtout à venger la mé-
moire de l’une des ab-
besses, Madame Louise-
Adélaïde d’Orléans, fille
du Régent. Des histo-
riens, sans scrupules ou
mal instruits, lui ont
prêté tous les vices de
son père et ont créé une
sorte de légende sur son
nom ; sa vie fut, à vrai
dire, d’abord très exemplaire. « En réalité, dit M. Tor-
chet, elle était d’une ponctualité édifiante et son humilité
égalait sa piété. Elle ne souffrait point que sa table fût
mieux servie que celle de la communauté » et sa générosité
était inépuisable. Elle s’appliqua à faire du monastère de
Chelles un asile ouvert aux jeunes filles d’une noblesse
pauvre et à leur donner une éducation propre à leur état.
L’effet de cette charité compatissante ne fut pas toujours
pénètre à fond. Cette méthode, toute nouvelle, a produit
d’excellents et aussi de curieux ouvrages ; on peut dire
qu’elle a renouvelé notre histoire nationale et qu’elle a
éclairé tout ce qui semblait obscur. Le passé, grâce à elle,
revit tout entier ; on le saisit dans ses détails et l’on en
comprend mieux l’ensemble.
Les amateurs d’études
historiques, en province,
trouvent le plus souvent
leur sujet tout près d’eux.
C’est ce qui est arrivé à
M. l’abbé Torchet, curé
de Chelles. 11 voyait,
chaque jour, ce qui reste
de l’abbaye si fameuse au
temps des Mérovingiens;
il a voulu connaître à fond
l’histoire de cette abbaye;
il a lu tout ce qu’on en
avait écrit; il a interrogé
les grandes histoires et les
monographies; il a con-
sulté les archives et les
registres du monastère et
de la paroisse et il a amassé
ainsi, jour par jour, et
sans y prendre garde, des documents sans nombre et très
précieux. L’idée lui est alors venue, tout naturellement,
de les mettre en œuvre, et il y a trouvé la matière de
deux volumes nourris de faits et fort intéressants.
Les rois mérovingiens possédaient à Chelles une villa
qui était un rendez-vous de chasse. Chilpéric y fut tué
probablement à l’instigation de sa femme Frédégonde.
Clovis II y séjourna à
diverses reprises; sainte
Clotilde y avait bâti un
petit monastère ; sainte
Bathilde l’agrandit et elle
fut vraiment la fonda-
trice de l’abbaye royale
de Chelles. Elle la dota
de grands biens en terres,
seigneuries et forêts, puis
elle s’y retira elle-même
et elle y mourut, proba-
blement en 680. M. Tor-
chet s’est complu à retra-
cer la vie de cette reine,
qui fut un modèle de
vertu et de douce piété à
une époque pleine de
violences.
Le premier volume
de son ouvrage contient
l’histoire de l’abbaye de-
puis sa fondation jusque
vers le temps de la mort
de Henri IV, et c’est une
histoire des plus intéres-
santes. Les abbayes de
ce temps-là ne ressemblaient guère aux couvents d’aujour-
d’hui; elles étaient mêlées plus intimement à la vie natio-
nale. Les guerres intestines, si fréquentes après la mort
de Charlemagne et jusqu’à Philippe-Auguste, les mettaient
souvent en péril. Le rôle de l’abbesse était aussi politique
que religieux et c’était du dehors que lui venaient les plus
redoutables embarras. L’abbaye de Chelles fut gouvernée
par des femmes habiles qui surent tenir tête à toutes
La Petite Ville et antique Abbaye de Chelles. (xvi° siècle.)
(Gravure extraite de : Histoire de l’Abbaye royale de Notre-Dame de Chelles.)
Vue de l’Eglise Saint-André, a Chelles.
(Gravure extraite de : Histoire de l’Abbaye royale de Notre-Dame de Chelles.)
les difficultés et qui maintinrent sa bonne renommée.
Elle redevint prospère et se développa pendant les heu-
reuses années du xme siècle, mais les dangers reparurent
avec la guerre de Cent ans. L’Ile-de-France fut odieuse-
ment ravagée et les abbesses de Chelles eurent à défendre
leurs propres droits et à soulager d’affreuses misères.
A cette époque, comme à
celle des guerres de reli-
gion, l’abbesse et une par-
tie des religieuses furent
obligées plus d’une fois
de se retirer à Paris pour
échapper à la brutalité des
gens de guerre. Les sou-
dards anglais puis les
Huguenots n’épargnaient
pas les couvents. On peut
dire que, pendant huit
siècles environ, rien de
grave ne se passa en France
qui ne vînt troubler ou
raffermir l’abbaye de
Chelles, et c’est aussi ce
qui fait l’intérêt de l’ou-
vrage de M. Torchet.
Le second volume ex-
pose l’histoire de l’abbaye sous les Bourbons et jusqu’à
sa ruine. L’époque de la Fronde fut difficile à traverser,
mais les religieuses avaient alors à leur tête une abbesse
intelligente et d’une grande vertu, Madeleine de La Porte,
et elle sut parer à toutes les difficultés. Sous Louis XIV
et sous Louis XV, l’abbaye fut florissante et riche ; c’était
encore un danger ; elle s’en préserva et elle se réforma à
diverses reprises. Les
occasions d’exercer leur
charité ne manquèrent
point, d’ailleurs, aux reli-
gieuses et elles eurent à
soulager bien des mi-
sères. Les abbesses qui
se succédèrent pendant
près de deux siècles ap-
partenaient aux plus
grandes familles de
France, et c’est la piété
seule qui les avait con-
duites à faire profession
dans la maison de Chel-
les. M. Torchet s’attache
surtout à venger la mé-
moire de l’une des ab-
besses, Madame Louise-
Adélaïde d’Orléans, fille
du Régent. Des histo-
riens, sans scrupules ou
mal instruits, lui ont
prêté tous les vices de
son père et ont créé une
sorte de légende sur son
nom ; sa vie fut, à vrai
dire, d’abord très exemplaire. « En réalité, dit M. Tor-
chet, elle était d’une ponctualité édifiante et son humilité
égalait sa piété. Elle ne souffrait point que sa table fût
mieux servie que celle de la communauté » et sa générosité
était inépuisable. Elle s’appliqua à faire du monastère de
Chelles un asile ouvert aux jeunes filles d’une noblesse
pauvre et à leur donner une éducation propre à leur état.
L’effet de cette charité compatissante ne fut pas toujours