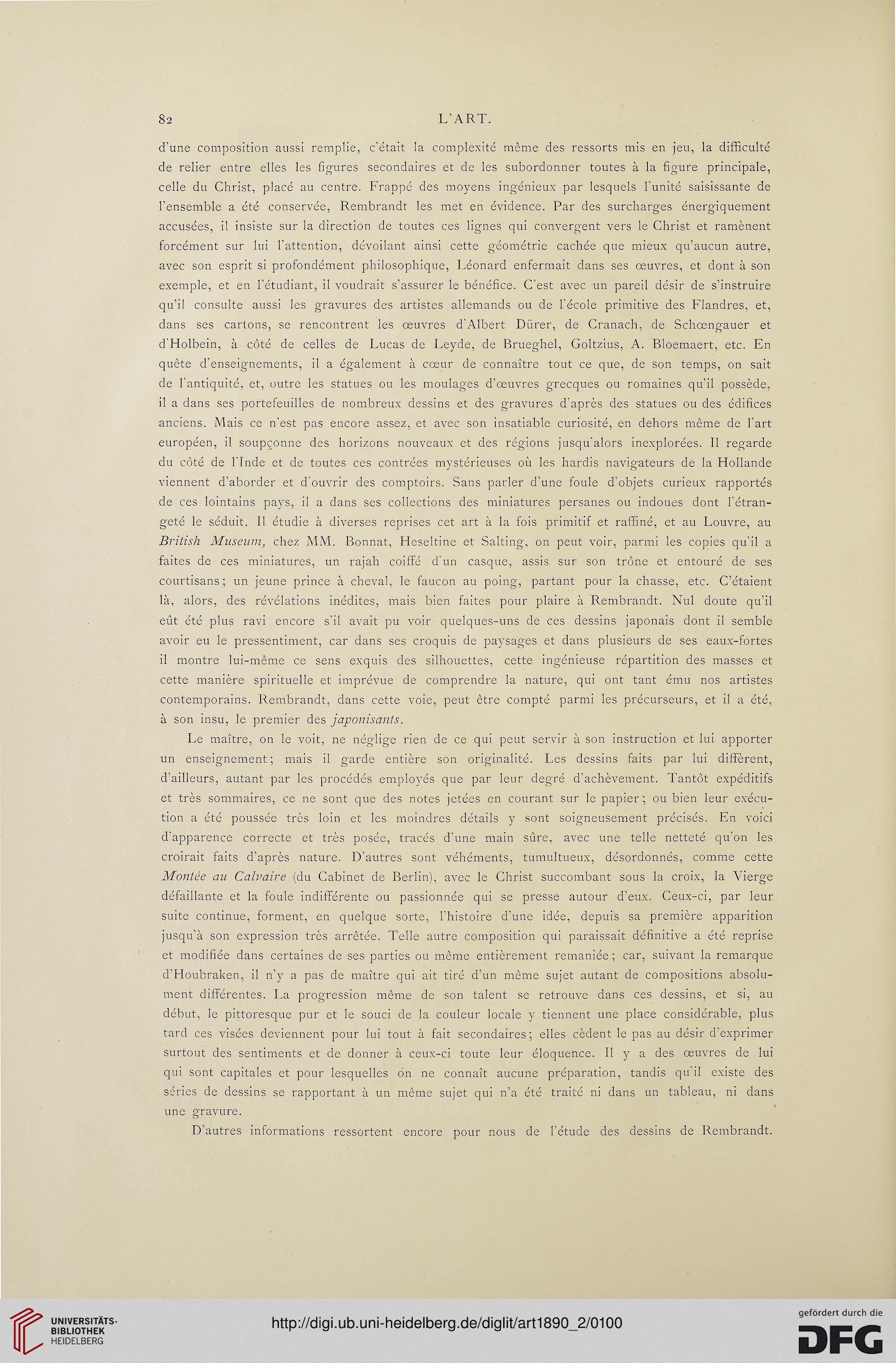82
L'ART.
d'une composition aussi remplie, c'était la complexité même des ressorts mis en jeu, la difficulté
de relier entre elles les figures secondaires et de les subordonner toutes à la figure principale,
celle du Christ, placé au centre. Frappé des moyens ingénieux par lesquels l'unité saisissante de
l’ensemble a été conservée, Rembrandt les met en évidence. Par des surcharges énergiquement
accusées, il insiste sur la direction de toutes ces lignes qui convergent vers le Christ et ramènent
forcément sur lui l’attention, dévoilant ainsi cette géométrie cachée que mieux qu’aucun autre,
avec son esprit si profondément philosophique, Léonard enfermait dans ses oeuvres, et dont à son
exemple, et en l'étudiant, il voudrait s’assurer le bénéfice. C'est avec un pareil désir de s’instruire
qu’il consulte aussi les gravures des artistes allemands ou de l’école primitive des Flandres, et,
dans ses cartons, se rencontrent les œuvres d’Albert Dürer, de Cranach, de Schoengauer et
d’Holbein, à côté de celles de Lucas de Leyde, de Brueghel, Goltzius, A. Bloemaert, etc. En
quête d’enseignements, il a également à cœur de connaître tout ce que, de son temps, on sait
de l’antiquité, et, outre les statues ou les moulages d’œuvres grecques ou romaines qu’il possède,
il a dans ses portefeuilles de nombreux dessins et des gravures d'après des statues ou des édifices
anciens. Mais ce n’est pas encore assez, et avec son insatiable curiosité, en dehors même de l'art
européen, il soupçonne des horizons nouveaux et des régions jusqu'alors inexplorées. Il regarde
du côté de l’Inde et de toutes ces contrées mystérieuses où les hardis navigateurs de la Hollande
viennent d’aborder et d’ouvrir des comptoirs. Sans parler d’une foule d’objets curieux rapportés
de ces lointains pays, il a dans ses collections des miniatures persanes ou indoues dont l’étran-
geté le séduit. Il étudie à diverses reprises cet art à la fois primitif et raffiné, et au Louvre, au
British Muséum, chez MM. Bonnat, Heseltine et Salting, on peut voir, parmi les copies qu’il a
faites de ces miniatures, un rajah coiffé d'un casque, assis sur son trône et entouré de ses
courtisans ; un jeune prince à cheval, le faucon au poing, partant pour la chasse, etc. C’étaient
là, alors, des révélations inédites, mais bien faites pour plaire à Rembrandt. Nul doute qu’il
eut été plus ravi encore s’il avait pu voir quelques-uns de ces dessins japonais dont il semble
avoir eu le pressentiment, car dans ses croquis de paysages et dans plusieurs de ses eaux-fortes
il montre lui-même ce sens exquis des silhouettes, cette ingénieuse répartition des masses et
cette manière spirituelle et imprévue de comprendre la nature, qui ont tant ému nos artistes
contemporains. Rembrandt, dans cette voie, peut être compté parmi les précurseurs, et il a été,
à son insu, le premier des japonisants.
Le maître, on le voit, ne néglige rien de ce qui peut servir à son instruction et lui apporter
un enseignement; mais il garde entière son originalité. Les dessins faits par lui diffèrent,
d'ailleurs, autant par les procédés employés que par leur degré d'achèvement. Tantôt expéditifs
et très sommaires, ce ne sont que des notes jetées en courant sur le papier; ou bien leur exécu-
tion a été poussée très loin et les moindres détails y sont soigneusement précisés. En voici
d'apparence correcte et très posée, tracés d’une main sûre, avec une telle netteté qu’on les
croirait faits d’après nature. D’autres sont véhéments, tumultueux, désordonnés, comme cette
Montée au Calvaire (du Cabinet de Berlin), avec le Christ succombant sous la croix, la Vierge
défaillante et la foule indifférente ou passionnée qui se presse autour d’eux. Ceux-ci, par leur
suite continue, forment, en quelque sorte, l’histoire d’une idée, depuis sa première apparition
jusqu’à son expression très arrêtée. Telle autre composition qui paraissait définitive a été reprise
et modifiée dans certaines de ses parties ou même entièrement remaniée ; car, suivant la remarque
d’Houbraken, il n’y a pas de maître qui ait tiré d’un même sujet autant de compositions absolu-
ment différentes. La progression même de son talent se retrouve dans ces dessins, et si, au
début, le pittoresque pur et le souci de la couleur locale y tiennent une place considérable, plus
tard ces visées deviennent pour lui tout à fait secondaires; elles cèdent le pas au désir d’exprimer
surtout des sentiments et de donner à ceux-ci toute leur éloquence. Il y a des œuvres de lui
qui sont capitales et pour lesquelles on ne connaît aucune préparation, tandis qu’il existe des
séries de dessins se rapportant à un même sujet qui n’a été traité ni dans un tableau, ni dans
une gravure.
D’autres informations ressortent encore pour nous de l’étude des dessins de Rembrandt.
L'ART.
d'une composition aussi remplie, c'était la complexité même des ressorts mis en jeu, la difficulté
de relier entre elles les figures secondaires et de les subordonner toutes à la figure principale,
celle du Christ, placé au centre. Frappé des moyens ingénieux par lesquels l'unité saisissante de
l’ensemble a été conservée, Rembrandt les met en évidence. Par des surcharges énergiquement
accusées, il insiste sur la direction de toutes ces lignes qui convergent vers le Christ et ramènent
forcément sur lui l’attention, dévoilant ainsi cette géométrie cachée que mieux qu’aucun autre,
avec son esprit si profondément philosophique, Léonard enfermait dans ses oeuvres, et dont à son
exemple, et en l'étudiant, il voudrait s’assurer le bénéfice. C'est avec un pareil désir de s’instruire
qu’il consulte aussi les gravures des artistes allemands ou de l’école primitive des Flandres, et,
dans ses cartons, se rencontrent les œuvres d’Albert Dürer, de Cranach, de Schoengauer et
d’Holbein, à côté de celles de Lucas de Leyde, de Brueghel, Goltzius, A. Bloemaert, etc. En
quête d’enseignements, il a également à cœur de connaître tout ce que, de son temps, on sait
de l’antiquité, et, outre les statues ou les moulages d’œuvres grecques ou romaines qu’il possède,
il a dans ses portefeuilles de nombreux dessins et des gravures d'après des statues ou des édifices
anciens. Mais ce n’est pas encore assez, et avec son insatiable curiosité, en dehors même de l'art
européen, il soupçonne des horizons nouveaux et des régions jusqu'alors inexplorées. Il regarde
du côté de l’Inde et de toutes ces contrées mystérieuses où les hardis navigateurs de la Hollande
viennent d’aborder et d’ouvrir des comptoirs. Sans parler d’une foule d’objets curieux rapportés
de ces lointains pays, il a dans ses collections des miniatures persanes ou indoues dont l’étran-
geté le séduit. Il étudie à diverses reprises cet art à la fois primitif et raffiné, et au Louvre, au
British Muséum, chez MM. Bonnat, Heseltine et Salting, on peut voir, parmi les copies qu’il a
faites de ces miniatures, un rajah coiffé d'un casque, assis sur son trône et entouré de ses
courtisans ; un jeune prince à cheval, le faucon au poing, partant pour la chasse, etc. C’étaient
là, alors, des révélations inédites, mais bien faites pour plaire à Rembrandt. Nul doute qu’il
eut été plus ravi encore s’il avait pu voir quelques-uns de ces dessins japonais dont il semble
avoir eu le pressentiment, car dans ses croquis de paysages et dans plusieurs de ses eaux-fortes
il montre lui-même ce sens exquis des silhouettes, cette ingénieuse répartition des masses et
cette manière spirituelle et imprévue de comprendre la nature, qui ont tant ému nos artistes
contemporains. Rembrandt, dans cette voie, peut être compté parmi les précurseurs, et il a été,
à son insu, le premier des japonisants.
Le maître, on le voit, ne néglige rien de ce qui peut servir à son instruction et lui apporter
un enseignement; mais il garde entière son originalité. Les dessins faits par lui diffèrent,
d'ailleurs, autant par les procédés employés que par leur degré d'achèvement. Tantôt expéditifs
et très sommaires, ce ne sont que des notes jetées en courant sur le papier; ou bien leur exécu-
tion a été poussée très loin et les moindres détails y sont soigneusement précisés. En voici
d'apparence correcte et très posée, tracés d’une main sûre, avec une telle netteté qu’on les
croirait faits d’après nature. D’autres sont véhéments, tumultueux, désordonnés, comme cette
Montée au Calvaire (du Cabinet de Berlin), avec le Christ succombant sous la croix, la Vierge
défaillante et la foule indifférente ou passionnée qui se presse autour d’eux. Ceux-ci, par leur
suite continue, forment, en quelque sorte, l’histoire d’une idée, depuis sa première apparition
jusqu’à son expression très arrêtée. Telle autre composition qui paraissait définitive a été reprise
et modifiée dans certaines de ses parties ou même entièrement remaniée ; car, suivant la remarque
d’Houbraken, il n’y a pas de maître qui ait tiré d’un même sujet autant de compositions absolu-
ment différentes. La progression même de son talent se retrouve dans ces dessins, et si, au
début, le pittoresque pur et le souci de la couleur locale y tiennent une place considérable, plus
tard ces visées deviennent pour lui tout à fait secondaires; elles cèdent le pas au désir d’exprimer
surtout des sentiments et de donner à ceux-ci toute leur éloquence. Il y a des œuvres de lui
qui sont capitales et pour lesquelles on ne connaît aucune préparation, tandis qu’il existe des
séries de dessins se rapportant à un même sujet qui n’a été traité ni dans un tableau, ni dans
une gravure.
D’autres informations ressortent encore pour nous de l’étude des dessins de Rembrandt.