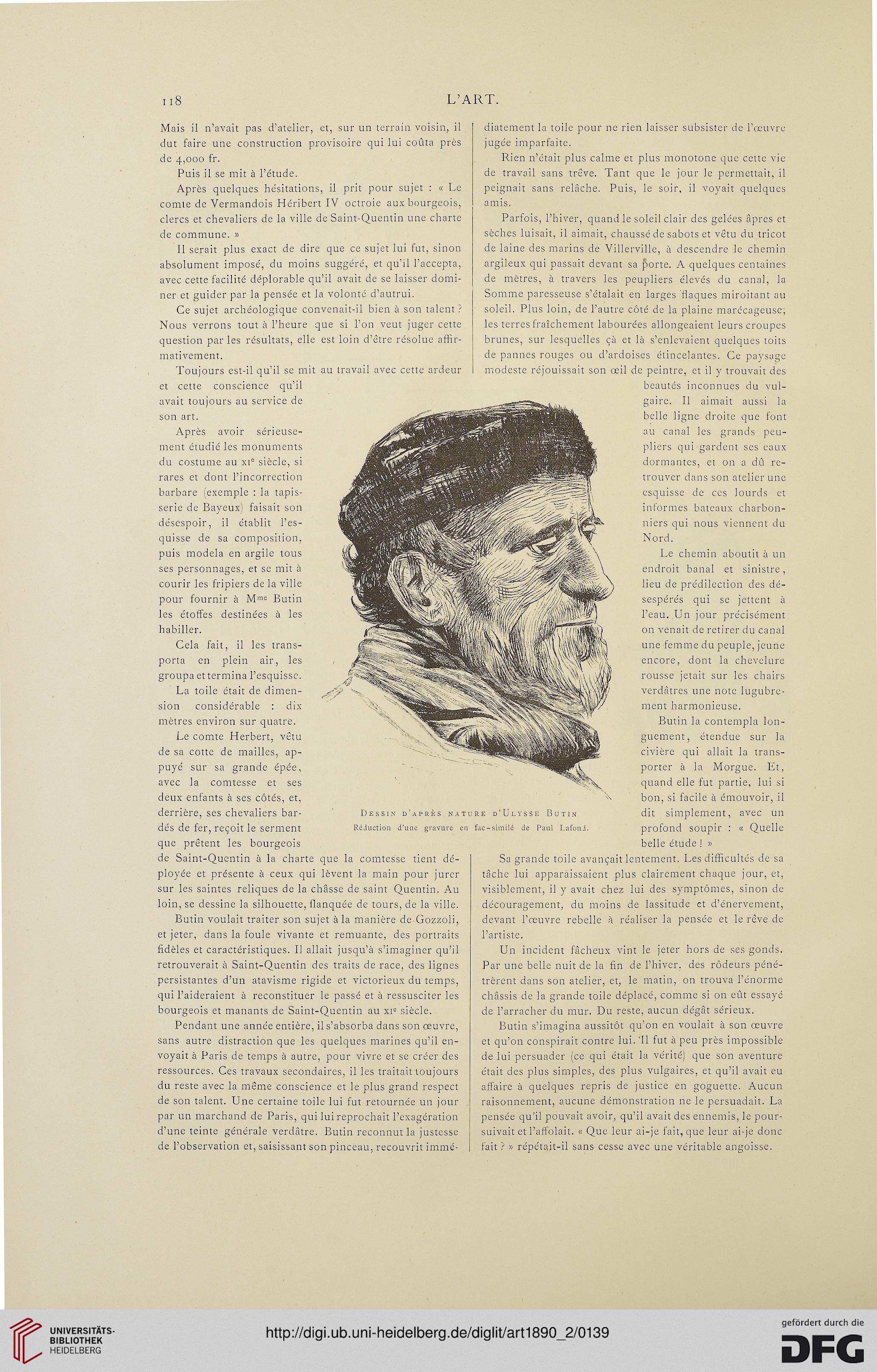L’ART.
Mais il n’avait pas d’atelier, et, sur un terrain voisin, il
dut faire une construction provisoire qui lui coûta près
de 4,000 fr.
Puis il se mit à l’étude.
Après quelques hésitations, il prit pour sujet : « Le
comte de Vermandois Héribert IV octroie aux bourgeois,
clercs et chevaliers de la ville de Saint-Quentin une charte
de commune. »
Il serait plus exact de dire que ce sujet lui fut, sinon
absolument imposé, du moins suggéré, et qu’il l’accepta,
avec cette facilité déplorable qu’il avait de se laisser domi-
ner et guider par la pensée et la volonté d’autrui.
Ce sujet archéologique convenait-il bien à son talent ?
Nous verrons tout à l’heure que si l’on veut juger cette
question par les résultats, elle est loin d’être résolue affir-
mativement.
Toujours est-il qu’il se mit au travail avec cette ardeur
et cette conscience qu’il
avait toujours au service de
son art.
Après avoir sérieuse-
ment étudié les monuments
du costume au xic siècle, si
rares et dont l’incorrection
barbare (exemple : la tapis-
serie de Bayeux) faisait son
désespoir, il établit l’es-
quisse de sa composition,
puis modela en argile tous
ses personnages, et se mit à
courir les fripiers de la ville
pour fournir à Mmc Butin
les étoffes destinées à les
habiller.
Cela fait, il les trans-
porta en plein air, les
groupa et termina l’esquisse.
La toile était de dimen-
sion considérable : dix
mètres environ sur quatre.
Le comte Herbert, vêtu
de sa cotte de mailles, ap-
puyé sur sa grande épée,
avec la comtesse et ses
deux enfants à ses côtés, et,
derrière, ses chevaliers bar-
dés de fer, reçoit le serment
que prêtent les bourgeois
de Saint-Quentin à la charte que la comtesse tient dé-
ployée et présente à ceux qui lèvent la main pour jurer
sur les saintes reliques de la châsse de saint Quentin. Au
loin, se dessine la silhouette, flanquée de tours, de la ville.
Butin voulait traiter son sujet à la manière de Gozzoli,
et jeter, dans la foule vivante et remuante, des portraits
fidèles et caractéristiques. Il allait jusqu’à s’imaginer qu’il
retrouverait à Saint-Quentin des traits de race, des lignes
persistantes d’un atavisme rigide et victorieux du temps,
qui l’aideraient à reconstituer le passé et à ressusciter les
bourgeois et manants de Saint-Quentin au xie siècle.
Pendant une année entière, il s’absorba dans son œuvre,
sans autre distraction que les quelques marines qu’il en-
voyait à Paris de temps à autre, pour vivre et se créer des
ressources. Ces travaux secondaires, il les traitait toujours
du reste avec la même conscience et le plus grand respect
de son talent. Une certaine toile lui fut retournée un jour
par un marchand de Paris, qui lui reprochait l’exagération
d’une teinte générale verdâtre. Butin reconnut la justesse
de l’observation et, saisissant son pinceau, recouvrit immé-
diatement la toile pour ne rien laisser subsister de l’œuvre
jugée imparfaite.
Rien n’était plus calme et plus monotone que cette vie
de travail sans trêve. Tant que le jour le permettait, il
peignait sans relâche. Puis, le soir, il voyait quelques
amis.
Parfois, l’hiver, quand le soleil clair des gelées âpres et
sèches luisait, il aimait, chaussé de sabots et vêtu du tricot
de laine des marins de Villerville, à descendre le chemin
argileux qui passait devant sa porte. A quelques centaines
de mètres, à travers les peupliers élevés du canal, la
Somme paresseuse s’étalait en larges flaques miroitant au
soleil. Plus loin, de l’autre côté de la plaine marécageuse,
les terres fraîchement labourées allongeaient leurs croupes
brunes, sur lesquelles çà et là s’enlevaient quelques toits
de pannes rouges ou d’ardoises étincelantes. Ce paysage
modeste réjouissait son œil de peintre, et il y trouvait des
beautés inconnues du vul-
gaire. Il aimait aussi la
belle ligne droite que font
au canal les grands peu-
pliers qui gardent ses eaux
dormantes, et on a dû re-
trouver dans son atelier une
esquisse de ces lourds et
informes bateaux charbon-
niers qui nous viennent du
Nord.
Le chemin aboutit à un
endroit banal et sinistre,
lieu de prédilection des dé-
sespérés qui se jettent à
l’eau. Un jour précisément
on venait de retirer du canal
une femme du peuple, jeune
encore, dont la chevelure
rousse jetait sur les chairs
verdâtres une note lugubre-
ment harmonieuse.
Butin la contempla lon-
guement, étendue sur la
civière qui allait la trans-
porter à la Morgue. Et,
quand elle fut partie, lui si
bon, si facile à émouvoir, il
dit simplement, avec un
profond soupir : « Quelle
belle étude ! »
Sa grande toile avançait lentement. Les difficultés de sa
tâche lui apparaissaient plus clairement chaque jour, et,
visiblement, il y avait chez lui des symptômes, sinon de
découragement, du moins de lassitude et d’énervement,
devant l’œuvre rebelle à réaliser la pensée et le rêve de
l’artiste.
Un incident fâcheux vint le jeter hors de ses gonds.
Par une belle nuit de la fin de l’hiver, des rôdeurs péné-
trèrent dans son atelier, et, le matin, on trouva l’énorme
châssis de la grande toile déplacé, comme si on eût essayé
de l’arracher du mur. Du reste, aucun dégât sérieux.
Butin s’imagina aussitôt qu’on en voulait à son œuvre
et qu’on conspirait contre lui. 'Il fut à peu près impossible
de lui persuader (ce qui était la vérité) que son aventure
était des plus simples, des plus vulgaires, et qu’il avait eu
affaire à quelques repris de justice en goguette. Aucun
raisonnement, aucune démonstration ne le persuadait. La
pensée qu’il pouvait avoir, qu’il avait des ennemis, le pour-
suivait et l’affolait. « Que leur ai-je fait, que leur ai-je donc
fait ? » répétait-il sans cesse avec une véritable angoisse.
N
Dessin d’après nature d'Ulysse Butin
Réduction d’une gravure en fac-similé de Paul Lafond.
Mais il n’avait pas d’atelier, et, sur un terrain voisin, il
dut faire une construction provisoire qui lui coûta près
de 4,000 fr.
Puis il se mit à l’étude.
Après quelques hésitations, il prit pour sujet : « Le
comte de Vermandois Héribert IV octroie aux bourgeois,
clercs et chevaliers de la ville de Saint-Quentin une charte
de commune. »
Il serait plus exact de dire que ce sujet lui fut, sinon
absolument imposé, du moins suggéré, et qu’il l’accepta,
avec cette facilité déplorable qu’il avait de se laisser domi-
ner et guider par la pensée et la volonté d’autrui.
Ce sujet archéologique convenait-il bien à son talent ?
Nous verrons tout à l’heure que si l’on veut juger cette
question par les résultats, elle est loin d’être résolue affir-
mativement.
Toujours est-il qu’il se mit au travail avec cette ardeur
et cette conscience qu’il
avait toujours au service de
son art.
Après avoir sérieuse-
ment étudié les monuments
du costume au xic siècle, si
rares et dont l’incorrection
barbare (exemple : la tapis-
serie de Bayeux) faisait son
désespoir, il établit l’es-
quisse de sa composition,
puis modela en argile tous
ses personnages, et se mit à
courir les fripiers de la ville
pour fournir à Mmc Butin
les étoffes destinées à les
habiller.
Cela fait, il les trans-
porta en plein air, les
groupa et termina l’esquisse.
La toile était de dimen-
sion considérable : dix
mètres environ sur quatre.
Le comte Herbert, vêtu
de sa cotte de mailles, ap-
puyé sur sa grande épée,
avec la comtesse et ses
deux enfants à ses côtés, et,
derrière, ses chevaliers bar-
dés de fer, reçoit le serment
que prêtent les bourgeois
de Saint-Quentin à la charte que la comtesse tient dé-
ployée et présente à ceux qui lèvent la main pour jurer
sur les saintes reliques de la châsse de saint Quentin. Au
loin, se dessine la silhouette, flanquée de tours, de la ville.
Butin voulait traiter son sujet à la manière de Gozzoli,
et jeter, dans la foule vivante et remuante, des portraits
fidèles et caractéristiques. Il allait jusqu’à s’imaginer qu’il
retrouverait à Saint-Quentin des traits de race, des lignes
persistantes d’un atavisme rigide et victorieux du temps,
qui l’aideraient à reconstituer le passé et à ressusciter les
bourgeois et manants de Saint-Quentin au xie siècle.
Pendant une année entière, il s’absorba dans son œuvre,
sans autre distraction que les quelques marines qu’il en-
voyait à Paris de temps à autre, pour vivre et se créer des
ressources. Ces travaux secondaires, il les traitait toujours
du reste avec la même conscience et le plus grand respect
de son talent. Une certaine toile lui fut retournée un jour
par un marchand de Paris, qui lui reprochait l’exagération
d’une teinte générale verdâtre. Butin reconnut la justesse
de l’observation et, saisissant son pinceau, recouvrit immé-
diatement la toile pour ne rien laisser subsister de l’œuvre
jugée imparfaite.
Rien n’était plus calme et plus monotone que cette vie
de travail sans trêve. Tant que le jour le permettait, il
peignait sans relâche. Puis, le soir, il voyait quelques
amis.
Parfois, l’hiver, quand le soleil clair des gelées âpres et
sèches luisait, il aimait, chaussé de sabots et vêtu du tricot
de laine des marins de Villerville, à descendre le chemin
argileux qui passait devant sa porte. A quelques centaines
de mètres, à travers les peupliers élevés du canal, la
Somme paresseuse s’étalait en larges flaques miroitant au
soleil. Plus loin, de l’autre côté de la plaine marécageuse,
les terres fraîchement labourées allongeaient leurs croupes
brunes, sur lesquelles çà et là s’enlevaient quelques toits
de pannes rouges ou d’ardoises étincelantes. Ce paysage
modeste réjouissait son œil de peintre, et il y trouvait des
beautés inconnues du vul-
gaire. Il aimait aussi la
belle ligne droite que font
au canal les grands peu-
pliers qui gardent ses eaux
dormantes, et on a dû re-
trouver dans son atelier une
esquisse de ces lourds et
informes bateaux charbon-
niers qui nous viennent du
Nord.
Le chemin aboutit à un
endroit banal et sinistre,
lieu de prédilection des dé-
sespérés qui se jettent à
l’eau. Un jour précisément
on venait de retirer du canal
une femme du peuple, jeune
encore, dont la chevelure
rousse jetait sur les chairs
verdâtres une note lugubre-
ment harmonieuse.
Butin la contempla lon-
guement, étendue sur la
civière qui allait la trans-
porter à la Morgue. Et,
quand elle fut partie, lui si
bon, si facile à émouvoir, il
dit simplement, avec un
profond soupir : « Quelle
belle étude ! »
Sa grande toile avançait lentement. Les difficultés de sa
tâche lui apparaissaient plus clairement chaque jour, et,
visiblement, il y avait chez lui des symptômes, sinon de
découragement, du moins de lassitude et d’énervement,
devant l’œuvre rebelle à réaliser la pensée et le rêve de
l’artiste.
Un incident fâcheux vint le jeter hors de ses gonds.
Par une belle nuit de la fin de l’hiver, des rôdeurs péné-
trèrent dans son atelier, et, le matin, on trouva l’énorme
châssis de la grande toile déplacé, comme si on eût essayé
de l’arracher du mur. Du reste, aucun dégât sérieux.
Butin s’imagina aussitôt qu’on en voulait à son œuvre
et qu’on conspirait contre lui. 'Il fut à peu près impossible
de lui persuader (ce qui était la vérité) que son aventure
était des plus simples, des plus vulgaires, et qu’il avait eu
affaire à quelques repris de justice en goguette. Aucun
raisonnement, aucune démonstration ne le persuadait. La
pensée qu’il pouvait avoir, qu’il avait des ennemis, le pour-
suivait et l’affolait. « Que leur ai-je fait, que leur ai-je donc
fait ? » répétait-il sans cesse avec une véritable angoisse.
N
Dessin d’après nature d'Ulysse Butin
Réduction d’une gravure en fac-similé de Paul Lafond.