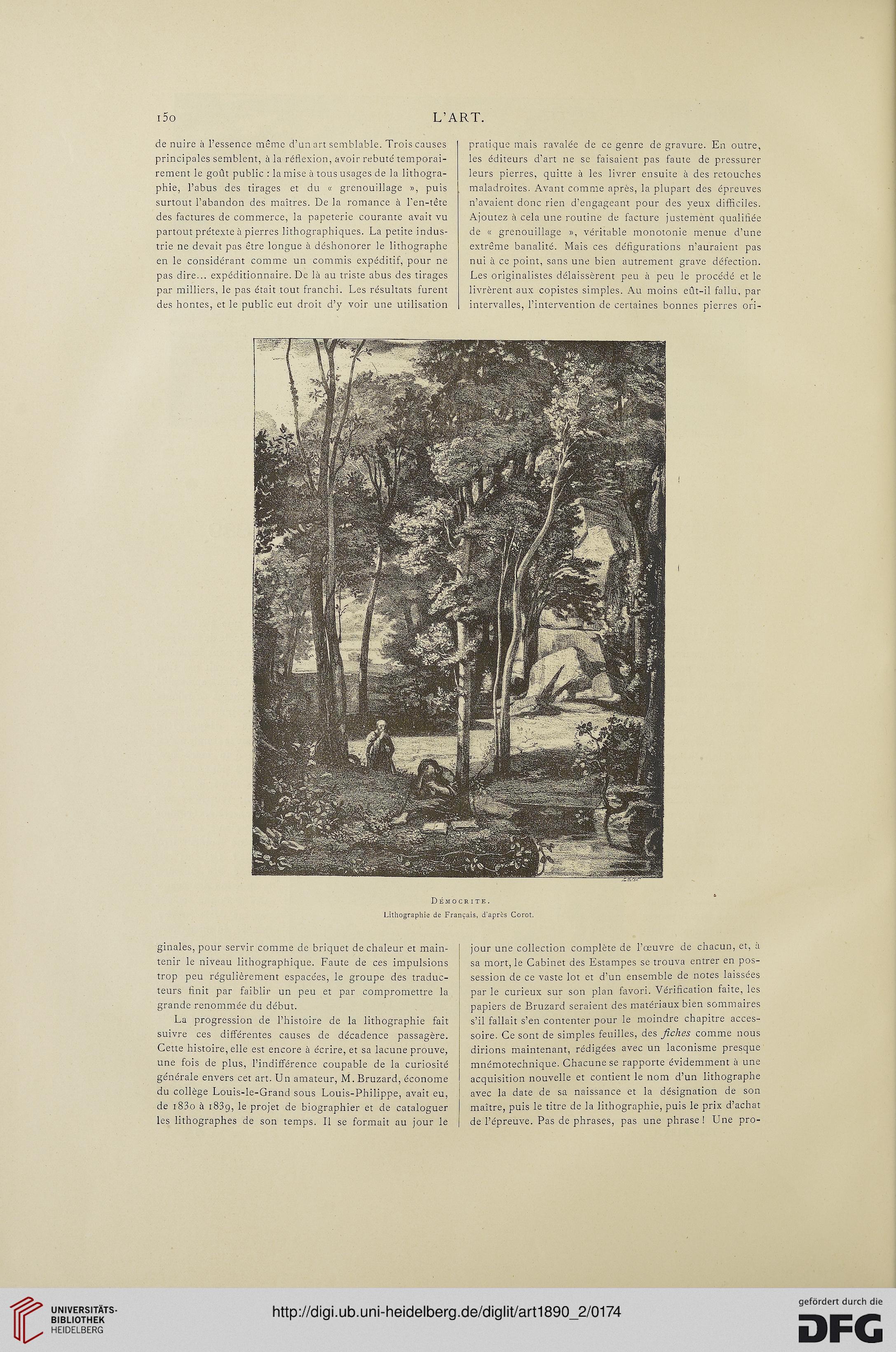L’ART.
15o
de nuire à l’essence même d’un art semblable. Trois causes
principales semblent, à la réflexion, avoir rebuté temporai-
rement le goût public : la mise à tous usages de la lithogra-
phie, l’abus des tirages et du « grenouillage », puis
surtout l’abandon des maîtres. De la romance à l'en-tête
des factures de commerce, la papeterie courante avait vu
partout prétexte à pierres lithographiques. La petite indus-
trie ne devait pas être longue à déshonorer le lithographe
en le considérant comme un commis expéditif, pour ne
pas dire... expéditionnaire. De là au triste abus des tirages
par milliers, le pas était tout franchi. Les résultats furent
des hontes, et le public eut droit d’y voir une utilisation
pratique mais ravalée de ce genre de gravure. En outre,
les éditeurs d’art ne se faisaient pas faute de pressurer
leurs pierres, quitte à les livrer ensuite à des retouches
maladroites. Avant comme après, la plupart des épreuves
n’avaient donc rien d’engageant pour des yeux difficiles.
Ajoutez à cela une routine de facture justement qualifiée
de « grenouillage », véritable monotonie menue d’une
extrême banalité. Mais ces défigurations n’auraient pas
nui à ce point, sans une bien autrement grave défection.
Les originalistes délaissèrent peu à peu le procédé et le
livrèrent aux copistes simples. Au moins eût-il fallu, par
intervalles, l’intervention de certaines bonnes pierres ori-
Dèmocrite.
Lithographie de Français, d'après Corot.
ginales, pour servir comme de briquet de chaleur et main-
tenir le niveau lithographique. Faute de ces impulsions
trop peu régulièrement espacées, le groupe des traduc-
teurs finit par faiblir un peu et par compromettre la
grande renommée du début.
La progression de l’histoire de la lithographie fait
suivre ces différentes causes de décadence passagère.
Cette histoire, elle est encore à écrire, et sa lacune prouve,
une fois de plus, l’indifférence coupable de la curiosité
générale envers cet art. Un amateur, M. Bruzard, économe
du collège Louis-le-Grand sous Louis-Philippe, avait eu,
de i83o à 1839, le projet de biographier et de cataloguer
les lithographes de son temps. Il se formait au jour le
jour une collection complète de l’œuvre de chacun, et, a
sa mort, le Cabinet des Estampes se trouva entrer en pos-
session de ce vaste lot et d’un ensemble de notes laissées
par le curieux sur son plan favori. Vérification faite, les
papiers de Bruzard seraient des matériaux bien sommaires
s’il fallait s’en contenter pour le moindre chapitre acces-
soire. Ce sont de simples feuilles, des fiches comme nous
dirions maintenant, rédigées avec un laconisme presque
mnémotechnique. Chacune se rapporte évidemment à une
acquisition nouvelle et contient le nom d’un lithographe
avec la date de sa naissance et la désignation de son
maître, puis le titre de la lithographie, puis le prix d’achat
de l’épreuve. Pas de phrases, pas une phrase! Une pro-
15o
de nuire à l’essence même d’un art semblable. Trois causes
principales semblent, à la réflexion, avoir rebuté temporai-
rement le goût public : la mise à tous usages de la lithogra-
phie, l’abus des tirages et du « grenouillage », puis
surtout l’abandon des maîtres. De la romance à l'en-tête
des factures de commerce, la papeterie courante avait vu
partout prétexte à pierres lithographiques. La petite indus-
trie ne devait pas être longue à déshonorer le lithographe
en le considérant comme un commis expéditif, pour ne
pas dire... expéditionnaire. De là au triste abus des tirages
par milliers, le pas était tout franchi. Les résultats furent
des hontes, et le public eut droit d’y voir une utilisation
pratique mais ravalée de ce genre de gravure. En outre,
les éditeurs d’art ne se faisaient pas faute de pressurer
leurs pierres, quitte à les livrer ensuite à des retouches
maladroites. Avant comme après, la plupart des épreuves
n’avaient donc rien d’engageant pour des yeux difficiles.
Ajoutez à cela une routine de facture justement qualifiée
de « grenouillage », véritable monotonie menue d’une
extrême banalité. Mais ces défigurations n’auraient pas
nui à ce point, sans une bien autrement grave défection.
Les originalistes délaissèrent peu à peu le procédé et le
livrèrent aux copistes simples. Au moins eût-il fallu, par
intervalles, l’intervention de certaines bonnes pierres ori-
Dèmocrite.
Lithographie de Français, d'après Corot.
ginales, pour servir comme de briquet de chaleur et main-
tenir le niveau lithographique. Faute de ces impulsions
trop peu régulièrement espacées, le groupe des traduc-
teurs finit par faiblir un peu et par compromettre la
grande renommée du début.
La progression de l’histoire de la lithographie fait
suivre ces différentes causes de décadence passagère.
Cette histoire, elle est encore à écrire, et sa lacune prouve,
une fois de plus, l’indifférence coupable de la curiosité
générale envers cet art. Un amateur, M. Bruzard, économe
du collège Louis-le-Grand sous Louis-Philippe, avait eu,
de i83o à 1839, le projet de biographier et de cataloguer
les lithographes de son temps. Il se formait au jour le
jour une collection complète de l’œuvre de chacun, et, a
sa mort, le Cabinet des Estampes se trouva entrer en pos-
session de ce vaste lot et d’un ensemble de notes laissées
par le curieux sur son plan favori. Vérification faite, les
papiers de Bruzard seraient des matériaux bien sommaires
s’il fallait s’en contenter pour le moindre chapitre acces-
soire. Ce sont de simples feuilles, des fiches comme nous
dirions maintenant, rédigées avec un laconisme presque
mnémotechnique. Chacune se rapporte évidemment à une
acquisition nouvelle et contient le nom d’un lithographe
avec la date de sa naissance et la désignation de son
maître, puis le titre de la lithographie, puis le prix d’achat
de l’épreuve. Pas de phrases, pas une phrase! Une pro-