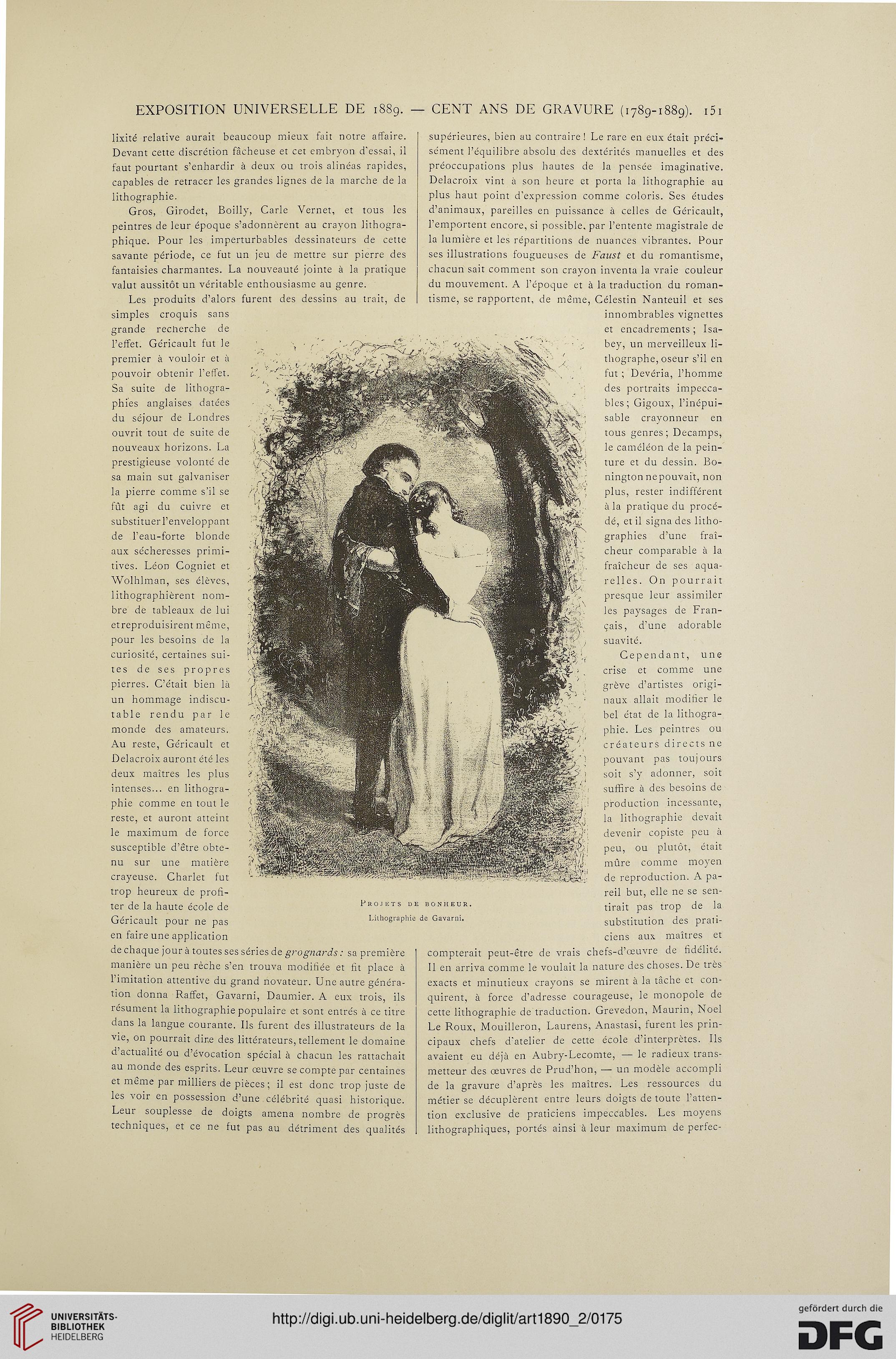EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889.
lixité relative aurait beaucoup mieux fait notre affaire.
Devant cette discrétion fâcheuse et cet embryon d’essai, il
faut pourtant s’enhardir à deux ou trois alinéas rapides,
capables de retracer les grandes lignes de la marche de la
lithographie.
Gros, Girodet, Boilly, Carie Vernet, et tous les
peintres de leur époque s’adonnèrent au crayon lithogra-
phique. Pour les imperturbables dessinateurs de cette
savante période, ce fut un jeu de mettre sur pierre des
fantaisies charmantes. La nouveauté jointe à la pratique
valut aussitôt un véritable enthousiasme au genre.
Les produits d’alors furent des dessins au trait, de
simples croquis sans
grande recherche de
l’effet. Géricault fut le
premier à vouloir et à
pouvoir obtenir l’effet.
Sa suite de lithogra-
phies anglaises datées
du séjour de Londres
ouvrit tout de suite de
nouveaux horizons. La
prestigieuse volonté de
sa main sut galvaniser
la pierre comme s’il se
fût agi du cuivre et
substituer l’enveloppant
de l’eau-forte blonde
aux sécheresses primi-
tives. Léon Cogniet et
Wolhlman, ses élèves,
lithographièrent nom-
bre de tableaux de lui
etreproduisirent même,
pour les besoins de la
curiosité, certaines sui-
tes de ses propres
pierres. C’était bien là
un hommage indiscu-
table rendu par le
monde des amateurs.
Au reste, Géricault et
Delacroix auront été les
deux maîtres les plus
intenses... en lithogra-
phie comme en tout le
reste, et auront atteint
le maximum de force
susceptible d’être obte-
nu sur une matière
crayeuse. Charlet fut
trop heureux de profi-
ter de la haute école de
Géricault pour ne pas
en faire une application
de chaque jour à toutes ses séries de grognards : sa première
manière un peu rèche s’en trouva modifiée et fit place à
l’imitation attentive du grand novateur. Une autre généra-
tion donna Raffet, Gavarni, Daumier. A eux trois, ils
résument la lithographie populaire et sont entrés à ce titre
dans la langue courante. Ils furent des illustrateurs de la
vie, on pourrait dire des littérateurs, tellement le domaine
d actualité ou d’évocation spécial à chacun les rattachait
au monde des esprits. Leur œuvre se compte par centaines
et même par milliers de pièces; il est donc trop juste de
les voir en possession d’une célébrité quasi historique.
Leui souplesse de doigts amena nombre de progrès
techniques, et ce ne fut pas au détriment des qualités
— CENT ANS DE GRAVURE (1789-1889). i5i
supérieures, bien au contraire! Le rare en eux était préci-
sément l’équilibre absolu des dextérités manuelles et des
préoccupations plus hautes de la pensée imaginative.
Delacroix vint à son heure et porta la lithographie au
plus haut point d’expression comme coloris. Ses études
d’animaux, pareilles en puissance à celles de Géricault,
l’emportent encore, si possible, par l’entente magistrale de
la lumière et les répartitions de nuances vibrantes. Pour
ses illustrations fougueuses de Faust et du romantisme,
chacun sait comment son crayon inventa la vraie couleur
du mouvement. A l’époque et à la traduction du roman-
tisme, se rapportent, de même, Célestin Nanteuil et ses
innombrables vignettes
et encadrements ; Isa-
bey, un merveilleux li-
thographe, oseur s’il en
fut ; Devéria, l’homme
des portraits impecca-
bles; Gigoux, l’inépui-
sable crayonneur en
tous genres; Decamps,
le caméléon de la pein-
ture et du dessin. Bo-
nington ne pouvait, non
plus, rester indifférent
à la pratique du procé-
dé, et il signa des litho-
graphies d’une fraî-
cheur comparable à la
fraîcheur de ses aqua-
relles. On pourrait
presque leur assimiler
les paysages de Fran-
çais, d'une adorable
suavité.
Cependant, une
crise et comme une
grève d’artistes origi-
naux allait modifier le
bel état de la lithogra-
phie. Les peintres ou
créateurs directs ne
pouvant pas toujours
soit s’y adonner, soit
suffire à des besoins de
production incessante,
la lithographie devait
devenir copiste peu à
peu, ou plutôt, était
mûre comme moyen
de reproduction. A pa-
reil but, elle ne se sen-
tirait pas trop de la
substitution des prati-
ciens aux maîtres et
compterait peut-être de vrais chefs-d’œuvre de fidélité.
Il en arriva comme le voulait la nature des choses. De très
exacts et minutieux crayons se mirent à la tâche et con-
quirent, à force d’adresse courageuse, le monopole de
cette lithographie de traduction. Grevedon, Maurin, Noël
Le Roux, Mouilleron, Laurens, Anastasi, furent les prin-
cipaux chefs d'atelier de cette école d’interprètes. Ils
avaient eu déjà en Aubry-Lecomte, — le radieux trans-
metteur des œuvres de Prud’hon, — un modèle accompli
de la gravure d’après les maîtres. Les ressources du
métier se décuplèrent entre leurs doigts de toute l’atten-
tion exclusive de praticiens impeccables. Les moyens
lithographiques, portés ainsi à leur maximum de perfec-
PROJETS DE BONHEUR.
Lithographie de Gavarni.
lixité relative aurait beaucoup mieux fait notre affaire.
Devant cette discrétion fâcheuse et cet embryon d’essai, il
faut pourtant s’enhardir à deux ou trois alinéas rapides,
capables de retracer les grandes lignes de la marche de la
lithographie.
Gros, Girodet, Boilly, Carie Vernet, et tous les
peintres de leur époque s’adonnèrent au crayon lithogra-
phique. Pour les imperturbables dessinateurs de cette
savante période, ce fut un jeu de mettre sur pierre des
fantaisies charmantes. La nouveauté jointe à la pratique
valut aussitôt un véritable enthousiasme au genre.
Les produits d’alors furent des dessins au trait, de
simples croquis sans
grande recherche de
l’effet. Géricault fut le
premier à vouloir et à
pouvoir obtenir l’effet.
Sa suite de lithogra-
phies anglaises datées
du séjour de Londres
ouvrit tout de suite de
nouveaux horizons. La
prestigieuse volonté de
sa main sut galvaniser
la pierre comme s’il se
fût agi du cuivre et
substituer l’enveloppant
de l’eau-forte blonde
aux sécheresses primi-
tives. Léon Cogniet et
Wolhlman, ses élèves,
lithographièrent nom-
bre de tableaux de lui
etreproduisirent même,
pour les besoins de la
curiosité, certaines sui-
tes de ses propres
pierres. C’était bien là
un hommage indiscu-
table rendu par le
monde des amateurs.
Au reste, Géricault et
Delacroix auront été les
deux maîtres les plus
intenses... en lithogra-
phie comme en tout le
reste, et auront atteint
le maximum de force
susceptible d’être obte-
nu sur une matière
crayeuse. Charlet fut
trop heureux de profi-
ter de la haute école de
Géricault pour ne pas
en faire une application
de chaque jour à toutes ses séries de grognards : sa première
manière un peu rèche s’en trouva modifiée et fit place à
l’imitation attentive du grand novateur. Une autre généra-
tion donna Raffet, Gavarni, Daumier. A eux trois, ils
résument la lithographie populaire et sont entrés à ce titre
dans la langue courante. Ils furent des illustrateurs de la
vie, on pourrait dire des littérateurs, tellement le domaine
d actualité ou d’évocation spécial à chacun les rattachait
au monde des esprits. Leur œuvre se compte par centaines
et même par milliers de pièces; il est donc trop juste de
les voir en possession d’une célébrité quasi historique.
Leui souplesse de doigts amena nombre de progrès
techniques, et ce ne fut pas au détriment des qualités
— CENT ANS DE GRAVURE (1789-1889). i5i
supérieures, bien au contraire! Le rare en eux était préci-
sément l’équilibre absolu des dextérités manuelles et des
préoccupations plus hautes de la pensée imaginative.
Delacroix vint à son heure et porta la lithographie au
plus haut point d’expression comme coloris. Ses études
d’animaux, pareilles en puissance à celles de Géricault,
l’emportent encore, si possible, par l’entente magistrale de
la lumière et les répartitions de nuances vibrantes. Pour
ses illustrations fougueuses de Faust et du romantisme,
chacun sait comment son crayon inventa la vraie couleur
du mouvement. A l’époque et à la traduction du roman-
tisme, se rapportent, de même, Célestin Nanteuil et ses
innombrables vignettes
et encadrements ; Isa-
bey, un merveilleux li-
thographe, oseur s’il en
fut ; Devéria, l’homme
des portraits impecca-
bles; Gigoux, l’inépui-
sable crayonneur en
tous genres; Decamps,
le caméléon de la pein-
ture et du dessin. Bo-
nington ne pouvait, non
plus, rester indifférent
à la pratique du procé-
dé, et il signa des litho-
graphies d’une fraî-
cheur comparable à la
fraîcheur de ses aqua-
relles. On pourrait
presque leur assimiler
les paysages de Fran-
çais, d'une adorable
suavité.
Cependant, une
crise et comme une
grève d’artistes origi-
naux allait modifier le
bel état de la lithogra-
phie. Les peintres ou
créateurs directs ne
pouvant pas toujours
soit s’y adonner, soit
suffire à des besoins de
production incessante,
la lithographie devait
devenir copiste peu à
peu, ou plutôt, était
mûre comme moyen
de reproduction. A pa-
reil but, elle ne se sen-
tirait pas trop de la
substitution des prati-
ciens aux maîtres et
compterait peut-être de vrais chefs-d’œuvre de fidélité.
Il en arriva comme le voulait la nature des choses. De très
exacts et minutieux crayons se mirent à la tâche et con-
quirent, à force d’adresse courageuse, le monopole de
cette lithographie de traduction. Grevedon, Maurin, Noël
Le Roux, Mouilleron, Laurens, Anastasi, furent les prin-
cipaux chefs d'atelier de cette école d’interprètes. Ils
avaient eu déjà en Aubry-Lecomte, — le radieux trans-
metteur des œuvres de Prud’hon, — un modèle accompli
de la gravure d’après les maîtres. Les ressources du
métier se décuplèrent entre leurs doigts de toute l’atten-
tion exclusive de praticiens impeccables. Les moyens
lithographiques, portés ainsi à leur maximum de perfec-
PROJETS DE BONHEUR.
Lithographie de Gavarni.