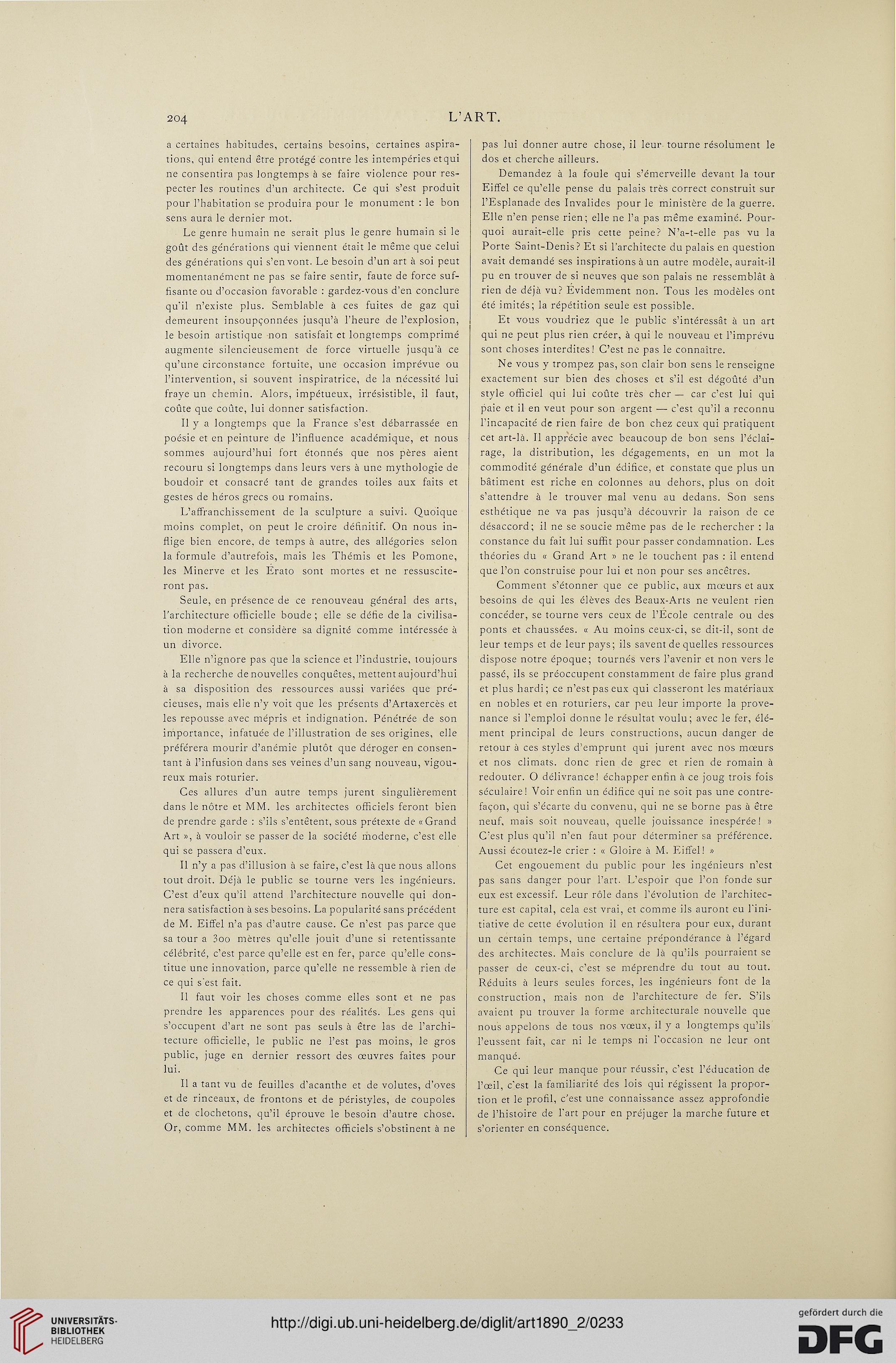204
L’ART.
a certaines habitudes, certains besoins, certaines aspira-
tions, qui entend être protégé contre les intempéries etqui
ne consentira pas longtemps à se faire violence pour res-
pecter les routines d’un architecte. Ce qui s’est produit
pour l’habitation se produira pour le monument : le bon
sens aura le dernier mot.
Le genre humain ne serait plus le genre humain si le
goût des générations qui viennent était le même que celui
des générations qui s’en vont. Le besoin d’un art à soi peut
momentanément ne pas se faire sentir, faute de force suf-
fisante ou d’occasion favorable : gardez-vous d’en conclure
qu’il n’existe plus. Semblable à ces fuites de gaz qui
demeurent insoupçonnées jusqu’à l’heure de l’explosion,
le besoin artistique non satisfait et longtemps comprimé
augmente silencieusement de force virtuelle jusqu’à ce
qu’une circonstance fortuite, une occasion imprévue ou
l’intervention, si souvent inspiratrice, de la nécessité lui
fraye un chemin. Alors, impétueux, irrésistible, il faut,
coûte que coûte, lui donner satisfaction.
Il y a longtemps que la France s’est débarrassée en
poésie et en peinture de l’influence académique, et nous
sommes aujourd’hui fort étonnés que nos pères aient
recouru si longtemps dans leurs vers à une mythologie de
boudoir et consacré tant de grandes toiles aux faits et
gestes de héros grecs ou romains.
L’affranchissement de la sculpture a suivi. Quoique
moins complet, on peut le croire définitif. On nous in-
flige bien encore, de temps à autre, des allégories selon
la formule d’autrefois, mais les Thémis et les Pomone,
les Minerve et les Erato sont mortes et ne ressuscite-
ront pas.
Seule, en présence de ce renouveau général des arts,
l’architecture officielle boude ; elle se défie de la civilisa-
tion moderne et considère sa dignité comme intéressée à
un divorce.
Elle n’ignore pas que la science et l’industrie, toujours
à la recherche de nouvelles conquêtes, mettent aujourd’hui
à sa disposition des ressources aussi variées que pré-
cieuses, mais elle n’y voit que les présents d’Artaxercès et
les repousse avec mépris et indignation. Pénétrée de son
importance, infatuée de l’illustration de ses origines, elle
préférera mourir d’anémie plutôt que déroger en consen-
tant à l’infusion dans ses veines d’un sang nouveau, vigou-
reux mais roturier.
Ces allures d’un autre temps jurent singulièrement
dans le nôtre et MM. les architectes officiels feront bien
de prendre garde : s’ils s’entêtent, sous prétexte de «Grand
Art », à vouloir se passer de la société moderne, c’est elle
qui se passera d’eux.
Il n’y a pas d’illusion à se faire, c’est là que nous allons
tout droit. Déjà le public se tourne vers les ingénieurs.
C’est d’eux qu’il attend l’architecture nouvelle qui don-
nera satisfaction à ses besoins. La popularité sans précédent
de M. Eiffel n’a pas d’autre cause. Ce n’est pas parce que
sa tour a 3oo mètres qu’elle jouit d’une si retentissante
célébrité, c’est parce qu’elle est en fer, parce qu’elle cons-
titue une innovation, parce qu’elle ne ressemble à rien de
ce qui s'est fait.
Il faut voir les choses comme elles sont et ne pas
prendre les apparences pour des réalités. Les gens qui
s’occupent d’art ne sont pas seuls à être las de l’archi-
tecture officielle, le public ne l’est pas moins, le gros
public, juge en dernier ressort des œuvres faites pour
lui.
Il a tant vu de feuilles d’acanthe et de volutes, d’oves
et de rinceaux, de frontons et de péristyles, de coupoles
et de clochetons, qu’il éprouve le besoin d’autre chose.
Or, comme MM. les architectes officiels s’obstinent à ne
pas lui donner autre chose, il leur tourne résolument le
dos et cherche ailleurs.
Demandez à la foule qui s’émerveille devant la tour
Eiffel ce qu’elle pense du palais très correct construit sur
l’Esplanade des Invalides pour le ministère de la guerre.
Elle n’en pense rien; elle ne l’a pas même examiné. Pour-
quoi aurait-elle pris cette peine? N’a-t-elle pas vu la
Porte Saint-Denis? Et si l’architecte du palais en question
avait demandé ses inspirations à un autre modèle, aurait-il
pu en trouver de si neuves que son palais ne ressemblât à
rien de déjà vu? Evidemment non. Tous les modèles ont
été imités; la répétition seule est possible.
Et vous voudriez que le public s’intéressât à un art
qui ne peut plus rien créer, à qui le nouveau et l’imprévu
sont choses interdites! C’est ne pas le connaître.
Ne vous y trompez pas, son clair bon sens le renseigne
exactement sur bien des choses et s’il est dégoûté d’un
style officiel qui lui coûte très cher — car c’est lui qui
paie et il en veut pour son argent — c’est qu’il a reconnu
l’incapacité de rien faire de bon chez ceux qui pratiquent
cet art-là. Il apprécie avec beaucoup de bon sens l’éclai-
rage, la distribution, les dégagements, en un mot la
commodité générale d’un édifice, et constate que plus un
bâtiment est riche en colonnes au dehors, plus on doit
s’attendre à le trouver mal venu au dedans. Son sens
esthétique ne va pas jusqu’à découvrir la raison de ce
désaccord; il ne se soucie même pas de le rechercher : la
constance du fait lui suffit pour passer condamnation. Les
théories du « Grand Art » ne le touchent pas : il entend
que l’on construise pour lui et non pour ses ancêtres.
Comment s’étonner que ce public, aux mœurs et aux
besoins de qui les élèves des Beaux-Arts ne veulent rien
concéder, se tourne vers ceux de l’Ecole centrale ou des
ponts et chaussées. « Au moins ceux-ci, se dit-il, sont de
leur temps et de leur pays; ils savent de quelles ressources
dispose notre époque; tournés vers l’avenir et non vers le
passé, ils se préoccupent constamment de faire plus grand
et plus hardi ; ce n’est pas eux qui classeront les matériaux
en nobles et en roturiers, car peu leur importe la prove-
nance si l’emploi donne le résultat voulu; avec le fer, élé-
ment principal de leurs constructions, aucun danger de
retour à ces styles d’emprunt qui jurent avec nos mœurs
et nos climats, donc rien de grec et rien de romain à
redouter. O délivrance! échapper enfin à ce joug trois fois
séculaire! Voir enfin un édifice qui ne soit pas une contre-
façon, qui s’écarte du convenu, qui ne se borne pas à être
neuf, mais soit nouveau, quelle jouissance inespérée! »
C'est plus qu’il n’en faut pour déterminer sa préférence.
Aussi écoutez-le crier : « Gloire à M. Eiffel! »
Cet engouement du public pour les ingénieurs n’est
pas sans danger pour l’art. L’espoir que l’on fonde sur
eux est excessif. Leur rôle dans l’évolution de l’architec-
ture est capital, cela est vrai, et comme ils auront eu l'ini-
tiative de cette évolution il en résultera pour eux, durant
un certain temps, une certaine prépondérance à l’égard
des architectes. Mais conclure de là qu’ils pourraient se
passer de ceux-ci, c’est se méprendre du tout au tout.
Réduits à leurs seules forces, les ingénieurs font de la
construction, mais non de l’architecture de fer. S’ils
avaient pu trouver la forme architecturale nouvelle que
nous appelons de tous nos vœux, il y a longtemps qu’ils
l’eussent fait, car ni le temps ni l’occasion ne leur ont
manqué.
Ce qui leur manque pour réussir, c’est l’éducation de
l’œil, c’est la familiarité des lois qui régissent la propor-
tion et le profil, c’est une connaissance assez approfondie
de l’histoire de l’art pour en préjuger la marche future et
s’orienter en conséquence.
L’ART.
a certaines habitudes, certains besoins, certaines aspira-
tions, qui entend être protégé contre les intempéries etqui
ne consentira pas longtemps à se faire violence pour res-
pecter les routines d’un architecte. Ce qui s’est produit
pour l’habitation se produira pour le monument : le bon
sens aura le dernier mot.
Le genre humain ne serait plus le genre humain si le
goût des générations qui viennent était le même que celui
des générations qui s’en vont. Le besoin d’un art à soi peut
momentanément ne pas se faire sentir, faute de force suf-
fisante ou d’occasion favorable : gardez-vous d’en conclure
qu’il n’existe plus. Semblable à ces fuites de gaz qui
demeurent insoupçonnées jusqu’à l’heure de l’explosion,
le besoin artistique non satisfait et longtemps comprimé
augmente silencieusement de force virtuelle jusqu’à ce
qu’une circonstance fortuite, une occasion imprévue ou
l’intervention, si souvent inspiratrice, de la nécessité lui
fraye un chemin. Alors, impétueux, irrésistible, il faut,
coûte que coûte, lui donner satisfaction.
Il y a longtemps que la France s’est débarrassée en
poésie et en peinture de l’influence académique, et nous
sommes aujourd’hui fort étonnés que nos pères aient
recouru si longtemps dans leurs vers à une mythologie de
boudoir et consacré tant de grandes toiles aux faits et
gestes de héros grecs ou romains.
L’affranchissement de la sculpture a suivi. Quoique
moins complet, on peut le croire définitif. On nous in-
flige bien encore, de temps à autre, des allégories selon
la formule d’autrefois, mais les Thémis et les Pomone,
les Minerve et les Erato sont mortes et ne ressuscite-
ront pas.
Seule, en présence de ce renouveau général des arts,
l’architecture officielle boude ; elle se défie de la civilisa-
tion moderne et considère sa dignité comme intéressée à
un divorce.
Elle n’ignore pas que la science et l’industrie, toujours
à la recherche de nouvelles conquêtes, mettent aujourd’hui
à sa disposition des ressources aussi variées que pré-
cieuses, mais elle n’y voit que les présents d’Artaxercès et
les repousse avec mépris et indignation. Pénétrée de son
importance, infatuée de l’illustration de ses origines, elle
préférera mourir d’anémie plutôt que déroger en consen-
tant à l’infusion dans ses veines d’un sang nouveau, vigou-
reux mais roturier.
Ces allures d’un autre temps jurent singulièrement
dans le nôtre et MM. les architectes officiels feront bien
de prendre garde : s’ils s’entêtent, sous prétexte de «Grand
Art », à vouloir se passer de la société moderne, c’est elle
qui se passera d’eux.
Il n’y a pas d’illusion à se faire, c’est là que nous allons
tout droit. Déjà le public se tourne vers les ingénieurs.
C’est d’eux qu’il attend l’architecture nouvelle qui don-
nera satisfaction à ses besoins. La popularité sans précédent
de M. Eiffel n’a pas d’autre cause. Ce n’est pas parce que
sa tour a 3oo mètres qu’elle jouit d’une si retentissante
célébrité, c’est parce qu’elle est en fer, parce qu’elle cons-
titue une innovation, parce qu’elle ne ressemble à rien de
ce qui s'est fait.
Il faut voir les choses comme elles sont et ne pas
prendre les apparences pour des réalités. Les gens qui
s’occupent d’art ne sont pas seuls à être las de l’archi-
tecture officielle, le public ne l’est pas moins, le gros
public, juge en dernier ressort des œuvres faites pour
lui.
Il a tant vu de feuilles d’acanthe et de volutes, d’oves
et de rinceaux, de frontons et de péristyles, de coupoles
et de clochetons, qu’il éprouve le besoin d’autre chose.
Or, comme MM. les architectes officiels s’obstinent à ne
pas lui donner autre chose, il leur tourne résolument le
dos et cherche ailleurs.
Demandez à la foule qui s’émerveille devant la tour
Eiffel ce qu’elle pense du palais très correct construit sur
l’Esplanade des Invalides pour le ministère de la guerre.
Elle n’en pense rien; elle ne l’a pas même examiné. Pour-
quoi aurait-elle pris cette peine? N’a-t-elle pas vu la
Porte Saint-Denis? Et si l’architecte du palais en question
avait demandé ses inspirations à un autre modèle, aurait-il
pu en trouver de si neuves que son palais ne ressemblât à
rien de déjà vu? Evidemment non. Tous les modèles ont
été imités; la répétition seule est possible.
Et vous voudriez que le public s’intéressât à un art
qui ne peut plus rien créer, à qui le nouveau et l’imprévu
sont choses interdites! C’est ne pas le connaître.
Ne vous y trompez pas, son clair bon sens le renseigne
exactement sur bien des choses et s’il est dégoûté d’un
style officiel qui lui coûte très cher — car c’est lui qui
paie et il en veut pour son argent — c’est qu’il a reconnu
l’incapacité de rien faire de bon chez ceux qui pratiquent
cet art-là. Il apprécie avec beaucoup de bon sens l’éclai-
rage, la distribution, les dégagements, en un mot la
commodité générale d’un édifice, et constate que plus un
bâtiment est riche en colonnes au dehors, plus on doit
s’attendre à le trouver mal venu au dedans. Son sens
esthétique ne va pas jusqu’à découvrir la raison de ce
désaccord; il ne se soucie même pas de le rechercher : la
constance du fait lui suffit pour passer condamnation. Les
théories du « Grand Art » ne le touchent pas : il entend
que l’on construise pour lui et non pour ses ancêtres.
Comment s’étonner que ce public, aux mœurs et aux
besoins de qui les élèves des Beaux-Arts ne veulent rien
concéder, se tourne vers ceux de l’Ecole centrale ou des
ponts et chaussées. « Au moins ceux-ci, se dit-il, sont de
leur temps et de leur pays; ils savent de quelles ressources
dispose notre époque; tournés vers l’avenir et non vers le
passé, ils se préoccupent constamment de faire plus grand
et plus hardi ; ce n’est pas eux qui classeront les matériaux
en nobles et en roturiers, car peu leur importe la prove-
nance si l’emploi donne le résultat voulu; avec le fer, élé-
ment principal de leurs constructions, aucun danger de
retour à ces styles d’emprunt qui jurent avec nos mœurs
et nos climats, donc rien de grec et rien de romain à
redouter. O délivrance! échapper enfin à ce joug trois fois
séculaire! Voir enfin un édifice qui ne soit pas une contre-
façon, qui s’écarte du convenu, qui ne se borne pas à être
neuf, mais soit nouveau, quelle jouissance inespérée! »
C'est plus qu’il n’en faut pour déterminer sa préférence.
Aussi écoutez-le crier : « Gloire à M. Eiffel! »
Cet engouement du public pour les ingénieurs n’est
pas sans danger pour l’art. L’espoir que l’on fonde sur
eux est excessif. Leur rôle dans l’évolution de l’architec-
ture est capital, cela est vrai, et comme ils auront eu l'ini-
tiative de cette évolution il en résultera pour eux, durant
un certain temps, une certaine prépondérance à l’égard
des architectes. Mais conclure de là qu’ils pourraient se
passer de ceux-ci, c’est se méprendre du tout au tout.
Réduits à leurs seules forces, les ingénieurs font de la
construction, mais non de l’architecture de fer. S’ils
avaient pu trouver la forme architecturale nouvelle que
nous appelons de tous nos vœux, il y a longtemps qu’ils
l’eussent fait, car ni le temps ni l’occasion ne leur ont
manqué.
Ce qui leur manque pour réussir, c’est l’éducation de
l’œil, c’est la familiarité des lois qui régissent la propor-
tion et le profil, c’est une connaissance assez approfondie
de l’histoire de l’art pour en préjuger la marche future et
s’orienter en conséquence.