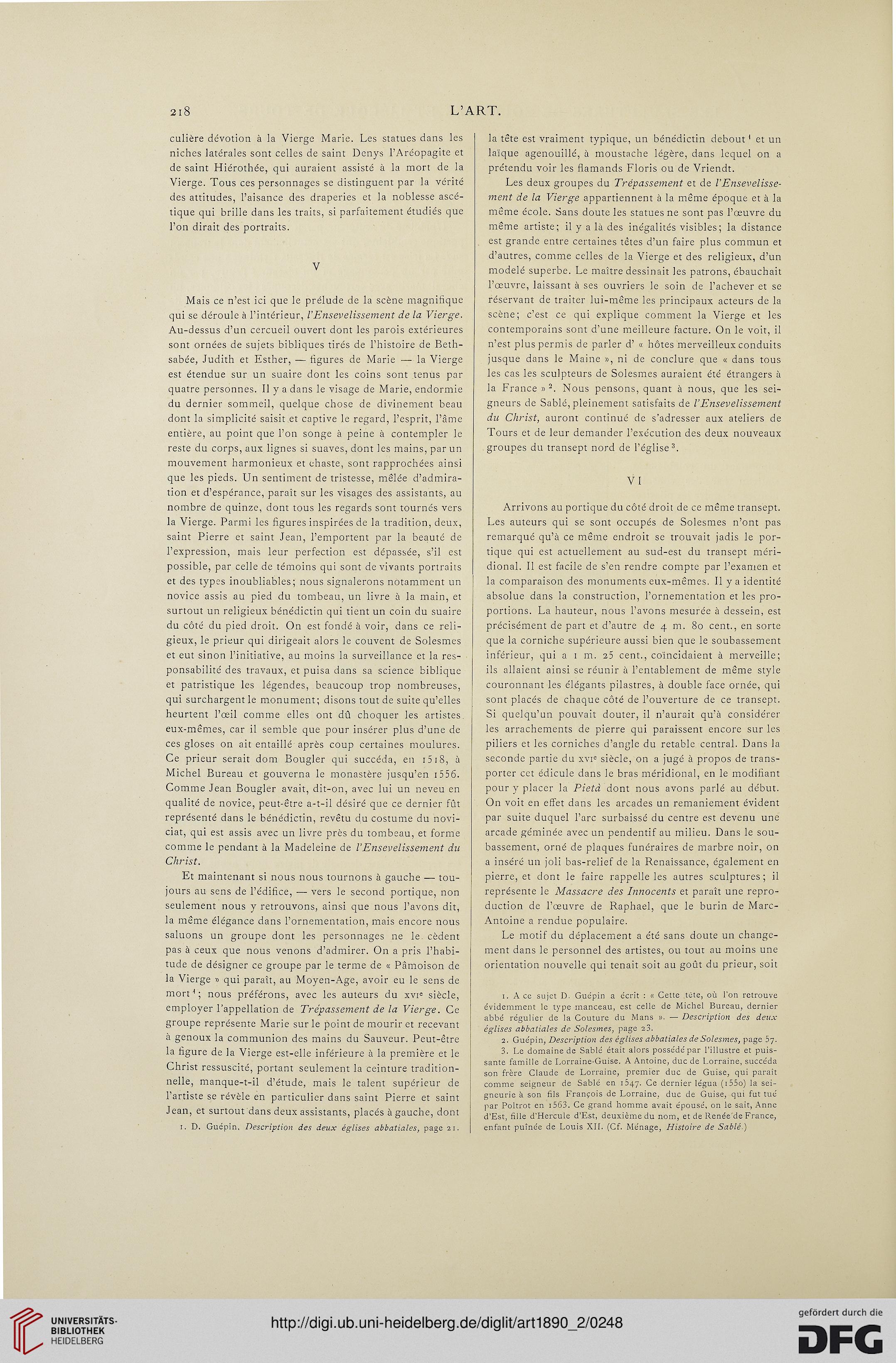L’ART.
218
culière dévotion à la Vierge Marie. Les statues dans les
niches latérales sont celles de saint Dcnys l’Aréopagite et
de saint Hiérothée, qui auraient assisté à la mort de la
Vierge. Tous ces personnages se distinguent par la vérité
des attitudes, l’aisance des draperies et la noblesse ascé-
tique qui brille dans les traits, si parfaitement étudiés que
l’on dirait des portraits.
V
Mais ce n’est ici que le prélude de la scène magnifique
qui se déroule à l’intérieur, l’Ensevelissement de la Vierge.
Au-dessus d’un cercueil ouvert dont les parois extérieures
sont ornées de sujets bibliques tirés de l’histoire de Beth-
sabée, Judith et Esther, — figures de Marie — la Vierge
est étendue sur un suaire dont les coins sont tenus par
quatre personnes. Il y a dans le visage de Marie, endormie
du dernier sommeil, quelque chose de divinement beau
dont la simplicité saisit et captive le regard, l’esprit, l’âme
entière, au point que l’on songe à peine à contempler le
reste du corps, aux lignes si suaves, dont les mains, par un
mouvement harmonieux et chaste, sont rapprochées ainsi
que les pieds. Un sentiment de tristesse, mêlée d’admira-
tion et d’espérance, paraît sur les visages des assistants, au
nombre de quinze, dont tous les regards sont tournés vers
la Vierge. Parmi les figures inspirées de la tradition, deux,
saint Pierre et saint Jean, l’emportent par la beauté de
l’expression, mais leur perfection est dépassée, s’il est
possible, par celle de témoins qui sont de vivants portraits
et des types inoubliables; nous signalerons notamment un
novice assis au pied du tombeau, un livre à la main, et
surtout un religieux bénédictin qui tient un coin du suaire
du côté du pied droit. On est fondé à voir, dans ce reli-
gieux, le prieur qui dirigeait alors le couvent de Solesmes
et eut sinon l’initiative, au moins la surveillance et la res-
ponsabilité des travaux, et puisa dans sa science biblique
et patristique les légendes, beaucoup trop nombreuses,
qui surchargent le monument; disons tout de suite qu’elles
heurtent l’œil comme elles ont dû choquer les artistes,
eux-mêmes, car il semble que pour insérer plus d’une de
ces gloses on ait entaillé après coup certaines moulures.
Ce prieur serait dom Bougler qui succéda, en 15 18, à
Michel Bureau et gouverna le monastère jusqu’en 1556.
Comme Jean Bougler avait, dit-on, avec lui un neveu en
qualité de novice, peut-être a-t-il désiré que ce dernier fût
représenté dans le bénédictin, revêtu du costume du novi-
ciat, qui est assis avec un livre près du tombeau, et forme
comme le pendant à la Madeleine de VEnsevelissement du
Christ.
Et maintenant si nous nous tournons à gauche — tou-
jours au sens de l’édifice, — vers le second portique, non
seulement nous y retrouvons, ainsi que nous l’avons dit,
la même élégance dans l’ornementation, mais encore nous
saluons un groupe dont les personnages ne le cèdent
pas à ceux que nous venons d’admirer. On a pris l’habi-
tude de désigner ce groupe par le terme de « Pâmoison de
la Vierge » qui paraît, au Moyen-Age, avoir eu le sens de
mort1 ; nous préférons, avec les auteurs du xvie siècle,
employer l’appellation de Trépassement de la Vierge. Ce
groupe représente Marie sur le point de mourir et recevant
à genoux la communion des mains du Sauveur. Peut-être
la figure de la Vierge est-elle inférieure à la première et le
Christ ressuscité, portant seulement la ceinture tradition-
nelle, manque-t-il d’étude, mais le talent supérieur de
l’artiste se révèle en particulier dans saint Pierre et saint
Jean, et surtout dans deux assistants, placés à gauche, dont
1. D. Guépin, Description des deux églises abbatiales, page 21.
la tête est vraiment typique, un bénédictin debout 1 et un
laïque agenouillé, à moustache légère, dans lequel on a
prétendu voir les flamands Floris ou de Vriendt.
Les deux groupes du Trépassement et de l’Ensevelisse-
ment de la Vierge appartiennent à la même époque et à la
même école. Sans doute les statues ne sont pas l’œuvre du
même artiste; il y a là des inégalités visibles ; la distance
est grande entre certaines têtes d’un faire plus commun et
d’autres, comme celles de la Vierge et des religieux, d’un
modelé superbe. Le maître dessinait les patrons, ébauchait
l’œuvre, laissant à ses ouvriers le soin de l’achever et se
réservant de traiter lui-même les principaux acteurs de la
scène; c’est ce qui explique comment la Vierge et les
contemporains sont d’une meilleure facture. On le voit, il
n’est plus permis de parler d’ « hôtes merveilleux conduits
jusque dans le Maine », ni de conclure que « dans tous
les cas les sculpteurs de Solesmes auraient été étrangers à
la France » 2. Nous pensons, quant à nous, que les sei-
gneurs de Sablé, pleinement satisfaits de VEnsevelissement
du Christ, auront continué de s’adresser aux ateliers de
Tours et de leur demander l’exécution des deux nouveaux
groupes du transept nord de l’église3.
VI
Arrivons au portique du côté droit de ce même transept.
Les auteurs qui se sont occupés de Solesmes n’ont pas
remarqué qu’à ce même endroit se trouvait jadis le por-
tique qui est actuellement au sud-est du transept méri-
dional. Il est facile de s’en rendre compte par l’examen et
la comparaison des monuments eux-mêmes. Il y a identité
absolue dans la construction, l’ornementation et les pro-
portions. La hauteur, nous l’avons mesurée à dessein, est
précisément de part et d’autre de 4 m. 80 cent., en sorte
que la corniche supérieure aussi bien que le soubassement
inférieur, qui a 1 m. 25 cent., coïncidaient à merveille;
ils allaient ainsi se réunir à l’entablement de même style
couronnant les élégants pilastres, à double face ornée, qui
sont placés de chaque côté de l’ouverture de ce transept.
Si quelqu’un pouvait douter, il n’aurait qu'à considérer
les arrachements de pierre qui paraissent encore sur les
piliers et les corniches d’angle du retable central. Dans la
seconde partie du xvie siècle, on a jugé à propos de trans-
porter cet édicule dans le bras méridional, en le modifiant
pour y placer la Pietà dont nous avons parlé au début.
On voit en effet dans les arcades un remaniement évident
par suite duquel l’arc surbaissé du centre est devenu une
arcade géminée avec un pendentif au milieu. Dans le sou-
bassement, orné de plaques funéraires de marbre noir, on
a inséré un joli bas-relief de la Renaissance, également en
pierre, et dont le faire rappelle les autres sculptures; il
représente le Massacre des Innocents et paraît une repro-
duction de l’œuvre de Raphaël, que le burin de Marc-
Antoine a rendue populaire.
Le motif du déplacement a été sans doute un change-
ment dans le personnel des artistes, ou tout au moins une
orientation nouvelle qui tenait soit au goût du prieur, soit
1. A ce sujet D. Guépin a écrit : « Cette tète, où l’on retrouve
évidemment le type manceau, est celle de Michel Bureau, dernier
abbé régulier de la Couture du Mans ». — Description des deux
églises abbatiales de Solesmes, page 23.
2. Guépin, Description des églises abbatiales de Solesmes, page 57.
3. Le domaine de Sablé était alors possédé par l’illustre et puis-
sante famille de Lorraine-Guise. A Antoine, duc de Lorraine, succéda
son frère Claude de Lorraine, premier duc de Guise, qui paraît
comme seigneur de Sablé en 1547. Ce dernier légua (i55o) la sei-
gneurie à son fils François de Lorraine, duc de Guise, qui fut tué
par Poltrot en 1563. Ce grand homme avait épousé, on le sait, Anne
d’Est, fille d’Hercule d’Est, deuxième du nom, et de llenée de France,
enfant puînée de Louis XII. (Cf. Ménage, Histoire de Sablé.)
218
culière dévotion à la Vierge Marie. Les statues dans les
niches latérales sont celles de saint Dcnys l’Aréopagite et
de saint Hiérothée, qui auraient assisté à la mort de la
Vierge. Tous ces personnages se distinguent par la vérité
des attitudes, l’aisance des draperies et la noblesse ascé-
tique qui brille dans les traits, si parfaitement étudiés que
l’on dirait des portraits.
V
Mais ce n’est ici que le prélude de la scène magnifique
qui se déroule à l’intérieur, l’Ensevelissement de la Vierge.
Au-dessus d’un cercueil ouvert dont les parois extérieures
sont ornées de sujets bibliques tirés de l’histoire de Beth-
sabée, Judith et Esther, — figures de Marie — la Vierge
est étendue sur un suaire dont les coins sont tenus par
quatre personnes. Il y a dans le visage de Marie, endormie
du dernier sommeil, quelque chose de divinement beau
dont la simplicité saisit et captive le regard, l’esprit, l’âme
entière, au point que l’on songe à peine à contempler le
reste du corps, aux lignes si suaves, dont les mains, par un
mouvement harmonieux et chaste, sont rapprochées ainsi
que les pieds. Un sentiment de tristesse, mêlée d’admira-
tion et d’espérance, paraît sur les visages des assistants, au
nombre de quinze, dont tous les regards sont tournés vers
la Vierge. Parmi les figures inspirées de la tradition, deux,
saint Pierre et saint Jean, l’emportent par la beauté de
l’expression, mais leur perfection est dépassée, s’il est
possible, par celle de témoins qui sont de vivants portraits
et des types inoubliables; nous signalerons notamment un
novice assis au pied du tombeau, un livre à la main, et
surtout un religieux bénédictin qui tient un coin du suaire
du côté du pied droit. On est fondé à voir, dans ce reli-
gieux, le prieur qui dirigeait alors le couvent de Solesmes
et eut sinon l’initiative, au moins la surveillance et la res-
ponsabilité des travaux, et puisa dans sa science biblique
et patristique les légendes, beaucoup trop nombreuses,
qui surchargent le monument; disons tout de suite qu’elles
heurtent l’œil comme elles ont dû choquer les artistes,
eux-mêmes, car il semble que pour insérer plus d’une de
ces gloses on ait entaillé après coup certaines moulures.
Ce prieur serait dom Bougler qui succéda, en 15 18, à
Michel Bureau et gouverna le monastère jusqu’en 1556.
Comme Jean Bougler avait, dit-on, avec lui un neveu en
qualité de novice, peut-être a-t-il désiré que ce dernier fût
représenté dans le bénédictin, revêtu du costume du novi-
ciat, qui est assis avec un livre près du tombeau, et forme
comme le pendant à la Madeleine de VEnsevelissement du
Christ.
Et maintenant si nous nous tournons à gauche — tou-
jours au sens de l’édifice, — vers le second portique, non
seulement nous y retrouvons, ainsi que nous l’avons dit,
la même élégance dans l’ornementation, mais encore nous
saluons un groupe dont les personnages ne le cèdent
pas à ceux que nous venons d’admirer. On a pris l’habi-
tude de désigner ce groupe par le terme de « Pâmoison de
la Vierge » qui paraît, au Moyen-Age, avoir eu le sens de
mort1 ; nous préférons, avec les auteurs du xvie siècle,
employer l’appellation de Trépassement de la Vierge. Ce
groupe représente Marie sur le point de mourir et recevant
à genoux la communion des mains du Sauveur. Peut-être
la figure de la Vierge est-elle inférieure à la première et le
Christ ressuscité, portant seulement la ceinture tradition-
nelle, manque-t-il d’étude, mais le talent supérieur de
l’artiste se révèle en particulier dans saint Pierre et saint
Jean, et surtout dans deux assistants, placés à gauche, dont
1. D. Guépin, Description des deux églises abbatiales, page 21.
la tête est vraiment typique, un bénédictin debout 1 et un
laïque agenouillé, à moustache légère, dans lequel on a
prétendu voir les flamands Floris ou de Vriendt.
Les deux groupes du Trépassement et de l’Ensevelisse-
ment de la Vierge appartiennent à la même époque et à la
même école. Sans doute les statues ne sont pas l’œuvre du
même artiste; il y a là des inégalités visibles ; la distance
est grande entre certaines têtes d’un faire plus commun et
d’autres, comme celles de la Vierge et des religieux, d’un
modelé superbe. Le maître dessinait les patrons, ébauchait
l’œuvre, laissant à ses ouvriers le soin de l’achever et se
réservant de traiter lui-même les principaux acteurs de la
scène; c’est ce qui explique comment la Vierge et les
contemporains sont d’une meilleure facture. On le voit, il
n’est plus permis de parler d’ « hôtes merveilleux conduits
jusque dans le Maine », ni de conclure que « dans tous
les cas les sculpteurs de Solesmes auraient été étrangers à
la France » 2. Nous pensons, quant à nous, que les sei-
gneurs de Sablé, pleinement satisfaits de VEnsevelissement
du Christ, auront continué de s’adresser aux ateliers de
Tours et de leur demander l’exécution des deux nouveaux
groupes du transept nord de l’église3.
VI
Arrivons au portique du côté droit de ce même transept.
Les auteurs qui se sont occupés de Solesmes n’ont pas
remarqué qu’à ce même endroit se trouvait jadis le por-
tique qui est actuellement au sud-est du transept méri-
dional. Il est facile de s’en rendre compte par l’examen et
la comparaison des monuments eux-mêmes. Il y a identité
absolue dans la construction, l’ornementation et les pro-
portions. La hauteur, nous l’avons mesurée à dessein, est
précisément de part et d’autre de 4 m. 80 cent., en sorte
que la corniche supérieure aussi bien que le soubassement
inférieur, qui a 1 m. 25 cent., coïncidaient à merveille;
ils allaient ainsi se réunir à l’entablement de même style
couronnant les élégants pilastres, à double face ornée, qui
sont placés de chaque côté de l’ouverture de ce transept.
Si quelqu’un pouvait douter, il n’aurait qu'à considérer
les arrachements de pierre qui paraissent encore sur les
piliers et les corniches d’angle du retable central. Dans la
seconde partie du xvie siècle, on a jugé à propos de trans-
porter cet édicule dans le bras méridional, en le modifiant
pour y placer la Pietà dont nous avons parlé au début.
On voit en effet dans les arcades un remaniement évident
par suite duquel l’arc surbaissé du centre est devenu une
arcade géminée avec un pendentif au milieu. Dans le sou-
bassement, orné de plaques funéraires de marbre noir, on
a inséré un joli bas-relief de la Renaissance, également en
pierre, et dont le faire rappelle les autres sculptures; il
représente le Massacre des Innocents et paraît une repro-
duction de l’œuvre de Raphaël, que le burin de Marc-
Antoine a rendue populaire.
Le motif du déplacement a été sans doute un change-
ment dans le personnel des artistes, ou tout au moins une
orientation nouvelle qui tenait soit au goût du prieur, soit
1. A ce sujet D. Guépin a écrit : « Cette tète, où l’on retrouve
évidemment le type manceau, est celle de Michel Bureau, dernier
abbé régulier de la Couture du Mans ». — Description des deux
églises abbatiales de Solesmes, page 23.
2. Guépin, Description des églises abbatiales de Solesmes, page 57.
3. Le domaine de Sablé était alors possédé par l’illustre et puis-
sante famille de Lorraine-Guise. A Antoine, duc de Lorraine, succéda
son frère Claude de Lorraine, premier duc de Guise, qui paraît
comme seigneur de Sablé en 1547. Ce dernier légua (i55o) la sei-
gneurie à son fils François de Lorraine, duc de Guise, qui fut tué
par Poltrot en 1563. Ce grand homme avait épousé, on le sait, Anne
d’Est, fille d’Hercule d’Est, deuxième du nom, et de llenée de France,
enfant puînée de Louis XII. (Cf. Ménage, Histoire de Sablé.)