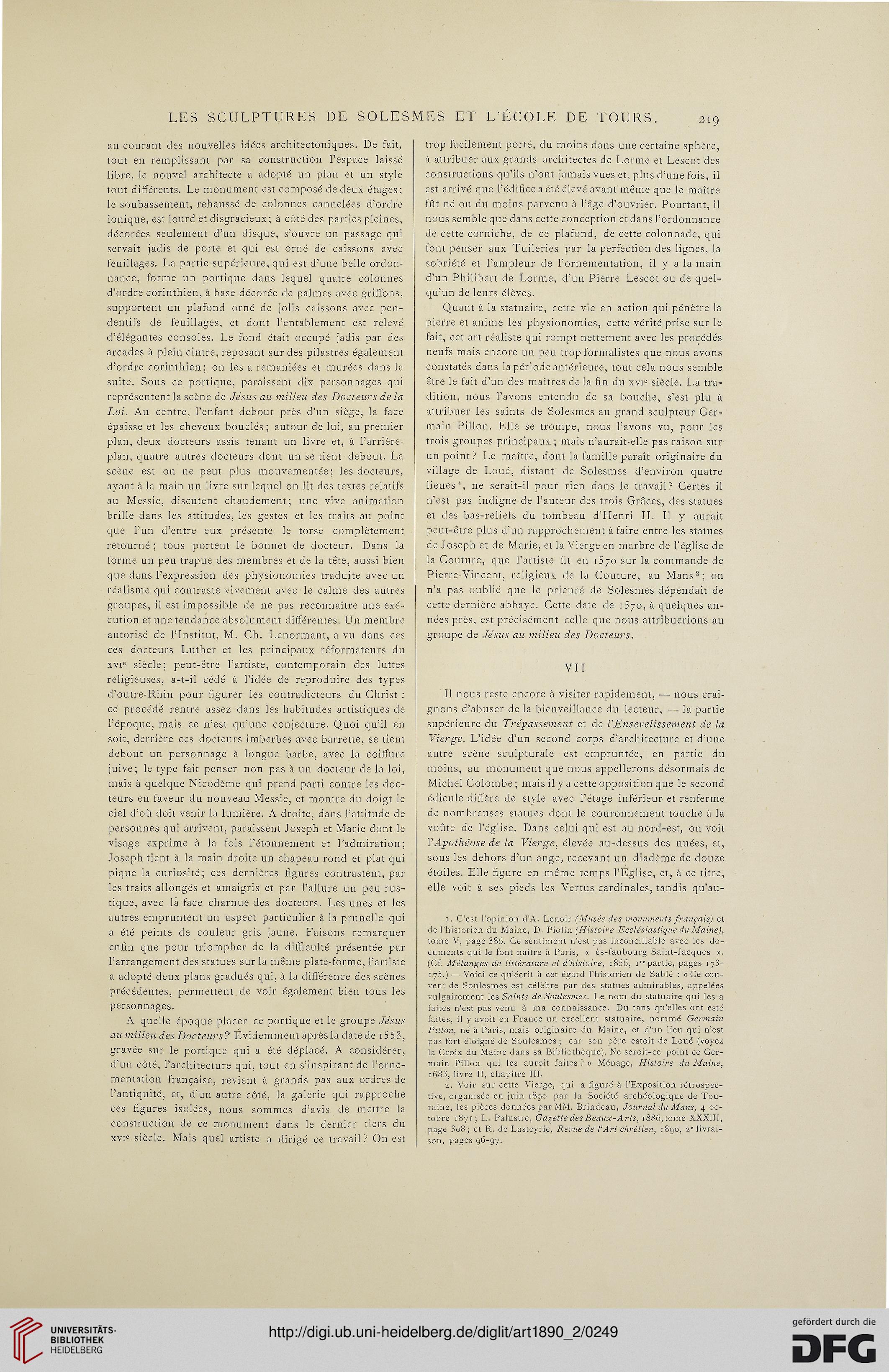LES SCULPTURES DE SOLESMES ET L'ECOLE DE TOURS.
219
au courant des nouvelles idées architectoniques. De fait,
tout en remplissant par sa construction l’espace laissé
libre, le nouvel architecte a adopté un plan et un style
tout différents. Le monument est composé de deux étages ;
le soubassement, rehaussé de colonnes cannelées d’ordre
ionique, est lourd et disgracieux; à côté des parties pleines,
décorées seulement d’un disque, s’ouvre un passage qui
servait jadis de porte et qui est orné de caissons avec
feuillages. La partie supérieure, qui est d’une belle ordon-
nance, forme un portique dans lequel quatre colonnes
d’ordre corinthien, à base décorée de palmes avec griffons,
supportent un plafond orné de jolis caissons avec pen-
dentifs de feuillages, et dont l’entablement est relevé
d’élégantes consoles. Le fond était occupé jadis par des
arcades à plein cintre, reposant sur des pilastres également
d’ordre corinthien; on les a remaniées et murées dans la
suite. Sous ce portique, paraissent dix personnages qui
représentent la scène de Jésus au milieu des Docteurs de la
Loi. Au centre, l’enfant debout près d’un siège, la face
épaisse et les cheveux bouclés; autour de lui, au premier
plan, deux docteurs assis tenant un livre et, à l’arrière-
plan, quatre autres docteurs dont un se tient debout. La
scène est on ne peut plus mouvementée; les docteurs,
ayant à la main un livre sur lequel on lit des textes relatifs
au Messie, discutent chaudement; une vive animation
brille dans les attitudes, les gestes et les traits au point
que l’un d’entre eux présente le torse complètement
retourné ; tous portent le bonnet de docteur. Dans la
forme un peu trapue des membres et de la tête, aussi bien
que dans l’expression des physionomies traduite avec un
réalisme qui contraste vivement avec le calme des autres
groupes, il est impossible de ne pas reconnaître une exé-
cution et une tendance absolument différentes. Un membre
autorisé de l’Institut, M. Ch. Lenormant, a vu dans ces
ces docteurs Luther et les principaux réformateurs du
xvLe siècle; peut-être l’artiste, contemporain des luttes
religieuses, a-t-il cédé à l’idée de reproduire des types
d’outre-Rhin pour figurer les contradicteurs du Christ :
ce procédé rentre assez dans les habitudes artistiques de
l’époque, mais ce n’est qu’une conjecture. Quoi qu’il en
soit, derrière ces docteurs imberbes avec barrette, se tient
debout un personnage à longue barbe, avec la coiffure
juive; le type fait penser non pas à un docteur de la loi,
mais à quelque Nicodème qui prend parti contre les doc-
teurs en faveur du nouveau Messie, et montre du doigt le
ciel d’où doit venir la lumière. A droite, dans l’attitude de
personnes qui arrivent, paraissent Joseph et Marie dont le
visage exprime à la fois l’étonnement et l’admiration;
Joseph tient à la main droite un chapeau rond et plat qui
pique la curiosité; ces dernières figures contrastent, par
les traits allongés et amaigris et par l’allure un peu rus-
tique, avec la face charnue des docteurs. Les unes et les
autres empruntent un aspect particulier à la prunelle qui
a été peinte de couleur gris jaune. Faisons remarquer
enfin que pour triompher de la difficulté présentée par
l’arrangement des statues sur la même plate-forme, l’artiste
a adopté deux plans gradués qui, à la différence des scènes
précédentes, permettent de voir également bien tous les
personnages.
A quelle époque placer ce portique et le groupe Jésus
au milieu des Docteurs? Evidemment après la date de 1 5 53,
gravée sur le portique qui a été déplacé. A considérer,
d’un côté, l’architecture qui, tout en s’inspirant de l’orne-
mentation française, revient à grands pas aux ordres de
l’antiquité, et, d’un autre côté, la galerie qui rapproche
ces figures isolées, nous sommes d’avis de mettre la
construction de ce monument dans le dernier tiers du
xvic siècle. Mais quel artiste a dirigé ce travail ? On est
trop facilement porté, du moins dans une certaine sphère,
à attribuer aux grands architectes de Lorme et Lescot des
constructions qu’ils n’ont jamais vues et, plus d’une fois, il
est arrivé que l'édifice a été élevé avant même que le maître
fût né ou du moins parvenu à l’âge d’ouvrier. Pourtant, il
nous semble que dans cette conception et dans l’ordonnance
de cette corniche, de ce plafond, de cette colonnade, qui
font penser aux Tuileries par la perfection des lignes, la
sobriété et l’ampleur de l’ornementation, il y a la main
d’un Philibert de Lorme, d’un Pierre Lescot ou de quel-
qu’un de leurs élèves.
Quant à la statuaire, cette vie en action qui pénètre la
pierre et anime les physionomies, cette vérité prise sur le
fait, cet art réaliste qui rompt nettement avec les procédés
neufs mais encore un peu trop formalistes que nous avons
constatés dans la période antérieure, tout cela nous semble
être le fait d’un des maîtres de la fin du xvie siècle. I.a tra-
dition, nous l’avons entendu de sa bouche, s’est plu à
attribuer les saints de Solesmes au grand sculpteur Ger-
main Pillon. Elle se trompe, nous l’avons vu, pour les
trois groupes principaux ; mais n’aurait-elle pas raison sur
un point? Le maître, dont la famille paraît originaire du
village de Loué, distant de Solesmes d’environ quatre
lieues1, ne serait-il pour rien dans le travail? Certes il
n’est pas indigne de l’auteur des trois Grâces, des statues
et des bas-reliefs du tombeau d'Henri IL II y aurait
peut-être plus d’un rapprochement à faire entre les statues
de Joseph et de Marie, et la Vierge en marbre de l'église de
la Couture, que l’artiste fit en i5jo sur la commande de
Pierre-Vincent, religieux de la Couture, au Mans2; on
n’a pas oublié que le prieuré de Solesmes dépendait de
cette dernière abbaye. Cette date de Uyo, à quelques an-
nées près, est précisément celle que nous attribuerions au
groupe de Jésus au milieu des Docteurs.
VII
Il nous reste encore à visiter rapidement, — nous crai-
gnons d’abuser de la bienveillance du lecteur, — la partie
supérieure du Trépassement et de VEnsevelissement de la
Vierge. L’idée d’un second corps d’architecture et d'une
autre scène sculpturale est empruntée, en partie du
moins, au monument que nous appellerons désormais de
Michel Colombe ; mais il y a cette opposition que le second
édicule diffère de style avec l’étage inférieur et renferme
de nombreuses statues dont le couronnement touche à la
voûte de l’église. Dans celui qui est au nord-est, on voit
VApothéose de la Vierge, élevée au-dessus des nuées, et,
sous les dehors d’un ange, recevant un diadème de douze
étoiles. Elle figure en même temps l’Eglise, et, à ce titre,
elle voit à ses pieds les Vertus cardinales, tandis qu’au-
1. C’est l’opinion d’A. Lenoir (Musée des monuments français) et
de l’historien du Maine, D. Piolin (Histoire Ecclésiastique du Maine),
tome V, page 386. Ce sentiment n’est pas inconciliable avec les do-
cuments qui le font naître à Paris, « ès-faubourg Saint-Jacques ».
(Cf. Mélanges de littérature et d’histoire, 1856, ire partie, pages 173-
175.) — Voici ce qu’e'crit à cet égard l’historien de Sablé : « Ce cou-
vent de Soulesmes est célèbre par des statues admirables, appelées
vulgairement les Saints de Soulesmes. Le nom du statuaire qui les a
faites n’est pas venu à ma connaissance. Du tans qu’elles ont esté
faites, il y avoit en France un excellent statuaire, nommé Germain
Pillon, né à Paris, mais originaire du Maine, et d’un lieu qui n’est
pas fort éloigné de Soulesmes ; car son père estoit de Loué (voyez
la Croix du Maine dans sa Bibliothèque). Ne seroit-ce point ce Ger-
main Pillon qui les auroit faites ? » Ménage, Histoire du Maine,
1683, livre II, chapitre III.
2. Voir sur cette Vierge, qui a figuré à l’Exposition rétrospec-
tive, organisée en juin 1890 par la Société archéologique de Tou-
raine, les pièces données par MM. Brindeau, Journal du Mans, 4 oc-
tobre 1871; L. Palustre, Gaqette des Beaux- Arts, 1886,tome XXXIII,
page 3o8 ; et R. de Lasteyrie, Revue de l’Art chrétien, 1890, 1° livrai-
son, pages 96-97.
219
au courant des nouvelles idées architectoniques. De fait,
tout en remplissant par sa construction l’espace laissé
libre, le nouvel architecte a adopté un plan et un style
tout différents. Le monument est composé de deux étages ;
le soubassement, rehaussé de colonnes cannelées d’ordre
ionique, est lourd et disgracieux; à côté des parties pleines,
décorées seulement d’un disque, s’ouvre un passage qui
servait jadis de porte et qui est orné de caissons avec
feuillages. La partie supérieure, qui est d’une belle ordon-
nance, forme un portique dans lequel quatre colonnes
d’ordre corinthien, à base décorée de palmes avec griffons,
supportent un plafond orné de jolis caissons avec pen-
dentifs de feuillages, et dont l’entablement est relevé
d’élégantes consoles. Le fond était occupé jadis par des
arcades à plein cintre, reposant sur des pilastres également
d’ordre corinthien; on les a remaniées et murées dans la
suite. Sous ce portique, paraissent dix personnages qui
représentent la scène de Jésus au milieu des Docteurs de la
Loi. Au centre, l’enfant debout près d’un siège, la face
épaisse et les cheveux bouclés; autour de lui, au premier
plan, deux docteurs assis tenant un livre et, à l’arrière-
plan, quatre autres docteurs dont un se tient debout. La
scène est on ne peut plus mouvementée; les docteurs,
ayant à la main un livre sur lequel on lit des textes relatifs
au Messie, discutent chaudement; une vive animation
brille dans les attitudes, les gestes et les traits au point
que l’un d’entre eux présente le torse complètement
retourné ; tous portent le bonnet de docteur. Dans la
forme un peu trapue des membres et de la tête, aussi bien
que dans l’expression des physionomies traduite avec un
réalisme qui contraste vivement avec le calme des autres
groupes, il est impossible de ne pas reconnaître une exé-
cution et une tendance absolument différentes. Un membre
autorisé de l’Institut, M. Ch. Lenormant, a vu dans ces
ces docteurs Luther et les principaux réformateurs du
xvLe siècle; peut-être l’artiste, contemporain des luttes
religieuses, a-t-il cédé à l’idée de reproduire des types
d’outre-Rhin pour figurer les contradicteurs du Christ :
ce procédé rentre assez dans les habitudes artistiques de
l’époque, mais ce n’est qu’une conjecture. Quoi qu’il en
soit, derrière ces docteurs imberbes avec barrette, se tient
debout un personnage à longue barbe, avec la coiffure
juive; le type fait penser non pas à un docteur de la loi,
mais à quelque Nicodème qui prend parti contre les doc-
teurs en faveur du nouveau Messie, et montre du doigt le
ciel d’où doit venir la lumière. A droite, dans l’attitude de
personnes qui arrivent, paraissent Joseph et Marie dont le
visage exprime à la fois l’étonnement et l’admiration;
Joseph tient à la main droite un chapeau rond et plat qui
pique la curiosité; ces dernières figures contrastent, par
les traits allongés et amaigris et par l’allure un peu rus-
tique, avec la face charnue des docteurs. Les unes et les
autres empruntent un aspect particulier à la prunelle qui
a été peinte de couleur gris jaune. Faisons remarquer
enfin que pour triompher de la difficulté présentée par
l’arrangement des statues sur la même plate-forme, l’artiste
a adopté deux plans gradués qui, à la différence des scènes
précédentes, permettent de voir également bien tous les
personnages.
A quelle époque placer ce portique et le groupe Jésus
au milieu des Docteurs? Evidemment après la date de 1 5 53,
gravée sur le portique qui a été déplacé. A considérer,
d’un côté, l’architecture qui, tout en s’inspirant de l’orne-
mentation française, revient à grands pas aux ordres de
l’antiquité, et, d’un autre côté, la galerie qui rapproche
ces figures isolées, nous sommes d’avis de mettre la
construction de ce monument dans le dernier tiers du
xvic siècle. Mais quel artiste a dirigé ce travail ? On est
trop facilement porté, du moins dans une certaine sphère,
à attribuer aux grands architectes de Lorme et Lescot des
constructions qu’ils n’ont jamais vues et, plus d’une fois, il
est arrivé que l'édifice a été élevé avant même que le maître
fût né ou du moins parvenu à l’âge d’ouvrier. Pourtant, il
nous semble que dans cette conception et dans l’ordonnance
de cette corniche, de ce plafond, de cette colonnade, qui
font penser aux Tuileries par la perfection des lignes, la
sobriété et l’ampleur de l’ornementation, il y a la main
d’un Philibert de Lorme, d’un Pierre Lescot ou de quel-
qu’un de leurs élèves.
Quant à la statuaire, cette vie en action qui pénètre la
pierre et anime les physionomies, cette vérité prise sur le
fait, cet art réaliste qui rompt nettement avec les procédés
neufs mais encore un peu trop formalistes que nous avons
constatés dans la période antérieure, tout cela nous semble
être le fait d’un des maîtres de la fin du xvie siècle. I.a tra-
dition, nous l’avons entendu de sa bouche, s’est plu à
attribuer les saints de Solesmes au grand sculpteur Ger-
main Pillon. Elle se trompe, nous l’avons vu, pour les
trois groupes principaux ; mais n’aurait-elle pas raison sur
un point? Le maître, dont la famille paraît originaire du
village de Loué, distant de Solesmes d’environ quatre
lieues1, ne serait-il pour rien dans le travail? Certes il
n’est pas indigne de l’auteur des trois Grâces, des statues
et des bas-reliefs du tombeau d'Henri IL II y aurait
peut-être plus d’un rapprochement à faire entre les statues
de Joseph et de Marie, et la Vierge en marbre de l'église de
la Couture, que l’artiste fit en i5jo sur la commande de
Pierre-Vincent, religieux de la Couture, au Mans2; on
n’a pas oublié que le prieuré de Solesmes dépendait de
cette dernière abbaye. Cette date de Uyo, à quelques an-
nées près, est précisément celle que nous attribuerions au
groupe de Jésus au milieu des Docteurs.
VII
Il nous reste encore à visiter rapidement, — nous crai-
gnons d’abuser de la bienveillance du lecteur, — la partie
supérieure du Trépassement et de VEnsevelissement de la
Vierge. L’idée d’un second corps d’architecture et d'une
autre scène sculpturale est empruntée, en partie du
moins, au monument que nous appellerons désormais de
Michel Colombe ; mais il y a cette opposition que le second
édicule diffère de style avec l’étage inférieur et renferme
de nombreuses statues dont le couronnement touche à la
voûte de l’église. Dans celui qui est au nord-est, on voit
VApothéose de la Vierge, élevée au-dessus des nuées, et,
sous les dehors d’un ange, recevant un diadème de douze
étoiles. Elle figure en même temps l’Eglise, et, à ce titre,
elle voit à ses pieds les Vertus cardinales, tandis qu’au-
1. C’est l’opinion d’A. Lenoir (Musée des monuments français) et
de l’historien du Maine, D. Piolin (Histoire Ecclésiastique du Maine),
tome V, page 386. Ce sentiment n’est pas inconciliable avec les do-
cuments qui le font naître à Paris, « ès-faubourg Saint-Jacques ».
(Cf. Mélanges de littérature et d’histoire, 1856, ire partie, pages 173-
175.) — Voici ce qu’e'crit à cet égard l’historien de Sablé : « Ce cou-
vent de Soulesmes est célèbre par des statues admirables, appelées
vulgairement les Saints de Soulesmes. Le nom du statuaire qui les a
faites n’est pas venu à ma connaissance. Du tans qu’elles ont esté
faites, il y avoit en France un excellent statuaire, nommé Germain
Pillon, né à Paris, mais originaire du Maine, et d’un lieu qui n’est
pas fort éloigné de Soulesmes ; car son père estoit de Loué (voyez
la Croix du Maine dans sa Bibliothèque). Ne seroit-ce point ce Ger-
main Pillon qui les auroit faites ? » Ménage, Histoire du Maine,
1683, livre II, chapitre III.
2. Voir sur cette Vierge, qui a figuré à l’Exposition rétrospec-
tive, organisée en juin 1890 par la Société archéologique de Tou-
raine, les pièces données par MM. Brindeau, Journal du Mans, 4 oc-
tobre 1871; L. Palustre, Gaqette des Beaux- Arts, 1886,tome XXXIII,
page 3o8 ; et R. de Lasteyrie, Revue de l’Art chrétien, 1890, 1° livrai-
son, pages 96-97.