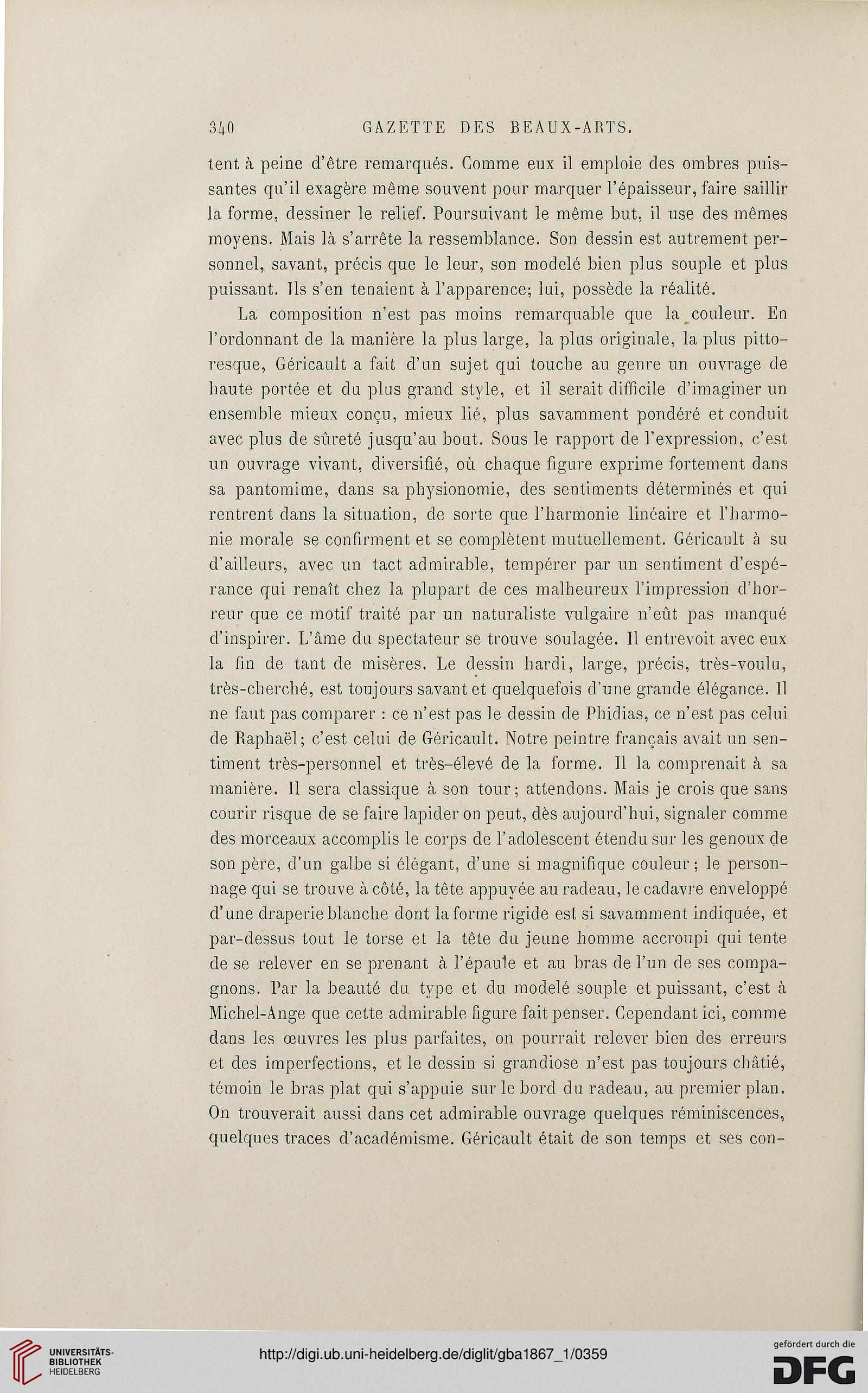340
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
tent à peine cl’être remarqués. Comme eux il emploie des ombres puis-
santes qu’il exagère même souvent pour marquer l’épaisseur, faire saillir
la forme, dessiner le relief. Poursuivant le même but, il use des mêmes
moyens. Mais là s’arrête la ressemblance. Son dessin est autrement per-
sonnel, savant, précis que le leur, son modelé bien plus souple et plus
puissant. Ils s’en tenaient à l’apparence; lui, possède la réalité.
La composition n’est pas moins remarquable que la couleur. En
l’ordonnant de la manière la plus large, la plus originale, la plus pitto-
resque, Géricault a fait d’un sujet qui touche au genre un ouvrage de
haute portée et du plus grand style, et il serait difficile d’imaginer un
ensemble mieux conçu, mieux lié, plus savamment pondéré et conduit
avec plus de sûreté jusqu’au bout. Sous le rapport de l’expression, c’est
un ouvrage vivant, diversifié, où chaque figure exprime fortement dans
sa pantomime, dans sa physionomie, des sentiments déterminés et qui
rentrent dans la situation, de sorte que l’harmonie linéaire et l’harmo-
nie morale se confirment et se complètent mutuellement. Géricault à su
d’ailleurs, avec un tact admirable, tempérer par un sentiment d’espé-
rance qui renaît chez la plupart de ces malheureux l’impression d’hor-
reur que ce motif traité par un naturaliste vulgaire n’eût pas manqué
d’inspirer. L’âme du spectateur se trouve soulagée. Il entrevoit avec eux
la fin de tant de misères. Le dessin hardi, large, précis, très-voulu,
très-cherché, est toujours savant et quelquefois d’une grande élégance. Il
ne faut pas comparer : ce n’est pas le dessin de Phidias, ce n’est pas celui
de Raphaël; c’est celui de Géricault. Notre peintre français avait un sen-
timent très-personnel et très-élevé de la forme. Il la comprenait à sa
manière. Il sera classique à son tour; attendons. Mais je crois que sans
courir risque de se faire lapider on peut, dès aujourd’hui, signaler comme
des morceaux accomplis le corps de l’adolescent étendu sur les genoux de
son père, d’un galbe si élégant, d’une si magnifique couleur; le person-
nage qui se trouve à côté, la tête appuyée au radeau, le cadavre enveloppé
d’une draperie blanche dont la forme rigide est si savamment indiquée, et
par-dessus tout le torse et la tête du jeune homme accroupi qui tente
de se relever en se prenant à l’épaule et au bras de l’un de ses compa-
gnons. Par la beauté du type et du modelé souple et puissant, c’est à
Michel-Ange que cette admirable figure fait penser. Cependant ici, comme
dans les œuvres les plus parfaites, on pourrait relever bien des erreurs
et des imperfections, et le dessin si grandiose n’est pas toujours châtié,
témoin le bras plat qui s’appuie sur le bord du radeau, au premier plan.
On trouverait aussi dans cet admirable ouvrage quelques réminiscences,
quelques traces d’académisme. Géricault était de son temps et ses con-
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
tent à peine cl’être remarqués. Comme eux il emploie des ombres puis-
santes qu’il exagère même souvent pour marquer l’épaisseur, faire saillir
la forme, dessiner le relief. Poursuivant le même but, il use des mêmes
moyens. Mais là s’arrête la ressemblance. Son dessin est autrement per-
sonnel, savant, précis que le leur, son modelé bien plus souple et plus
puissant. Ils s’en tenaient à l’apparence; lui, possède la réalité.
La composition n’est pas moins remarquable que la couleur. En
l’ordonnant de la manière la plus large, la plus originale, la plus pitto-
resque, Géricault a fait d’un sujet qui touche au genre un ouvrage de
haute portée et du plus grand style, et il serait difficile d’imaginer un
ensemble mieux conçu, mieux lié, plus savamment pondéré et conduit
avec plus de sûreté jusqu’au bout. Sous le rapport de l’expression, c’est
un ouvrage vivant, diversifié, où chaque figure exprime fortement dans
sa pantomime, dans sa physionomie, des sentiments déterminés et qui
rentrent dans la situation, de sorte que l’harmonie linéaire et l’harmo-
nie morale se confirment et se complètent mutuellement. Géricault à su
d’ailleurs, avec un tact admirable, tempérer par un sentiment d’espé-
rance qui renaît chez la plupart de ces malheureux l’impression d’hor-
reur que ce motif traité par un naturaliste vulgaire n’eût pas manqué
d’inspirer. L’âme du spectateur se trouve soulagée. Il entrevoit avec eux
la fin de tant de misères. Le dessin hardi, large, précis, très-voulu,
très-cherché, est toujours savant et quelquefois d’une grande élégance. Il
ne faut pas comparer : ce n’est pas le dessin de Phidias, ce n’est pas celui
de Raphaël; c’est celui de Géricault. Notre peintre français avait un sen-
timent très-personnel et très-élevé de la forme. Il la comprenait à sa
manière. Il sera classique à son tour; attendons. Mais je crois que sans
courir risque de se faire lapider on peut, dès aujourd’hui, signaler comme
des morceaux accomplis le corps de l’adolescent étendu sur les genoux de
son père, d’un galbe si élégant, d’une si magnifique couleur; le person-
nage qui se trouve à côté, la tête appuyée au radeau, le cadavre enveloppé
d’une draperie blanche dont la forme rigide est si savamment indiquée, et
par-dessus tout le torse et la tête du jeune homme accroupi qui tente
de se relever en se prenant à l’épaule et au bras de l’un de ses compa-
gnons. Par la beauté du type et du modelé souple et puissant, c’est à
Michel-Ange que cette admirable figure fait penser. Cependant ici, comme
dans les œuvres les plus parfaites, on pourrait relever bien des erreurs
et des imperfections, et le dessin si grandiose n’est pas toujours châtié,
témoin le bras plat qui s’appuie sur le bord du radeau, au premier plan.
On trouverait aussi dans cet admirable ouvrage quelques réminiscences,
quelques traces d’académisme. Géricault était de son temps et ses con-