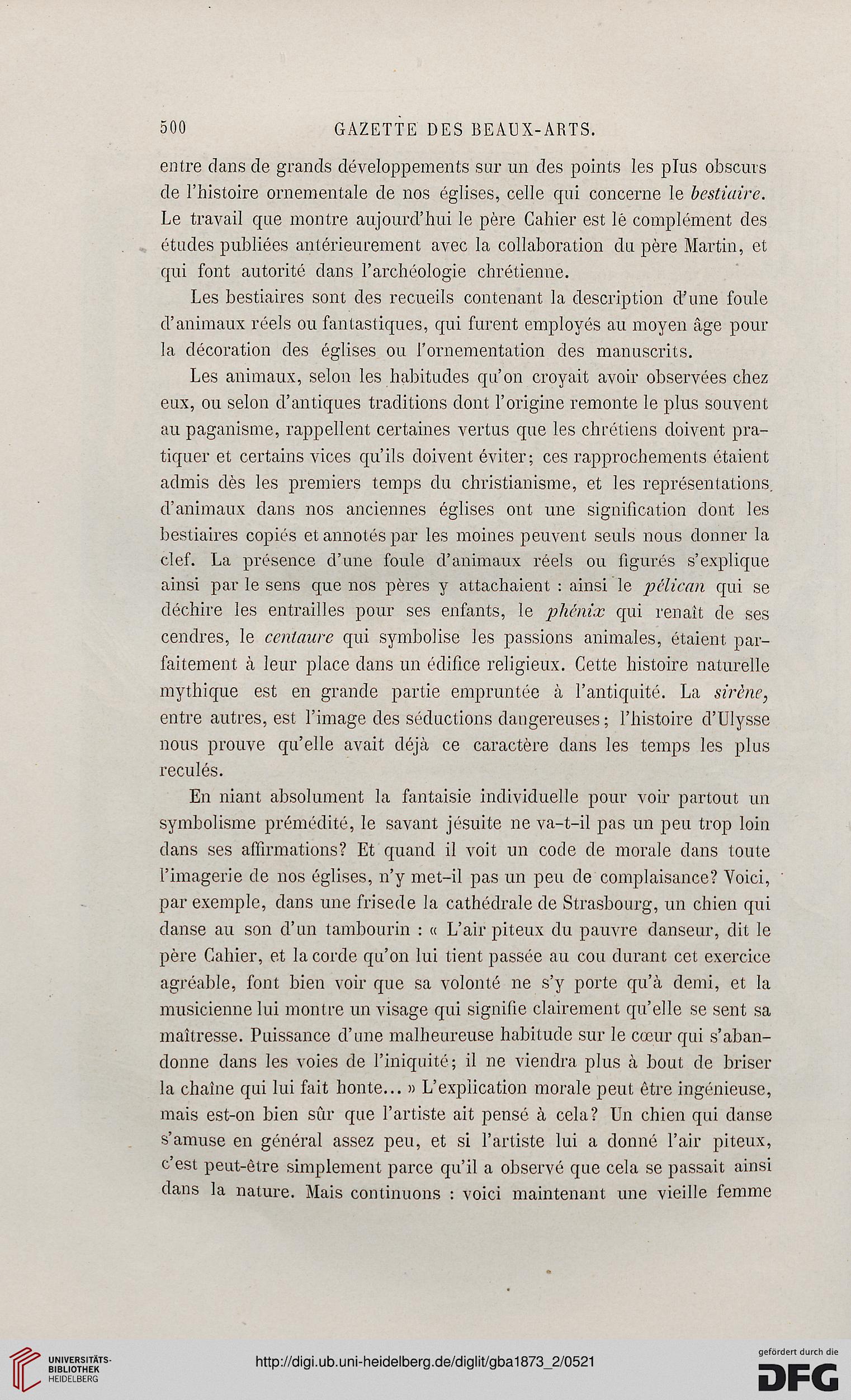500
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
entre dans de grands développements sur un des points les plus obscurs
de l’histoire ornementale de nos églises, celle qui concerne le bestiaire.
Le travail que montre aujourd’hui le père Cahier est lé complément des
études publiées antérieurement avec la collaboration du père Martin, et
qui font autorité dans l’archéologie chrétienne.
Les bestiaires sont des recueils contenant la description d’une foule
d’animaux réels ou fantastiques, qui furent employés au moyen âge pour
la décoration des églises ou l’ornementation des manuscrits.
Les animaux, selon les habitudes qu’on croyait avoir observées chez
eux, ou selon d’antiques traditions dont l’origine remonte le plus souvent
au paganisme, rappellent certaines vertus que les chrétiens doivent pra-
tiquer et certains vices qu’ils doivent éviter; ces rapprochements étaient
admis dès les premiers temps du christianisme, et les représentations,
d’animaux dans nos anciennes églises ont une signification dont les
bestiaires copiés et annotés par les moines peuvent seuls nous donner la
clef. La présence d’une foule d’animaux réels ou figurés s’explique
ainsi par le sens que nos pères y attachaient : ainsi le ■pélican qui se
déchire les entrailles pour ses enfants, le phénix qui renaît de ses
cendres, le centaure qui symbolise les passions animales, étaient par-
faitement à leur place dans un édifice religieux. Cette histoire naturelle
mythique est en grande partie empruntée à l’antiquité. La sirène,
entre autres, est l’image des séductions dangereuses ; l’histoire d’Ulysse
nous prouve qu’elle avait déjà ce caractère dans les temps les plus
reculés.
En niant absolument la fantaisie individuelle pour voir partout un
symbolisme prémédité, le savant jésuite ne va-t-il pas un peu trop loin
dans ses affirmations? Et quand il voit un code de morale dans toute
l’imagerie de nos églises, n’y met-il pas un peu de complaisance? Voici,
par exemple, dans une frisede la cathédrale de Strasbourg, un chien qui
danse au son d’un tambourin : « L’air piteux du pauvre danseur, dit le
père Cahier, et la corde qu’on lui tient passée au cou durant cet exercice
agréable, font bien voir que sa volonté ne s’y porte qu’à demi, et la
musicienne lui montre un visage qui signifie clairement qu’elle se sent sa
maîtresse. Puissance d’une malheureuse habitude sur le cœur qui s’aban-
donne dans les voies de l’iniquité ; il ne viendra plus à bout de briser
la chaîne qui lui fait honte... » L’explication morale peut être ingénieuse,
mais est-on bien sûr que l’artiste ait pensé à cela? Un chien qui danse
s’amuse en général assez peu, et si l’artiste lui a donné l’air piteux,
c’est peut-être simplement parce qu’il a observé que cela se passait ainsi
dans la nature. Mais continuons : voici maintenant une vieille femme
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
entre dans de grands développements sur un des points les plus obscurs
de l’histoire ornementale de nos églises, celle qui concerne le bestiaire.
Le travail que montre aujourd’hui le père Cahier est lé complément des
études publiées antérieurement avec la collaboration du père Martin, et
qui font autorité dans l’archéologie chrétienne.
Les bestiaires sont des recueils contenant la description d’une foule
d’animaux réels ou fantastiques, qui furent employés au moyen âge pour
la décoration des églises ou l’ornementation des manuscrits.
Les animaux, selon les habitudes qu’on croyait avoir observées chez
eux, ou selon d’antiques traditions dont l’origine remonte le plus souvent
au paganisme, rappellent certaines vertus que les chrétiens doivent pra-
tiquer et certains vices qu’ils doivent éviter; ces rapprochements étaient
admis dès les premiers temps du christianisme, et les représentations,
d’animaux dans nos anciennes églises ont une signification dont les
bestiaires copiés et annotés par les moines peuvent seuls nous donner la
clef. La présence d’une foule d’animaux réels ou figurés s’explique
ainsi par le sens que nos pères y attachaient : ainsi le ■pélican qui se
déchire les entrailles pour ses enfants, le phénix qui renaît de ses
cendres, le centaure qui symbolise les passions animales, étaient par-
faitement à leur place dans un édifice religieux. Cette histoire naturelle
mythique est en grande partie empruntée à l’antiquité. La sirène,
entre autres, est l’image des séductions dangereuses ; l’histoire d’Ulysse
nous prouve qu’elle avait déjà ce caractère dans les temps les plus
reculés.
En niant absolument la fantaisie individuelle pour voir partout un
symbolisme prémédité, le savant jésuite ne va-t-il pas un peu trop loin
dans ses affirmations? Et quand il voit un code de morale dans toute
l’imagerie de nos églises, n’y met-il pas un peu de complaisance? Voici,
par exemple, dans une frisede la cathédrale de Strasbourg, un chien qui
danse au son d’un tambourin : « L’air piteux du pauvre danseur, dit le
père Cahier, et la corde qu’on lui tient passée au cou durant cet exercice
agréable, font bien voir que sa volonté ne s’y porte qu’à demi, et la
musicienne lui montre un visage qui signifie clairement qu’elle se sent sa
maîtresse. Puissance d’une malheureuse habitude sur le cœur qui s’aban-
donne dans les voies de l’iniquité ; il ne viendra plus à bout de briser
la chaîne qui lui fait honte... » L’explication morale peut être ingénieuse,
mais est-on bien sûr que l’artiste ait pensé à cela? Un chien qui danse
s’amuse en général assez peu, et si l’artiste lui a donné l’air piteux,
c’est peut-être simplement parce qu’il a observé que cela se passait ainsi
dans la nature. Mais continuons : voici maintenant une vieille femme