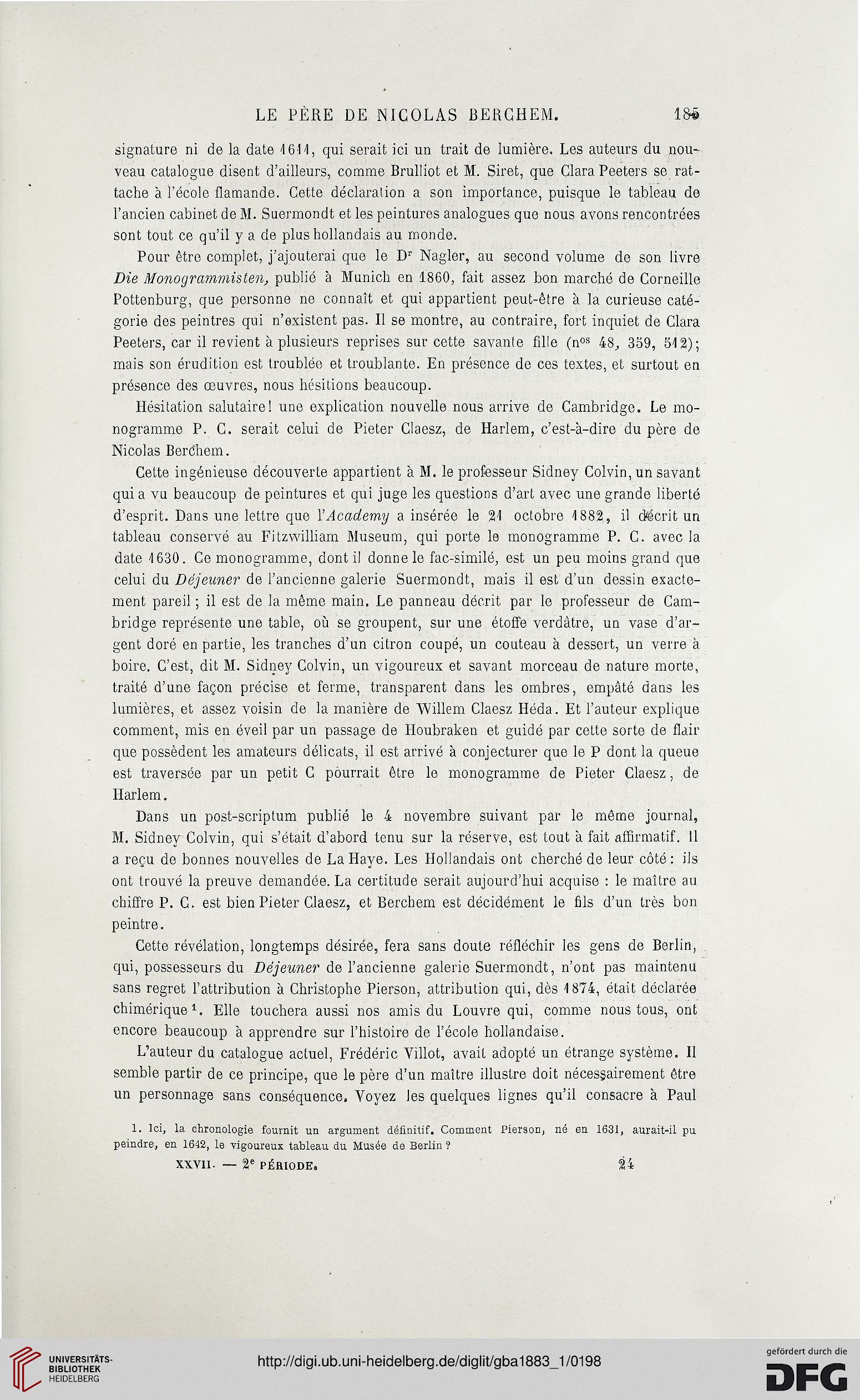LE PÈRE DE NICOLAS BERCHEM.
18*
signature ni de la date 1611, qui serait ici un trait de lumière. Les auteurs du nou-
veau catalogue disent d’ailleurs, comme Brulliot et M. Siret, que Clara Peeters se rat-
tache à l’école flamande. Cette déclaration a son importance, puisque le tableau de
l’ancien cabinet de M. Suermondt et les peintures analogues que nous avons rencontrées
sont tout ce qu’il y a de plus hollandais au monde.
Pour être complet, j’ajouterai que le Dr Nagler, au second volume de son livre
Die Monogrammisten, publié à Munich en 1860, fait assez bon marché de Corneille
Pottenburg, que personne ne connaît et qui appartient peut-être à la curieuse caté-
gorie des peintres qui n’existent pas. Il se montre, au contraire, fort inquiet de Clara
Peeters, car il revient à plusieurs reprises sur cette savante fille (nos 48, 359, 512);
mais son érudition est troublée et troublante. En présence de ces textes, et surtout en
présence des œuvres, nous hésitions beaucoup.
Hésitation salutaire! une explication nouvelle nous arrive de Cambridge. Le mo-
nogramme P. C. serait celui de Pieter Claesz, de Harlem, c’est-à-dire du père de
Nicolas Berchem.
Cette ingénieuse découverte appartient à M. le professeur Sidney Colvin, un savant
qui a vu beaucoup de peintures et qui juge les questions d’art avec une grande liberté
d’esprit. Dans une lettre que YAcademy a insérée le 21 octobre 1882, il décrit un
tableau conservé au Fitzwilliam Muséum, qui porte le monogramme P. C. avec la
date 1630. Ce monogramme, dont il donne le fac-similé, est un peu moins grand que
celui du Déjeuner de l’ancienne galerie Suermondt, mais il est d’un dessin exacte-
ment pareil ; il est de la même main. Le panneau décrit par le professeur de Cam-
bridge représente une table, où se groupent, sur une étoffe verdâtre, un vase d’ar-
gent doré en partie, les tranches d’un citron coupé, un couteau à dessert, un verre à
boire. C’est, dit M. Sidney Colvin, un vigoureux et savant morceau de nature morte,
traité d’une façon précise et ferme, transparent dans les ombres, empâté dans les
lumières, et assez voisin de la manière de Willem Claesz Héda. Et l’auteur explique
comment, mis en éveil par un passage de Iloubraken et guidé par cette sorte de flair
que possèdent les amateurs délicats, il est arrivé à conjecturer que le P dont la queue
est traversée par un petit C pourrait être le monogramme de Pieter Claesz, de
Harlem.
Dans un post-scriptum publié le 4 novembre suivant par le môme journal,
M. Sidney Colvin, qui s’était d’abord tenu sur la réserve, est tout à fait affirmatif. Il
a reçu de bonnes nouvelles de La Haye. Les Hollandais ont cherché de leur côté : ils
ont trouvé la preuve demandée. La certitude serait aujourd’hui acquise : le maître au
chiffre P. C. est bien Pieter Claesz, et Berchem est décidément le fils d’un très bon
peintre.
Cette révélation, longtemps désirée, fera sans doute réfléchir les gens de Berlin,
qui, possesseurs du Déjeuner de l’ancienne galerie Suermondt, n’ont pas maintenu
sans regret l’attribution à Christophe Pierson, attribution qui, dès 1874, était déclarée
chimérique1. Elle touchera aussi nos amis du Louvre qui, comme nous tous, ont
encore beaucoup à apprendre sur l’histoire de l’école hollandaise.
L’auteur du catalogue actuel, Frédéric Villot, avait adopté un étrange système. Il
semble partir de ce principe, que le père d’un maître illustre doit nécessairement être
un personnage sans conséquence. Voyez les quelques lignes qu’il consacre à Paul 1
1. Ici, la chronologie fournit un argument définitif. Comment Pierson, né en 1631, aurait-il pu
peindre, en 1642, le vigoureux tableau du Musée de Berlin ?
XXVII. — 2e PÉRIODE. 24
18*
signature ni de la date 1611, qui serait ici un trait de lumière. Les auteurs du nou-
veau catalogue disent d’ailleurs, comme Brulliot et M. Siret, que Clara Peeters se rat-
tache à l’école flamande. Cette déclaration a son importance, puisque le tableau de
l’ancien cabinet de M. Suermondt et les peintures analogues que nous avons rencontrées
sont tout ce qu’il y a de plus hollandais au monde.
Pour être complet, j’ajouterai que le Dr Nagler, au second volume de son livre
Die Monogrammisten, publié à Munich en 1860, fait assez bon marché de Corneille
Pottenburg, que personne ne connaît et qui appartient peut-être à la curieuse caté-
gorie des peintres qui n’existent pas. Il se montre, au contraire, fort inquiet de Clara
Peeters, car il revient à plusieurs reprises sur cette savante fille (nos 48, 359, 512);
mais son érudition est troublée et troublante. En présence de ces textes, et surtout en
présence des œuvres, nous hésitions beaucoup.
Hésitation salutaire! une explication nouvelle nous arrive de Cambridge. Le mo-
nogramme P. C. serait celui de Pieter Claesz, de Harlem, c’est-à-dire du père de
Nicolas Berchem.
Cette ingénieuse découverte appartient à M. le professeur Sidney Colvin, un savant
qui a vu beaucoup de peintures et qui juge les questions d’art avec une grande liberté
d’esprit. Dans une lettre que YAcademy a insérée le 21 octobre 1882, il décrit un
tableau conservé au Fitzwilliam Muséum, qui porte le monogramme P. C. avec la
date 1630. Ce monogramme, dont il donne le fac-similé, est un peu moins grand que
celui du Déjeuner de l’ancienne galerie Suermondt, mais il est d’un dessin exacte-
ment pareil ; il est de la même main. Le panneau décrit par le professeur de Cam-
bridge représente une table, où se groupent, sur une étoffe verdâtre, un vase d’ar-
gent doré en partie, les tranches d’un citron coupé, un couteau à dessert, un verre à
boire. C’est, dit M. Sidney Colvin, un vigoureux et savant morceau de nature morte,
traité d’une façon précise et ferme, transparent dans les ombres, empâté dans les
lumières, et assez voisin de la manière de Willem Claesz Héda. Et l’auteur explique
comment, mis en éveil par un passage de Iloubraken et guidé par cette sorte de flair
que possèdent les amateurs délicats, il est arrivé à conjecturer que le P dont la queue
est traversée par un petit C pourrait être le monogramme de Pieter Claesz, de
Harlem.
Dans un post-scriptum publié le 4 novembre suivant par le môme journal,
M. Sidney Colvin, qui s’était d’abord tenu sur la réserve, est tout à fait affirmatif. Il
a reçu de bonnes nouvelles de La Haye. Les Hollandais ont cherché de leur côté : ils
ont trouvé la preuve demandée. La certitude serait aujourd’hui acquise : le maître au
chiffre P. C. est bien Pieter Claesz, et Berchem est décidément le fils d’un très bon
peintre.
Cette révélation, longtemps désirée, fera sans doute réfléchir les gens de Berlin,
qui, possesseurs du Déjeuner de l’ancienne galerie Suermondt, n’ont pas maintenu
sans regret l’attribution à Christophe Pierson, attribution qui, dès 1874, était déclarée
chimérique1. Elle touchera aussi nos amis du Louvre qui, comme nous tous, ont
encore beaucoup à apprendre sur l’histoire de l’école hollandaise.
L’auteur du catalogue actuel, Frédéric Villot, avait adopté un étrange système. Il
semble partir de ce principe, que le père d’un maître illustre doit nécessairement être
un personnage sans conséquence. Voyez les quelques lignes qu’il consacre à Paul 1
1. Ici, la chronologie fournit un argument définitif. Comment Pierson, né en 1631, aurait-il pu
peindre, en 1642, le vigoureux tableau du Musée de Berlin ?
XXVII. — 2e PÉRIODE. 24