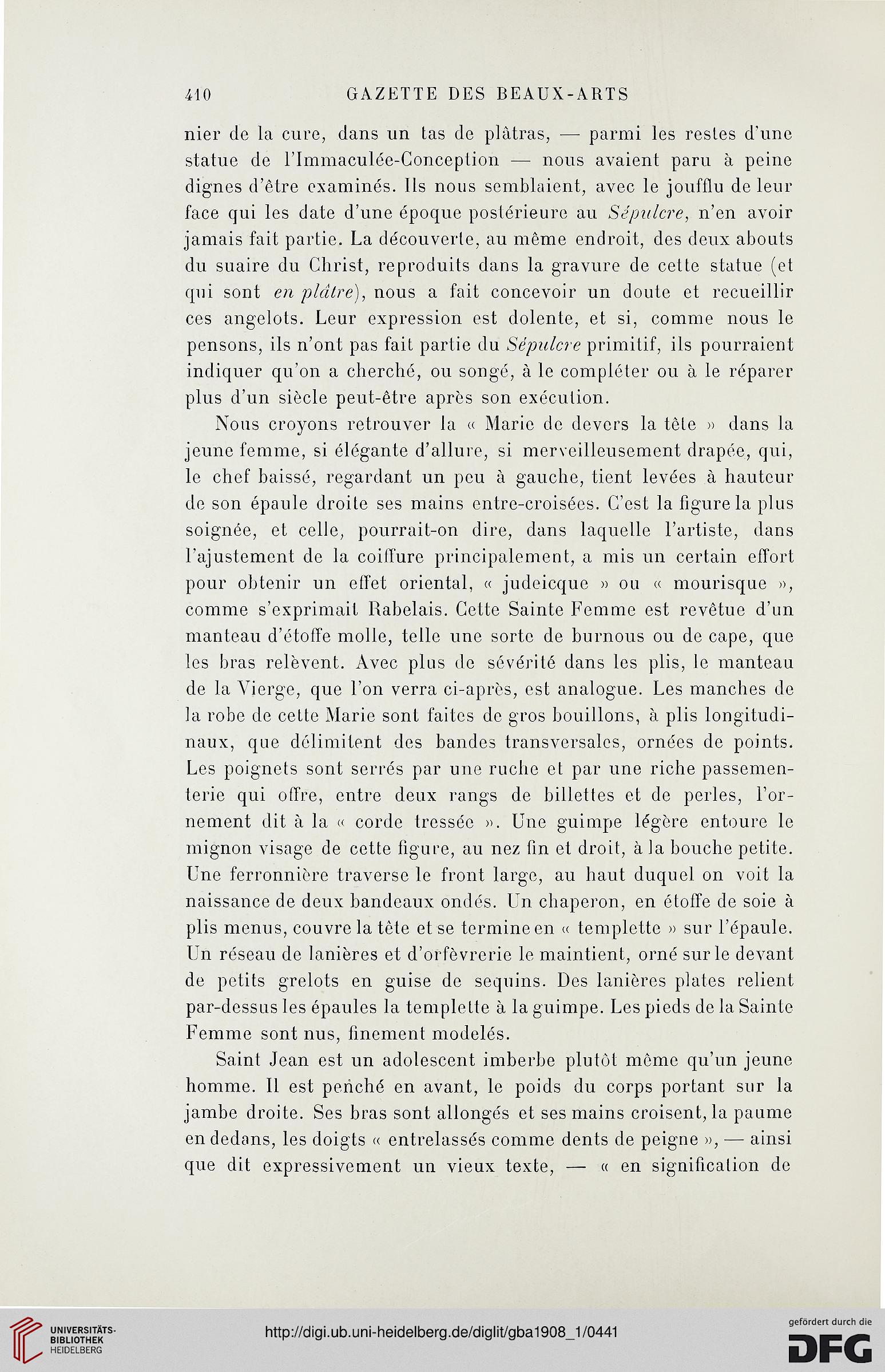410
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
nier de la cure, dans un tas de plâtras, — parmi les restes d'une
statue de rimmaculée-Conception — nous avaient paru à peine
dignes d’être examinés. Ils nous semblaient, avec le joufflu de leur
face qui les date d’une époque postérieure au Sépulcre, n’en avoir
jamais fait partie. La découverte, au même endroit, des deux abouts
du suaire du Christ, reproduits dans la gravure de cette statue (et
qui sont en plâtre), nous a fait concevoir un doute et recueillir
ces angelots. Leur expression est dolente, et si, comme nous le
pensons, ils n’ont pas fait partie du Sépulcre primitif, ils pourraient
indiquer qu’on a cherché, ou songé, à le compléter ou à le réparer
plus d’un siècle peut-être après son exécution.
Nous croyons retrouver la « Marie de devers la tête » dans la
jeune femme, si élégante d’allure, si merveilleusement drapée, qui,
le chef baissé, regardant un peu à gauche, tient levées à hauteur
de son épaule droite ses mains entre-croisées. C’est la figure la plus
soignée, et celle, pourrait-on dire, dans laquelle l’artiste, dans
l’ajustement de la coilîure principalement, a mis un certain effort
pour obtenir un effet oriental, « judeicque » ou « mourisque »,
comme s’exprimait Rabelais. Cette Sainte Femme est revêtue d’un
manteau d’étoffe molle, telle une sorte de burnous ou de cape, que
les bras relèvent. Avec plus de sévérité dans les plis, le manteau
de la Vierge, que l’on verra ci-après, est analogue. Les manches de
la robe de cette Marie sont faites de gros bouillons, à plis longitudi-
naux, que délimitent des bandes transversales, ornées de points.
Les poignets sont serrés par une ruche et par une riche passemen-
terie qui offre, entre deux rangs de billet tes et de perles, l’or-
nement dit à la « corde tressée ». Une guimpe légère entoure le
mignon visage de cette figure, au nez fin et droit, à la bouche petite.
Une ferronnière traverse le front large, au haut duquel on voit la
naissance de deux bandeaux ondés. Un chaperon, en étoffe de soie à
plis menus, couvre la tête et se termine en « templette » sur l’épaule.
Un réseau de lanières et d’orfèvrerie le maintient, orné sur le devant
de petits grelots en guise de sequins. Des lanières plates relient
par-dessus les épaules la templette à la guimpe. Les pieds de la Sainte
Femme sont nus, finement modelés.
Saint Jean est un adolescent imberbe plutôt même qu’un jeune
homme. Il est penché en avant, le poids du corps portant sur la
jambe droite. Ses bras sont allongés et ses mains croisent, la paume
en dedans, les doigts « entrelassés comme dents de peigne », — ainsi
que dit expressivement un vieux texte, — « en signification de
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
nier de la cure, dans un tas de plâtras, — parmi les restes d'une
statue de rimmaculée-Conception — nous avaient paru à peine
dignes d’être examinés. Ils nous semblaient, avec le joufflu de leur
face qui les date d’une époque postérieure au Sépulcre, n’en avoir
jamais fait partie. La découverte, au même endroit, des deux abouts
du suaire du Christ, reproduits dans la gravure de cette statue (et
qui sont en plâtre), nous a fait concevoir un doute et recueillir
ces angelots. Leur expression est dolente, et si, comme nous le
pensons, ils n’ont pas fait partie du Sépulcre primitif, ils pourraient
indiquer qu’on a cherché, ou songé, à le compléter ou à le réparer
plus d’un siècle peut-être après son exécution.
Nous croyons retrouver la « Marie de devers la tête » dans la
jeune femme, si élégante d’allure, si merveilleusement drapée, qui,
le chef baissé, regardant un peu à gauche, tient levées à hauteur
de son épaule droite ses mains entre-croisées. C’est la figure la plus
soignée, et celle, pourrait-on dire, dans laquelle l’artiste, dans
l’ajustement de la coilîure principalement, a mis un certain effort
pour obtenir un effet oriental, « judeicque » ou « mourisque »,
comme s’exprimait Rabelais. Cette Sainte Femme est revêtue d’un
manteau d’étoffe molle, telle une sorte de burnous ou de cape, que
les bras relèvent. Avec plus de sévérité dans les plis, le manteau
de la Vierge, que l’on verra ci-après, est analogue. Les manches de
la robe de cette Marie sont faites de gros bouillons, à plis longitudi-
naux, que délimitent des bandes transversales, ornées de points.
Les poignets sont serrés par une ruche et par une riche passemen-
terie qui offre, entre deux rangs de billet tes et de perles, l’or-
nement dit à la « corde tressée ». Une guimpe légère entoure le
mignon visage de cette figure, au nez fin et droit, à la bouche petite.
Une ferronnière traverse le front large, au haut duquel on voit la
naissance de deux bandeaux ondés. Un chaperon, en étoffe de soie à
plis menus, couvre la tête et se termine en « templette » sur l’épaule.
Un réseau de lanières et d’orfèvrerie le maintient, orné sur le devant
de petits grelots en guise de sequins. Des lanières plates relient
par-dessus les épaules la templette à la guimpe. Les pieds de la Sainte
Femme sont nus, finement modelés.
Saint Jean est un adolescent imberbe plutôt même qu’un jeune
homme. Il est penché en avant, le poids du corps portant sur la
jambe droite. Ses bras sont allongés et ses mains croisent, la paume
en dedans, les doigts « entrelassés comme dents de peigne », — ainsi
que dit expressivement un vieux texte, — « en signification de