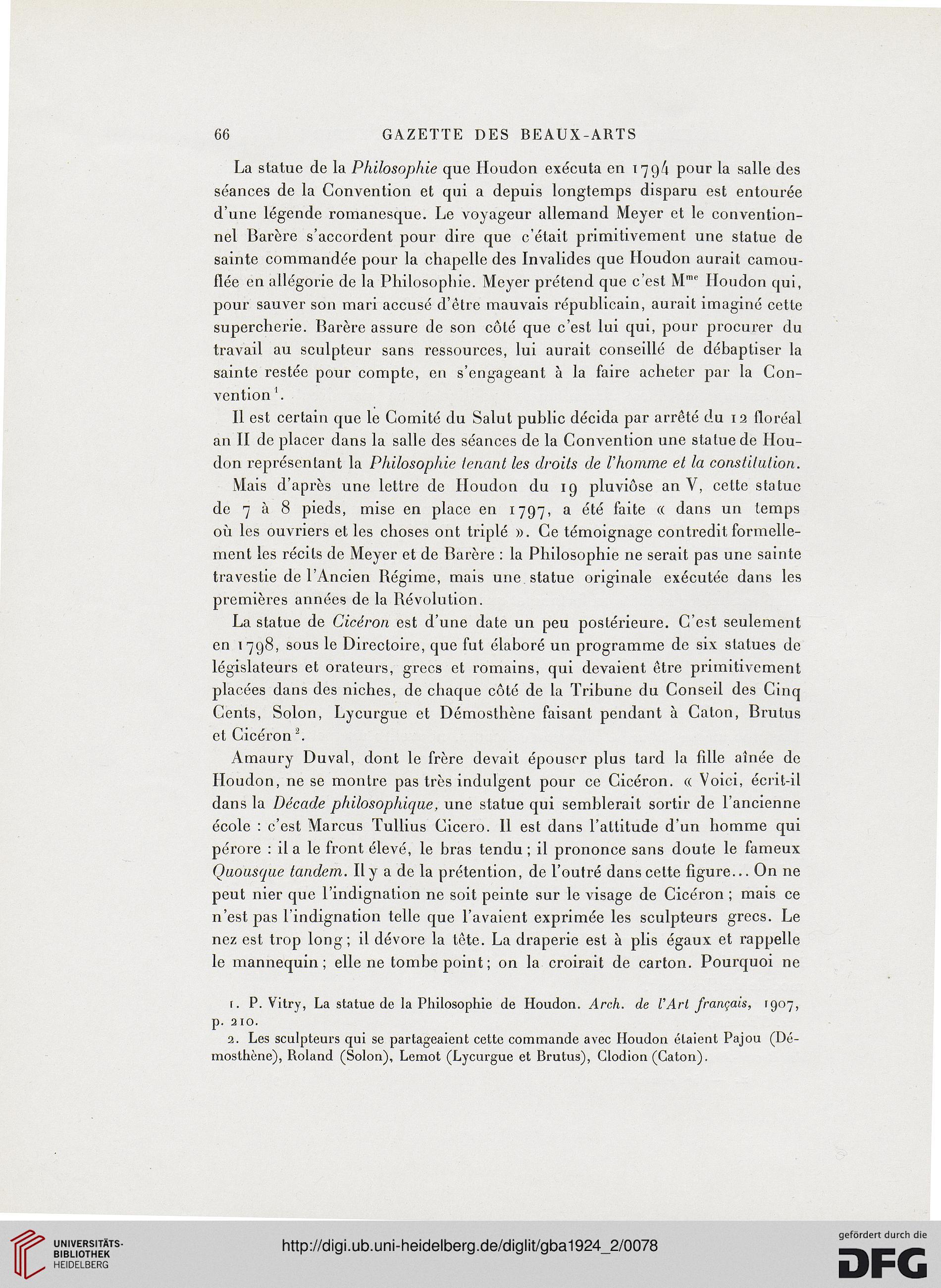66
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
La statue de la Philosophie que Iloudon exécuta en 179/i pour la salle des
séances de la Convention et qui a depuis longtemps disparu est entourée
d’une légende romanesque. Le voyageur allemand Meyer et le convention-
nel Barère s’accordent pour dire que c’était primitivement une statue de
sainte commandée pour la chapelle des Invalides que Houdon aurait camou-
flée en allégorie de la Philosophie. Meyer prétend que c’est Mme Houdon qui,
pour sauver son mari accusé d’être mauvais républicain, aurait imaginé cette
supercherie. Barère assure de son côté que c’est lui qui, pour procurer du
travail au sculpteur sans ressources, lui aurait conseillé de débaptiser la
sainte restée pour compte, en s’engageant à la faire acheter par la Con-
vention1.
11 est certain que le Comité du Salut public décida par arrêté du 12 floréal
an II de placer dans la salle des séances de la Convention une statue de Hou-
don représentant la Philosophie tenant les droits de l’homme et la constitution.
Mais d’après une lettre de Houdon du ig pluviôse an V, cette statue
de 7 à 8 pieds, mise en place en 1797, a été faite « dans un temps
où les ouvriers et les choses ont triplé ». Ce témoignage contredit formelle-
ment les récits de Meyer et de Barère : la Philosophie ne serait pas une sainte
travestie de l’Ancien Régime, mais une statue originale exécutée dans les
premières années de la Révolution.
La statue de Cicéron est d’une date un peu postérieure. C’est seulement
en 1798, sous le Directoire, que fut élaboré un programme de six statues de
législateurs et orateurs, grecs et romains, qui devaient être primitivement
placées dans des niches, de chaque côté de la Tribune du Conseil des Cinq
Cents, Solon, Lycurgue et Démosthène faisant pendant à Caton, Brutus
et Cicéron2.
Amaury Duval, dont le frère devait épouser plus tard la fille aînée de
Houdon, ne se montre pas très indulgent pour ce Cicéron. « Voici, écrit-il
dans la Décade philosophique, une statue qui semblerait sortir de l’ancienne
école : c’est Marcus Tullius Cicero. 11 est dans l’attitude d’un homme qui
pérore : il a le front élevé, le bras tendu; il prononce sans doute le fameux
Quousque tandem. Il y a de la prétention, de l’outré dans cette figure... On ne
peut nier que l’indignation ne soit peinte sur le visage de Cicéron ; mais ce
n’est pas l’indignation telle que l’avaient exprimée les sculpteurs grecs. Le
nez est trop long; il dévore la tête. La draperie est à plis égaux et rappelle
le mannequin; elle ne tombe point; on la croirait de carton. Pourquoi ne
[. P. Vitry, La statue de la Philosophie de Houdon. Arch. de l’Art français, (907,
p. 210.
2. Les sculpteurs qui se partageaient cette commande avec Houdon étaient Pajou (Dé-
mosthène), Roland (Solon), Lemot (Lycurgue et Brutus), Clodion (Caton).
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
La statue de la Philosophie que Iloudon exécuta en 179/i pour la salle des
séances de la Convention et qui a depuis longtemps disparu est entourée
d’une légende romanesque. Le voyageur allemand Meyer et le convention-
nel Barère s’accordent pour dire que c’était primitivement une statue de
sainte commandée pour la chapelle des Invalides que Houdon aurait camou-
flée en allégorie de la Philosophie. Meyer prétend que c’est Mme Houdon qui,
pour sauver son mari accusé d’être mauvais républicain, aurait imaginé cette
supercherie. Barère assure de son côté que c’est lui qui, pour procurer du
travail au sculpteur sans ressources, lui aurait conseillé de débaptiser la
sainte restée pour compte, en s’engageant à la faire acheter par la Con-
vention1.
11 est certain que le Comité du Salut public décida par arrêté du 12 floréal
an II de placer dans la salle des séances de la Convention une statue de Hou-
don représentant la Philosophie tenant les droits de l’homme et la constitution.
Mais d’après une lettre de Houdon du ig pluviôse an V, cette statue
de 7 à 8 pieds, mise en place en 1797, a été faite « dans un temps
où les ouvriers et les choses ont triplé ». Ce témoignage contredit formelle-
ment les récits de Meyer et de Barère : la Philosophie ne serait pas une sainte
travestie de l’Ancien Régime, mais une statue originale exécutée dans les
premières années de la Révolution.
La statue de Cicéron est d’une date un peu postérieure. C’est seulement
en 1798, sous le Directoire, que fut élaboré un programme de six statues de
législateurs et orateurs, grecs et romains, qui devaient être primitivement
placées dans des niches, de chaque côté de la Tribune du Conseil des Cinq
Cents, Solon, Lycurgue et Démosthène faisant pendant à Caton, Brutus
et Cicéron2.
Amaury Duval, dont le frère devait épouser plus tard la fille aînée de
Houdon, ne se montre pas très indulgent pour ce Cicéron. « Voici, écrit-il
dans la Décade philosophique, une statue qui semblerait sortir de l’ancienne
école : c’est Marcus Tullius Cicero. 11 est dans l’attitude d’un homme qui
pérore : il a le front élevé, le bras tendu; il prononce sans doute le fameux
Quousque tandem. Il y a de la prétention, de l’outré dans cette figure... On ne
peut nier que l’indignation ne soit peinte sur le visage de Cicéron ; mais ce
n’est pas l’indignation telle que l’avaient exprimée les sculpteurs grecs. Le
nez est trop long; il dévore la tête. La draperie est à plis égaux et rappelle
le mannequin; elle ne tombe point; on la croirait de carton. Pourquoi ne
[. P. Vitry, La statue de la Philosophie de Houdon. Arch. de l’Art français, (907,
p. 210.
2. Les sculpteurs qui se partageaient cette commande avec Houdon étaient Pajou (Dé-
mosthène), Roland (Solon), Lemot (Lycurgue et Brutus), Clodion (Caton).