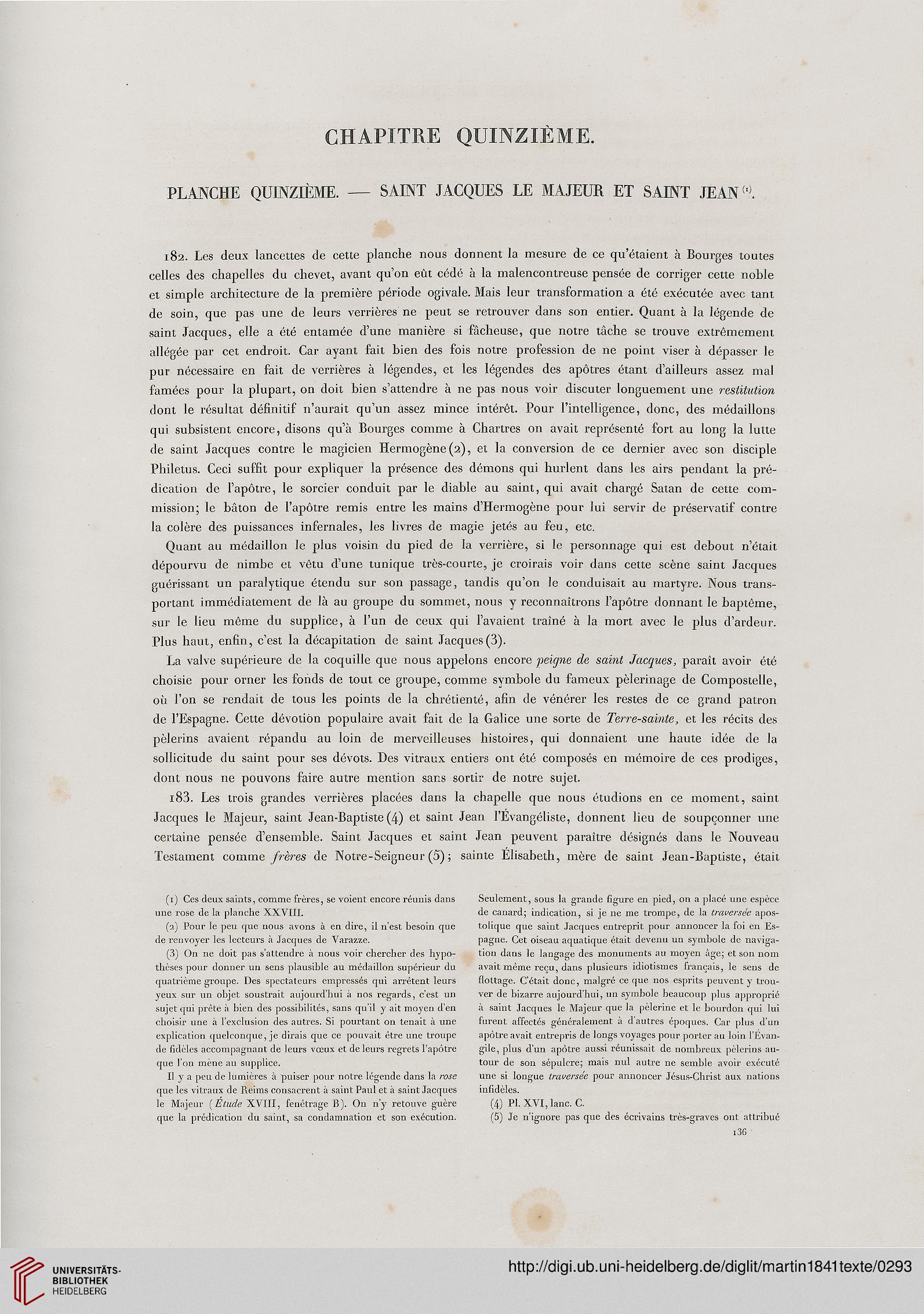CHAPITRE QUINZIÈME
PLANCHE QUINZIÈME. — SAINT JACQUES LE MAJEUR ET SAINT JEAN(I).
182. Les deux lancettes de cette planche nous donnent la mesure de ce qu'étaient à Bourges toutes
celles des chapelles du chevet, avant qu'on eût cédé à la malencontreuse pensée de corriger cette noble
et simple architecture de la première période ogivale. Mais leur transformation a été exécutée avec tant
de soin, que pas une de leurs verrières ne peut se retrouver dans son entier. Quant à la légende de
saint Jacques, elle a été entamée d'une manière si fâcheuse, que notre tâche se trouve extrêmement
allégée par cet endroit. Car ayant fait bien des fois notre profession de ne point viser à dépasser le
pur nécessaire en fait de verrières à légendes, et les légendes des apôtres étant d'ailleurs assez mal
famées pour la plupart, on doit bien s'attendre à ne pas nous voir discuter longuement une restitution
dont le résultat définitif n'aurait qu'un assez mince intérêt. Pour l'intelligence, donc, des médaillons
qui subsistent encore, disons qu'à Bourges comme à Chartres on avait représenté fort au long la lutte
de saint Jacques contre le magicien Hermogène (2), et la conversion de ce dernier avec son disciple
Philetus. Ceci suffit pour expliquer la présence des démons qui hurlent dans les airs pendant la pré-
dication de l'apôtre, le sorcier conduit par le diable au saint, qui avait chargé Satan de cette com-
mission; le bâton de l'apôtre remis entre les mains d'Hermogène pour lui servir de préservatif contre
la colère des puissances infernales, les livres de magie jetés au feu, etc.
Quant au médaillon le plus voisin du pied de la verrière, si le personnage qui est debout n'était
dépourvu de nimbe et vêtu d'une tunique très-courte, je croirais voir dans cette scène saint Jacques
guérissant un paralytique étendu sur son passage, tandis qu'on le conduisait au martyre. Nous trans-
portant immédiatement de là au groupe du sommet, nous y reconnaîtrons l'apôtre donnant le baptême,
sur le lieu même du supplice, à l'un de ceux qui l'avaient traîné à la mort avec le plus d'ardeur.
Plus haut, enfin, c'est la décapitation de saint Jacques(3).
La valve supérieure de la coquille que nous appelons encore peigne de saint Jacques, paraît avoir été
choisie pour orner les fonds de tout ce groupe, comme symbole du fameux pèlerinage de Compostelle,
où l'on se rendait de tous les points de la chrétienté, afin de vénérer les restes de ce grand patron
de l'Espagne. Cette dévotion populaire avait fait de la Galice une sorte de Terre-sainte, et les récits des
pèlerins avaient répandu au loin de merveilleuses histoires, qui donnaient une haute idée de la
sollicitude du saint pour ses dévots. Des vitraux entiers ont été composés en mémoire de ces prodiges,
dont nous ne pouvons faire autre mention sans sortir de notre sujet.
i83. Les trois grandes verrières placées dans la chapelle que nous étudions en ce moment, saint
Jacques le Majeur, saint Jean-Baptiste (4) et saint Jean l'Évangéliste, donnent lieu de soupçonner une
certaine pensée d'ensemble. Saint Jacques et saint Jean peuvent paraître désignés dans le Nouveau
Testament comme frères de Notre-Seigneur (5) ; sainte Elisabeth, mère de saint Jean-Baptiste, était
(1) Ces deux saints, comme frères, se voient encore réunis dans
une rose de la planche XXVIII.
(2) Pour le peu que nous avons à en dire, il n'est besoin que
de renvoyer les lecteurs à Jacques de Varazze.
(3) On ne doit pas s'attendre à nous voir chercher des hypo-
thèses pour donner un sens plausible au médaillon supérieur du
quatrième groupe. Des spectateurs empressés qui arrêtent leurs
yeux sur un objet soustrait aujourd'hui à nos regards, c'est un
sujet qui prête à bien des possibilités, sans qu'il y ait moyen d'en
choisir une à l'exclusion des autres. Si pourtant on tenait à une
explication quelconque, je dirais que ce pouvait être une troupe
de fidèles accompagnant de leurs vœux et de leurs regrets l'apôtre
que l'on mène au supplice.
Il y a peu de lumières à puiser pour notre légende dans la rose
que les vitraux de Reims consacrent à saint Paul et à saint Jacques
le Majeur [Etude XVIII, fenêtrage B). On n'y retouve guère
que la prédication du saint, sa condamnation et son exécution.
Seulement, sous la grande figure en pied, on a placé une espèce
de canard; indication, si je ne me trompe, de la traversée apos-
tolique que saint Jacques entreprit pour annoncer la foi en Es-
pagne. Cet oiseau aquatique était devenu un symbole de naviga-
tion dans le langage des monuments au moyen âge; et son nom
avait même reçu, dans plusieurs idiotismes français, le sens de
flottage. C'était donc, malgré ce que nos esprits peuvent y trou-
ver de bizarre aujourd'hui, un symbole beaucoup plus approprié
à saint Jacques le Majeur que la pèlerine et le bourdon qui lui
furent affectés généralement à d'autres époques. Car plus d'un
apôtre avait entrepris de longs voyages pour porter au loin l'Évan-
gile, plus d'un apôtre aussi réunissait de nombreux pèlerins au-
tour de son sépulcre; mais nul autre ne semble avoir exécuté
une si longue traversée pour annoncer Jésus-Christ aux nations
infidèles.
(4) Pl. XVI,lanc. C.
(5) Je n'ignore pas que des écrivains très-graves ont attribué
i36
PLANCHE QUINZIÈME. — SAINT JACQUES LE MAJEUR ET SAINT JEAN(I).
182. Les deux lancettes de cette planche nous donnent la mesure de ce qu'étaient à Bourges toutes
celles des chapelles du chevet, avant qu'on eût cédé à la malencontreuse pensée de corriger cette noble
et simple architecture de la première période ogivale. Mais leur transformation a été exécutée avec tant
de soin, que pas une de leurs verrières ne peut se retrouver dans son entier. Quant à la légende de
saint Jacques, elle a été entamée d'une manière si fâcheuse, que notre tâche se trouve extrêmement
allégée par cet endroit. Car ayant fait bien des fois notre profession de ne point viser à dépasser le
pur nécessaire en fait de verrières à légendes, et les légendes des apôtres étant d'ailleurs assez mal
famées pour la plupart, on doit bien s'attendre à ne pas nous voir discuter longuement une restitution
dont le résultat définitif n'aurait qu'un assez mince intérêt. Pour l'intelligence, donc, des médaillons
qui subsistent encore, disons qu'à Bourges comme à Chartres on avait représenté fort au long la lutte
de saint Jacques contre le magicien Hermogène (2), et la conversion de ce dernier avec son disciple
Philetus. Ceci suffit pour expliquer la présence des démons qui hurlent dans les airs pendant la pré-
dication de l'apôtre, le sorcier conduit par le diable au saint, qui avait chargé Satan de cette com-
mission; le bâton de l'apôtre remis entre les mains d'Hermogène pour lui servir de préservatif contre
la colère des puissances infernales, les livres de magie jetés au feu, etc.
Quant au médaillon le plus voisin du pied de la verrière, si le personnage qui est debout n'était
dépourvu de nimbe et vêtu d'une tunique très-courte, je croirais voir dans cette scène saint Jacques
guérissant un paralytique étendu sur son passage, tandis qu'on le conduisait au martyre. Nous trans-
portant immédiatement de là au groupe du sommet, nous y reconnaîtrons l'apôtre donnant le baptême,
sur le lieu même du supplice, à l'un de ceux qui l'avaient traîné à la mort avec le plus d'ardeur.
Plus haut, enfin, c'est la décapitation de saint Jacques(3).
La valve supérieure de la coquille que nous appelons encore peigne de saint Jacques, paraît avoir été
choisie pour orner les fonds de tout ce groupe, comme symbole du fameux pèlerinage de Compostelle,
où l'on se rendait de tous les points de la chrétienté, afin de vénérer les restes de ce grand patron
de l'Espagne. Cette dévotion populaire avait fait de la Galice une sorte de Terre-sainte, et les récits des
pèlerins avaient répandu au loin de merveilleuses histoires, qui donnaient une haute idée de la
sollicitude du saint pour ses dévots. Des vitraux entiers ont été composés en mémoire de ces prodiges,
dont nous ne pouvons faire autre mention sans sortir de notre sujet.
i83. Les trois grandes verrières placées dans la chapelle que nous étudions en ce moment, saint
Jacques le Majeur, saint Jean-Baptiste (4) et saint Jean l'Évangéliste, donnent lieu de soupçonner une
certaine pensée d'ensemble. Saint Jacques et saint Jean peuvent paraître désignés dans le Nouveau
Testament comme frères de Notre-Seigneur (5) ; sainte Elisabeth, mère de saint Jean-Baptiste, était
(1) Ces deux saints, comme frères, se voient encore réunis dans
une rose de la planche XXVIII.
(2) Pour le peu que nous avons à en dire, il n'est besoin que
de renvoyer les lecteurs à Jacques de Varazze.
(3) On ne doit pas s'attendre à nous voir chercher des hypo-
thèses pour donner un sens plausible au médaillon supérieur du
quatrième groupe. Des spectateurs empressés qui arrêtent leurs
yeux sur un objet soustrait aujourd'hui à nos regards, c'est un
sujet qui prête à bien des possibilités, sans qu'il y ait moyen d'en
choisir une à l'exclusion des autres. Si pourtant on tenait à une
explication quelconque, je dirais que ce pouvait être une troupe
de fidèles accompagnant de leurs vœux et de leurs regrets l'apôtre
que l'on mène au supplice.
Il y a peu de lumières à puiser pour notre légende dans la rose
que les vitraux de Reims consacrent à saint Paul et à saint Jacques
le Majeur [Etude XVIII, fenêtrage B). On n'y retouve guère
que la prédication du saint, sa condamnation et son exécution.
Seulement, sous la grande figure en pied, on a placé une espèce
de canard; indication, si je ne me trompe, de la traversée apos-
tolique que saint Jacques entreprit pour annoncer la foi en Es-
pagne. Cet oiseau aquatique était devenu un symbole de naviga-
tion dans le langage des monuments au moyen âge; et son nom
avait même reçu, dans plusieurs idiotismes français, le sens de
flottage. C'était donc, malgré ce que nos esprits peuvent y trou-
ver de bizarre aujourd'hui, un symbole beaucoup plus approprié
à saint Jacques le Majeur que la pèlerine et le bourdon qui lui
furent affectés généralement à d'autres époques. Car plus d'un
apôtre avait entrepris de longs voyages pour porter au loin l'Évan-
gile, plus d'un apôtre aussi réunissait de nombreux pèlerins au-
tour de son sépulcre; mais nul autre ne semble avoir exécuté
une si longue traversée pour annoncer Jésus-Christ aux nations
infidèles.
(4) Pl. XVI,lanc. C.
(5) Je n'ignore pas que des écrivains très-graves ont attribué
i36