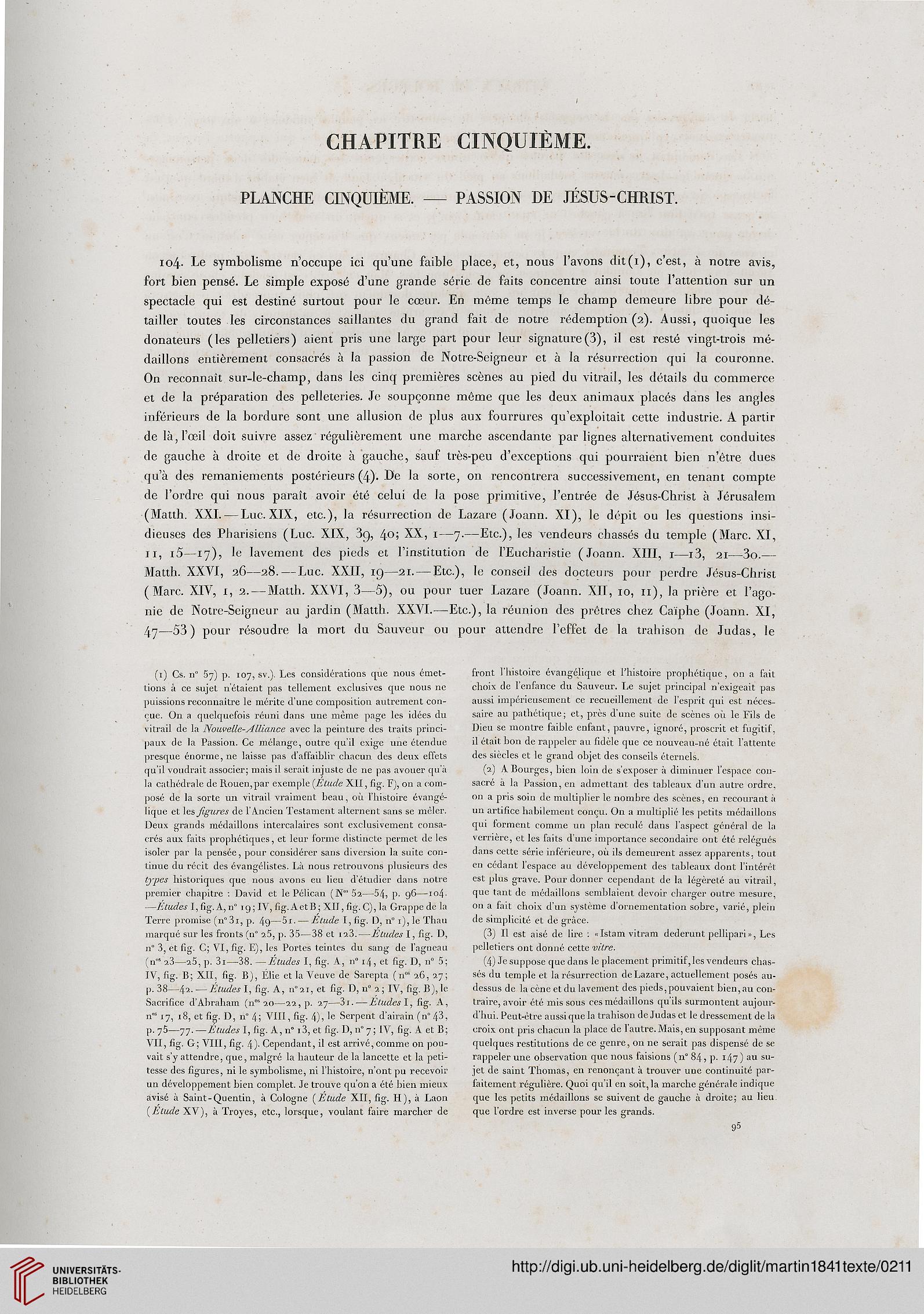I
CHAPITRE CINQUIÈME.
PLANCHE CINQUIÈME. — PASSION DE JÉSUS-CHRIST.
io4- Le symbolisme n'occupe ici qu'une faible place, et, nous l'avons dit(i), c'est, à notre avis,
fort bien pensé. Le simple exposé d'une grande série de faits concentre ainsi toute l'attention sur un
spectacle qui est destiné surtout pour le cœur. En même temps le champ demeure libre pour dé-
tailler toutes les circonstances saillantes du grand fait de notre rédemption (2). Aussi, quoique les
donateurs (les pelletiers) aient pris une large part pour leur signature(3), il est resté vingt-trois mé-
daillons entièrement consacrés à la passion de Notre-Seigneur et à la résurrection qui la couronne.
On reconnaît sur-le-champ, dans les cinq premières scènes au pied du vitrail, les détails du commerce
et de la préparation des pelleteries. Je soupçonne même que les deux animaux placés dans les angles
inférieurs de la bordure sont une allusion de plus aux fourrures qu'exploitait cette industrie. A partir
de là, l'œil doit suivre assez régulièrement une marche ascendante par lignes alternativement conduites
de gauche à droite et de droite à gauche, sauf très-peu d'exceptions qui pourraient bien n'être dues
qu'à des remaniements postérieurs (4). De la sorte, on rencontrera successivement, en tenant compte
de l'ordre qui nous paraît avoir été celui de la pose primitive, l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem
(Matth. XXI.—Luc. XIX, etc.), la résurrection de Lazare (Joann. XI), le dépit ou les questions insi-
dieuses des Pharisiens (Luc. XIX, 3g, 4°? XX, 1—7.—Etc.), les vendeurs chassés du temple (Marc. XI,
11, i5—17), le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie (Joann. XIII, 1—13, 21—3o.—
Matth. XXVI, 26—28. — Luc. XXII, 19—21. — Etc.), le conseil des docteurs pour perdre Jésus-Christ
(Marc. XIV, 1, 2. — Matth. XXVI, 3—5), ou pour tuer Lazare (Joann. XII, 10, 11), la prière et l'ago-
nie de Notre-Seigneur au jardin (Matth. XXVI.—Etc.), la réunion des prêtres chez Caïphe (Joann. XI,
47—53) pour résoudre la mort du Sauveur ou pour attendre l'effet de la trahison de Judas, le
(1) Cs. n° 57) p. 107, sv.). Les considérations que nous émet-
tions à ce sujet n'étaient pas tellement exclusives que nous ne
puissions reconnaître le mérite d'une composition autrement con-
çue. On a quelquefois réuni dans une même page les idées du
vitrail de la Nouvelle-Alliance avec la peinture des traits princi-
paux de la Passion. Ce mélange, outre qu'il exige une étendue
presque énorme, ne laisse pas d'affaiblir chacun des deux effets
qu'il voudrait associer; mais il serait injuste de ne pas avouer qu'à
la cathédrale de Rouen, par exemple [Etude XII, fig. F), on a com-
posé de la sorte un vitrail vraiment beau, où l'histoire évangé-
lique et les figures de l'Ancien Testament alternent sans se mêler.
Deux grands médaillons intercalaires sont exclusivement Cousa-
it
crés aux faits prophétiques, et leur forme distincte permet de les
isoler par la pensée, pour considérer sans diversion la suite con-
tinue du récit des évangélistes. Là nous retrouvons plusieurs des
types historiques que nous avons eu lieu d'étudier dans notre
premier chapitre : David et le Pélican (Nos 5a—54, p. 96—io4-
—Etudes I, fig. A, n° 19; IV, fig. A et B ; XII, fig. C), la Grappe de la
Terre promise (n°3i, p. 49—5i.— Etude I, fig. D, n° 1), le Thau
marqué sur les fronts (n° 25, p. 35—38 et 12.3.—Etudes I, fig. D,
n° 3, et fig. C; VI, fig. E), les Portes teintes du sang de l'agneau
(nos iZ—25, p. 3i—38. —Études I, fig. A, n° 14 , et fig. D, n° 5;
IV, fig. B; XII, fig. B), Élie et la Veuve de Sarepta ( nos 26, 27;
|). 38—42. — Études I, fig. A, n°21, et fig. D, n° 2; IV, fig. B), le
Sacrifice d'Abraham (nos 20—22, p. 27—3i. — Etudes!, fig. A,
nos 17, 18, et fig. D, n° 4; VIII, fig. 4), le Serpent d'airain (n° 43,
p. 75—77.—Études I, fig. A, n° i3, et fig. D, n° 7; IV, fig. A et B;
VII, fig. G; VIII, fig. 4)- Cependant, il est arrivé, comme on pou-
vait s'y attendre, que, malgré la hauteur de la lancette et la peti-
tesse des figures, ni le symbolisme, ni l'histoire, n'ont pu recevoir
un développement bien complet. Je trouve qu'on a été bien mieux
avisé à Saint-Quentin, à Cologne [Etude XII, fig. H), à Laon
[Etude XV), à Troyes, etc., lorsque, voulant faire marcher de
front l'histoire évangélique et l'histoire prophétique, on a fait
choix de l'enfance du Sauveur. Le sujet principal n'exigeait pas
aussi impérieusement ce recueillement de l'esprit qui est néces-
saire au pathétique; et, près d'une suite de scènes où le Fils de
Dieu se montre faible enfant, pauvre, ignoré, proscrit et fugitif,
il était bon de rappeler au fidèle que ce nouveau-né était l'attente
des siècles et le grand objet des conseils éternels.
(2) A Bourges, bien loin de s'exposer à diminuer l'espace con-
sacré à la Passion, en admettant, des tableaux d'un autre ordre,
on a pris soin de multiplier le nombre des scènes, en recourant à
un artifice habilement conçu. On a multiplié les petits médaillons
qui forment comme un plan reculé dans l'aspect général de la
verrière, et les faits d'une importance secondaire ont été relégués
dans cette série inférieure, où ils demeurent assez apparents, tout
en cédant l'espace au développement des tableaux dont l'intérêt
est plus grave. Pour donner cependant de la légèreté au vitrail,
que tant de médaillons semblaient devoir charger outre mesure,
on a fait choix d'un système d'ornementation sobre, varié, plein
de simplicité et de grâce.
(3) Il est aisé de lire : «Istam vitram dederunt pellipari», Les
pelletiers ont donné cette vitre.
(4) Je suppose que dans le placement primitif, les vendeurs chas-
sés du temple et la résurrection de Lazare, actuellement posés au-
dessus de la cène et du lavement des pieds,pouvaient bien, au con-
traire, avoir été mis sous ces médaillons qu'ils surmontent aujour-
d'hui. Peut-être aussi que la trahison de Judas et le dressement de la
croix ont pris chacun la place de l'autre.Mais, en supposant même
quelques restitutions de ce genre, on ne serait pas dispensé de se
rappeler une observation que nous faisions (n° 84, p. 147) au su-
jet de saint Thomas, en renonçant à trouver une continuité par-
faitement régulière. Quoi qu'il en soit, la marche générale indique
que les petits médaillons se suivent de gauche à droite; au lieu
que l'ordre est inverse pour les grands.
95
CHAPITRE CINQUIÈME.
PLANCHE CINQUIÈME. — PASSION DE JÉSUS-CHRIST.
io4- Le symbolisme n'occupe ici qu'une faible place, et, nous l'avons dit(i), c'est, à notre avis,
fort bien pensé. Le simple exposé d'une grande série de faits concentre ainsi toute l'attention sur un
spectacle qui est destiné surtout pour le cœur. En même temps le champ demeure libre pour dé-
tailler toutes les circonstances saillantes du grand fait de notre rédemption (2). Aussi, quoique les
donateurs (les pelletiers) aient pris une large part pour leur signature(3), il est resté vingt-trois mé-
daillons entièrement consacrés à la passion de Notre-Seigneur et à la résurrection qui la couronne.
On reconnaît sur-le-champ, dans les cinq premières scènes au pied du vitrail, les détails du commerce
et de la préparation des pelleteries. Je soupçonne même que les deux animaux placés dans les angles
inférieurs de la bordure sont une allusion de plus aux fourrures qu'exploitait cette industrie. A partir
de là, l'œil doit suivre assez régulièrement une marche ascendante par lignes alternativement conduites
de gauche à droite et de droite à gauche, sauf très-peu d'exceptions qui pourraient bien n'être dues
qu'à des remaniements postérieurs (4). De la sorte, on rencontrera successivement, en tenant compte
de l'ordre qui nous paraît avoir été celui de la pose primitive, l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem
(Matth. XXI.—Luc. XIX, etc.), la résurrection de Lazare (Joann. XI), le dépit ou les questions insi-
dieuses des Pharisiens (Luc. XIX, 3g, 4°? XX, 1—7.—Etc.), les vendeurs chassés du temple (Marc. XI,
11, i5—17), le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie (Joann. XIII, 1—13, 21—3o.—
Matth. XXVI, 26—28. — Luc. XXII, 19—21. — Etc.), le conseil des docteurs pour perdre Jésus-Christ
(Marc. XIV, 1, 2. — Matth. XXVI, 3—5), ou pour tuer Lazare (Joann. XII, 10, 11), la prière et l'ago-
nie de Notre-Seigneur au jardin (Matth. XXVI.—Etc.), la réunion des prêtres chez Caïphe (Joann. XI,
47—53) pour résoudre la mort du Sauveur ou pour attendre l'effet de la trahison de Judas, le
(1) Cs. n° 57) p. 107, sv.). Les considérations que nous émet-
tions à ce sujet n'étaient pas tellement exclusives que nous ne
puissions reconnaître le mérite d'une composition autrement con-
çue. On a quelquefois réuni dans une même page les idées du
vitrail de la Nouvelle-Alliance avec la peinture des traits princi-
paux de la Passion. Ce mélange, outre qu'il exige une étendue
presque énorme, ne laisse pas d'affaiblir chacun des deux effets
qu'il voudrait associer; mais il serait injuste de ne pas avouer qu'à
la cathédrale de Rouen, par exemple [Etude XII, fig. F), on a com-
posé de la sorte un vitrail vraiment beau, où l'histoire évangé-
lique et les figures de l'Ancien Testament alternent sans se mêler.
Deux grands médaillons intercalaires sont exclusivement Cousa-
it
crés aux faits prophétiques, et leur forme distincte permet de les
isoler par la pensée, pour considérer sans diversion la suite con-
tinue du récit des évangélistes. Là nous retrouvons plusieurs des
types historiques que nous avons eu lieu d'étudier dans notre
premier chapitre : David et le Pélican (Nos 5a—54, p. 96—io4-
—Etudes I, fig. A, n° 19; IV, fig. A et B ; XII, fig. C), la Grappe de la
Terre promise (n°3i, p. 49—5i.— Etude I, fig. D, n° 1), le Thau
marqué sur les fronts (n° 25, p. 35—38 et 12.3.—Etudes I, fig. D,
n° 3, et fig. C; VI, fig. E), les Portes teintes du sang de l'agneau
(nos iZ—25, p. 3i—38. —Études I, fig. A, n° 14 , et fig. D, n° 5;
IV, fig. B; XII, fig. B), Élie et la Veuve de Sarepta ( nos 26, 27;
|). 38—42. — Études I, fig. A, n°21, et fig. D, n° 2; IV, fig. B), le
Sacrifice d'Abraham (nos 20—22, p. 27—3i. — Etudes!, fig. A,
nos 17, 18, et fig. D, n° 4; VIII, fig. 4), le Serpent d'airain (n° 43,
p. 75—77.—Études I, fig. A, n° i3, et fig. D, n° 7; IV, fig. A et B;
VII, fig. G; VIII, fig. 4)- Cependant, il est arrivé, comme on pou-
vait s'y attendre, que, malgré la hauteur de la lancette et la peti-
tesse des figures, ni le symbolisme, ni l'histoire, n'ont pu recevoir
un développement bien complet. Je trouve qu'on a été bien mieux
avisé à Saint-Quentin, à Cologne [Etude XII, fig. H), à Laon
[Etude XV), à Troyes, etc., lorsque, voulant faire marcher de
front l'histoire évangélique et l'histoire prophétique, on a fait
choix de l'enfance du Sauveur. Le sujet principal n'exigeait pas
aussi impérieusement ce recueillement de l'esprit qui est néces-
saire au pathétique; et, près d'une suite de scènes où le Fils de
Dieu se montre faible enfant, pauvre, ignoré, proscrit et fugitif,
il était bon de rappeler au fidèle que ce nouveau-né était l'attente
des siècles et le grand objet des conseils éternels.
(2) A Bourges, bien loin de s'exposer à diminuer l'espace con-
sacré à la Passion, en admettant, des tableaux d'un autre ordre,
on a pris soin de multiplier le nombre des scènes, en recourant à
un artifice habilement conçu. On a multiplié les petits médaillons
qui forment comme un plan reculé dans l'aspect général de la
verrière, et les faits d'une importance secondaire ont été relégués
dans cette série inférieure, où ils demeurent assez apparents, tout
en cédant l'espace au développement des tableaux dont l'intérêt
est plus grave. Pour donner cependant de la légèreté au vitrail,
que tant de médaillons semblaient devoir charger outre mesure,
on a fait choix d'un système d'ornementation sobre, varié, plein
de simplicité et de grâce.
(3) Il est aisé de lire : «Istam vitram dederunt pellipari», Les
pelletiers ont donné cette vitre.
(4) Je suppose que dans le placement primitif, les vendeurs chas-
sés du temple et la résurrection de Lazare, actuellement posés au-
dessus de la cène et du lavement des pieds,pouvaient bien, au con-
traire, avoir été mis sous ces médaillons qu'ils surmontent aujour-
d'hui. Peut-être aussi que la trahison de Judas et le dressement de la
croix ont pris chacun la place de l'autre.Mais, en supposant même
quelques restitutions de ce genre, on ne serait pas dispensé de se
rappeler une observation que nous faisions (n° 84, p. 147) au su-
jet de saint Thomas, en renonçant à trouver une continuité par-
faitement régulière. Quoi qu'il en soit, la marche générale indique
que les petits médaillons se suivent de gauche à droite; au lieu
que l'ordre est inverse pour les grands.
95