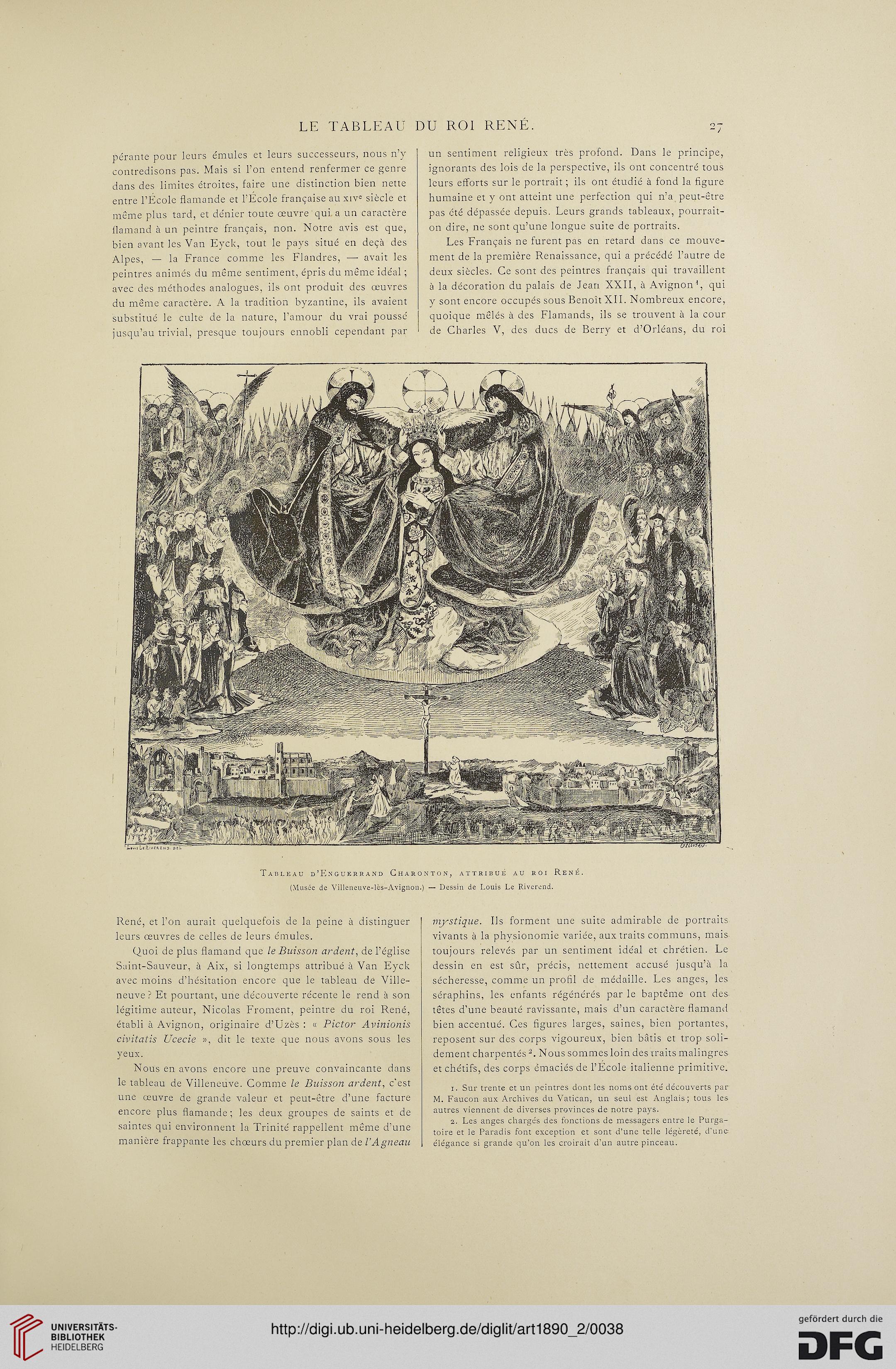o —
- J
LE TABLEAU
pérante pour leurs émules et leurs successeurs, nous n’y
contredisons pas. Mais si l’on entend renfermer ce genre
dans des limites étroites, faire une distinction bien nette
entre l’Ecole flamande et l’École française au xive siècle et
même plus tard, et dénier toute œuvre qui a un caractère
flamand à un peintre français, non. Notre avis est que,
bien avant les Van Eyck, tout le pays situé en deçà des
Alpes, — la France comme les Flandres, — avait les
peintres animés du même sentiment, épris du même idéal ;
avec des méthodes analogues, ils ont produit des œuvres
du même caractère. A la tradition byzantine, ils avaient
substitué le culte de la nature, l’amour du vrai poussé
jusqu’au trivial, presque toujours ennobli cependant par
DU ROI RENÉ.
un sentiment religieux très profond. Dans le principe,
ignorants des lois de la perspective, ils ont concentré tous
leurs efforts sur le portrait ; ils ont étudié à fond la figure
humaine et y ont atteint une perfection qui n’a peut-être
pas été dépassée depuis. Leurs grands tableaux, pourrait-
on dire, ne sont qu’une longue suite de portraits.
Les Français ne furent pas en retard dans ce mouve-
ment de la première Renaissance, qui a précédé l’autre de
deux siècles. Ce sont des peintres français qui travaillent
à la décoration du palais de Jean XXII, à Avignon1, qui
y sont encore occupés sous Benoît XII. Nombreux encore,
quoique mêlés à des Flamands, ils se trouvent à la cour
de Charles V, des ducs de Berry et d’Orléans, du roi
Tableau d’Enguerrand Gharonton, attribué au roi René.
(Musée de Villeneuve-lès-Avignon.) — Dessin de Louis Le Riverend.
René, et l’on aurait quelquefois de la peine à distinguer
leurs œuvres de celles de leurs émules.
Quoi de plus flamand que le Buisson ardent, de l’église
Saint-Sauveur, à Aix, si longtemps attribué à Van Eyck
avec moins d’hésitation encore que le tableau de Ville-
neuve? Et pourtant, une découverte récente le rend à son
légitime auteur, Nicolas Froment, peintre du roi René,
établi à Avignon, originaire d’Uzès : « Pictor Avinionis
civitatis Ucecie », dit le texte que nous avons sous les
yeux.
Nous en avons encore une preuve convaincante dans
le tableau de Villeneuve. Comme le Buisson ardent, c'est
une œuvre de grande valeur et peut-être d’une facture
encore plus flamande; les deux groupes de saints et de
saintes qui environnent la Trinité rappellent même d’une
manière frappante les chœurs du premier plan de /’Agneau
mystique. Ils forment une suite admirable de portraits
vivants à la physionomie variée, aux traits communs, mais
toujours relevés par un sentiment idéal et chrétien. Le
dessin en est sûr, précis, nettement accusé jusqu’à la
sécheresse, comme un profil de médaille. Les anges, les
séraphins, les enfants régénérés par le baptême ont des
têtes d’une beauté ravissante, mais d’un caractère flamand
bien accentué. Ces figures larges, saines, bien portantes,
reposent sur des corps vigoureux, bien bâtis et trop soli-
dement charpentés A Nous sommes loin des traits malingres
et chétifs, des corps émaciés de l’Ecole italienne primitive.
1. Sur trente et un peintres dont les noms ont été' découverts par
M. Faucon aux Archives du Vatican, un seul est Anglais; tous les
autres viennent de diverses provinces de notre pays.
2. Les anges chargés des fonctions de messagers entre le Purga-
toire et le Paradis font exception et sont d’une telle légèreté, d'une
élégance si grande qu’on les croirait d’un autre pinceau.
- J
LE TABLEAU
pérante pour leurs émules et leurs successeurs, nous n’y
contredisons pas. Mais si l’on entend renfermer ce genre
dans des limites étroites, faire une distinction bien nette
entre l’Ecole flamande et l’École française au xive siècle et
même plus tard, et dénier toute œuvre qui a un caractère
flamand à un peintre français, non. Notre avis est que,
bien avant les Van Eyck, tout le pays situé en deçà des
Alpes, — la France comme les Flandres, — avait les
peintres animés du même sentiment, épris du même idéal ;
avec des méthodes analogues, ils ont produit des œuvres
du même caractère. A la tradition byzantine, ils avaient
substitué le culte de la nature, l’amour du vrai poussé
jusqu’au trivial, presque toujours ennobli cependant par
DU ROI RENÉ.
un sentiment religieux très profond. Dans le principe,
ignorants des lois de la perspective, ils ont concentré tous
leurs efforts sur le portrait ; ils ont étudié à fond la figure
humaine et y ont atteint une perfection qui n’a peut-être
pas été dépassée depuis. Leurs grands tableaux, pourrait-
on dire, ne sont qu’une longue suite de portraits.
Les Français ne furent pas en retard dans ce mouve-
ment de la première Renaissance, qui a précédé l’autre de
deux siècles. Ce sont des peintres français qui travaillent
à la décoration du palais de Jean XXII, à Avignon1, qui
y sont encore occupés sous Benoît XII. Nombreux encore,
quoique mêlés à des Flamands, ils se trouvent à la cour
de Charles V, des ducs de Berry et d’Orléans, du roi
Tableau d’Enguerrand Gharonton, attribué au roi René.
(Musée de Villeneuve-lès-Avignon.) — Dessin de Louis Le Riverend.
René, et l’on aurait quelquefois de la peine à distinguer
leurs œuvres de celles de leurs émules.
Quoi de plus flamand que le Buisson ardent, de l’église
Saint-Sauveur, à Aix, si longtemps attribué à Van Eyck
avec moins d’hésitation encore que le tableau de Ville-
neuve? Et pourtant, une découverte récente le rend à son
légitime auteur, Nicolas Froment, peintre du roi René,
établi à Avignon, originaire d’Uzès : « Pictor Avinionis
civitatis Ucecie », dit le texte que nous avons sous les
yeux.
Nous en avons encore une preuve convaincante dans
le tableau de Villeneuve. Comme le Buisson ardent, c'est
une œuvre de grande valeur et peut-être d’une facture
encore plus flamande; les deux groupes de saints et de
saintes qui environnent la Trinité rappellent même d’une
manière frappante les chœurs du premier plan de /’Agneau
mystique. Ils forment une suite admirable de portraits
vivants à la physionomie variée, aux traits communs, mais
toujours relevés par un sentiment idéal et chrétien. Le
dessin en est sûr, précis, nettement accusé jusqu’à la
sécheresse, comme un profil de médaille. Les anges, les
séraphins, les enfants régénérés par le baptême ont des
têtes d’une beauté ravissante, mais d’un caractère flamand
bien accentué. Ces figures larges, saines, bien portantes,
reposent sur des corps vigoureux, bien bâtis et trop soli-
dement charpentés A Nous sommes loin des traits malingres
et chétifs, des corps émaciés de l’Ecole italienne primitive.
1. Sur trente et un peintres dont les noms ont été' découverts par
M. Faucon aux Archives du Vatican, un seul est Anglais; tous les
autres viennent de diverses provinces de notre pays.
2. Les anges chargés des fonctions de messagers entre le Purga-
toire et le Paradis font exception et sont d’une telle légèreté, d'une
élégance si grande qu’on les croirait d’un autre pinceau.