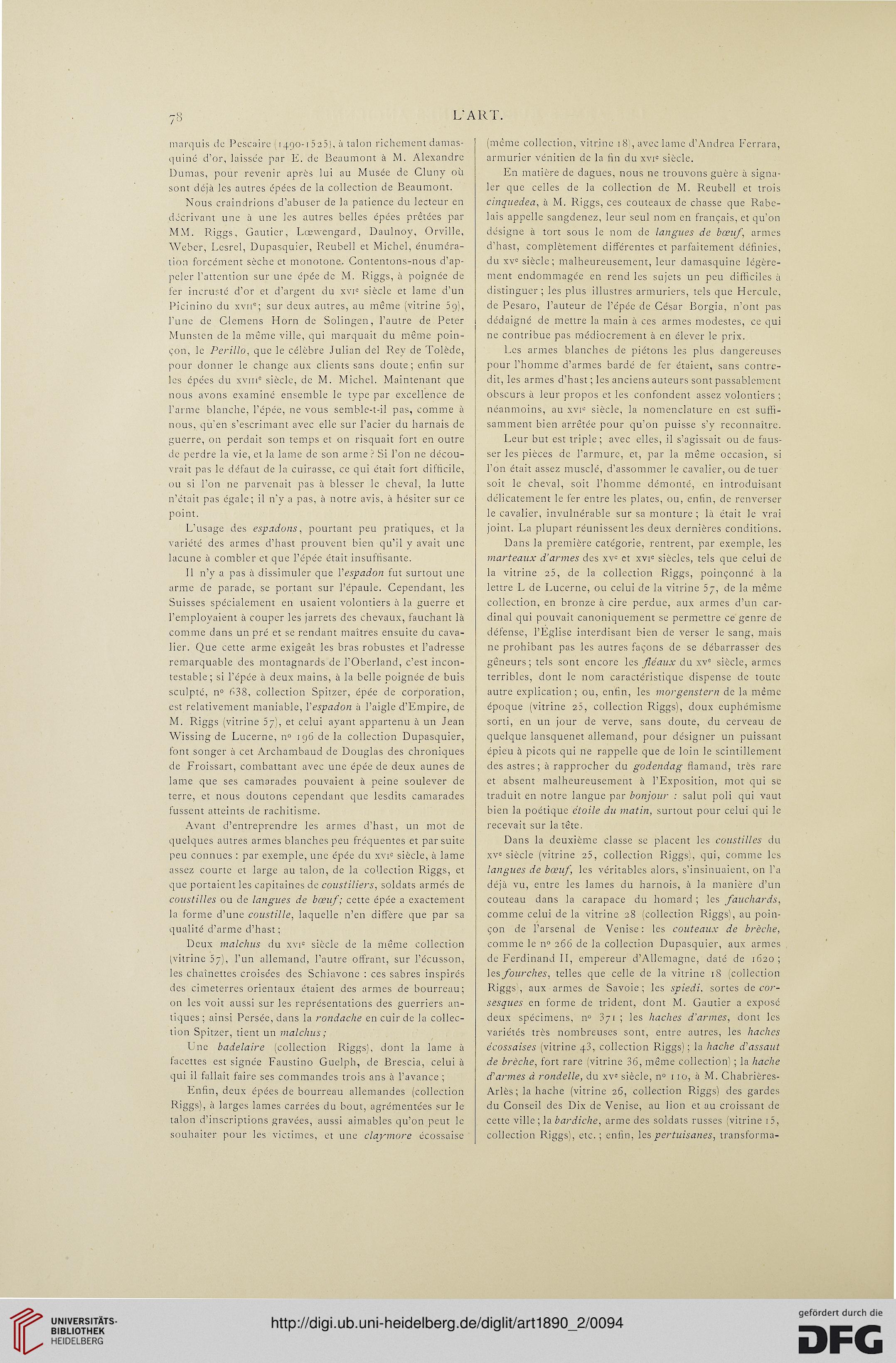L'ART.
73
marquis de Pcscairc (1490-1 5 25), à talon richement damas-
quiné d'or, laissée par E. de Beaumont à M. Alexandre
Dumas, pour revenir après lui au Musée de Cluny où
sont déjà les autres épées de la collection de Beaumont.
Nous craindrions d’abuser de la patience du lecteur en
décrivant une à une les autres belles épées prêtées par
MM. Riggs, Gautier, Lœwengard, Daulnoy, Orville,
Weber, Lcsrel, Dupasquier, Reubell et Michel, énuméra-
tion forcément sèche et monotone. Contentons-nous d’ap-
peler l’attention sur une épée de M. Riggs, à poignée de
fer incrusté d’or et d’argent du xvic siècle et lame d’un
Picinino du xvue; sur deux autres, au même (vitrine 59),
l’une de Clemens Horn de Solingen, l’autre de Peter
Munstcn de la même ville, qui marquait du même poin-
çon, le Perillo, que le célèbre Julian del Rev de Tolède,
pour donner le change aux clients sans doute; enfin sur
les épées du xvmc siècle, de M. Michel. Maintenant que
nous avons examiné ensemble le type par excellence de
l’arme blanche, l’épée, ne vous semble-t-il pas, comme à
nous, qu'en s’escrimant avec elle sur l’acier du harnais de
guerre, on perdait son temps et on risquait fort en outre
de perdre la vie, et la lame de son arme ? Si l’on ne décou-
vrait pas le défaut de la cuirasse, ce qui était fort difficile,
ou si l’on ne parvenait pas à blesser le cheval, la lutte
n’était pas égale; il n’y a pas, à notre avis, à hésiter sur ce
point.
L’usage des espadons, pourtant peu pratiques, et la
variété des armes d’hast prouvent bien qu’il y avait une
lacune à combler et que l’épée était insuffisante.
Il n’y a pas à dissimuler que Y espadon fut surtout une
arme de parade, se portant sur l’épaule. Cependant, les
Suisses spécialement en usaient volontiers à la guerre et
l’employaient à couper les jarrets des chevaux, fauchant là
comme dans un pré et se rendant maîtres ensuite du cava-
lier. Que cette arme exigeât les bras robustes et l’adresse
remarquable des montagnards de l’Oberland, c’est incon-
testable ; si l’épée à deux mains, à la belle poignée de buis
sculpté, n° 638, collection Spitzer, épée de corporation,
est relativement maniable, Yespadon à l’aigle d’Empire, de
M. Riggs (vitrine 57), et celui ayant appartenu à un Jean
Wissing de Lucerne, n° 196 de la collection Dupasquier,
font songer à cet Archambaud de Douglas des chroniques
de Froissart, combattant avec une épée de deux aunes de
lame que ses camarades pouvaient à peine soulever de
terre, et nous doutons cependant que lesdits camarades
fussent atteints de rachitisme.
Avant d’entreprendre les armes d’hast, un mot de
quelques autres armes blanches peu fréquentes et par suite
peu connues : par exemple, une épée du xvic siècle, à lame
assez courte et large au talon, de la collection Riggs, et
que portaient les capitaines de coustiliers, soldats armés de
coustilles ou de langues de bœuf; cette épée a exactement
la forme d’une coustille, laquelle n’en diffère que par sa
qualité d’arme d’hast;
Deux malchus du xvi° siècle de la même collection
(vitrine 57), l'un allemand, l’autre offrant, sur l’écusson,
les chaînettes croisées des Schiavone : ces sabres inspirés
des cimeterres orientaux étaient des armes de bourreau;
on les voit aussi sur les représentations des guerriers an-
tiques ; ainsi Persée, dans la rondache en cuir de la collec-
tion Spitzer, tient un malclius;
Une badelaire (collection Riggs), dont la lame à
facettes est signée Faustino Guelph, de Brescia, celui à
qui il fallait faire ses commandes trois ans à l’avance ;
Enfin, deux épées de bourreau allemandes (collection
Riggs), à larges lames carrées du bout, agrémentées sur le
talon d’inscriptions gravées, aussi aimables qu’on peut le
souhaiter pour les victimes, et une clajrmore écossaise
(même collection, vitrine 18 , avec lame d’Andrea Ferrara,
armurier vénitien de la fin du xvi° siècle.
En matière de dagues, nous ne trouvons guère à signa-
ler que celles de la collection de M. Reubell et trois
cinquedea, à M. Riggs, ces couteaux de chasse que Rabe-
lais appelle sangdenez, leur seul nom en français, et qu’on
désigne à tort sous le nom de langues de bœuf, armes
d’hast, complètement différentes et parfaitement définies,
du xve siècle; malheureusement, leur damasquine légère-
ment endommagée en rend les sujets un peu difficiles à
distinguer; les plus illustres armuriers, tels que Hercule,
de Pesaro, l’auteur de l’épée de César Borgia, n’ont pas
dédaigné de mettre la main à ces armes modestes, ce qui
ne contribue pas médiocrement à en élever le prix.
Les armes blanches de piétons les plus dangereuses
pour l’homme d’armes bardé de fer étaient, sans contre-
dit, les armes d’hast ; les anciens auteurs sont passablement
obscurs à leur propos et les confondent assez volontiers ;
néanmoins, au xvi° siècle, la nomenclature en est suffi-
samment bien arrêtée pour qu’on puisse s’y reconnaître.
Leur but est triple; avec elles, il s’agissait ou de faus-
ser les pièces de l’armure, et, par la même occasion, si
l’on était assez musclé, d’assommer le cavalier, ou de tuer
soit le cheval, soit l’homme démonté, en introduisant
délicatement le fer entre les plates, ou, enfin, de renverser
le cavalier, invulnérable sur sa monture ; là était le vrai
joint. La plupart réunissent les deux dernières conditions.
Dans la première catégorie, rentrent, par exemple, les
marteaux d’armes des xve et xvie siècles, tels que celui de
la vitrine 25, de la collection Riggs, poinçonné à la
lettre L de Lucerne, ou celui de la vitrine 57, de la même
collection, en bronze à cire perdue, aux armes d’un car-
dinal qui pouvait canoniquement se permettre ce genre de
défense, l’Eglise interdisant bien de verser le sang, mais
ne prohibant pas les autres façons de se débarrasser des
gêneurs; tels sont encore les fléaux du xvc siècle, armes
terribles, dont le nom caractéristique dispense de toute
autre explication; ou, enfin, les morgenstern de la même
époque (vitrine 25, collection Riggs), doux euphémisme
sorti, en un jour de verve, sans doute, du cerveau de
quelque lansquenet allemand, pour désigner un puissant
épieu à picots qui ne rappelle que de loin le scintillement
des astres; à rapprocher du godendag flamand, très rare
et absent malheureusement à l’Exposition, mot qui se
traduit en notre langue par bonjour : salut poli qui vaut
bien la poétique étoile du matin, surtout pour celui qui le
recevait sur la tête.
Dans la deuxième classe se placent les coustilles du
xve siècle (vitrine 25, collection Riggs), qui, comme les
langues de bœuf, les véritables alors, s’insinuaient, on l’a
déjà vu, entre les lames du harnois, à la manière d’un
couteau dans la carapace du homard ; les fauchards,
comme celui de la vitrine 28 (collection Riggs), au poin-
çon de l’arsenal de Venise: les couteaux de brèche,
comme le n° 266 de la collection Dupasquier, aux armes
de Ferdinand II, empereur d’Allemagne, daté de 1620;
les fourches, telles que celle de la vitrine 18 (collection
Riggs', aux armes de Savoie ; les spiedi, sortes de cor-
sesques en forme de trident, dont M. Gautier a exposé
deux spécimens, n° 371 ; les haches d'armes, dont les
variétés très nombreuses sont, entre autres, les haches
écossaises (vitrine q3, collection Riggs) ; la hache d’assaut
de brèche, fort rare (vitrine 36, même collection' ; la hache
d’armes à rondelle, du xve siècle, n° 110, à M. Chabrières-
Arlès ; la hache (vitrine 26, collection Riggs) des gardes
du Conseil des Dix de Venise, au lion et au croissant de
cette ville ; la bardiche, arme des soldats russes (vitrine 15,
collection Riggs), etc. ; enfin, les pertuisanes, transforma-
73
marquis de Pcscairc (1490-1 5 25), à talon richement damas-
quiné d'or, laissée par E. de Beaumont à M. Alexandre
Dumas, pour revenir après lui au Musée de Cluny où
sont déjà les autres épées de la collection de Beaumont.
Nous craindrions d’abuser de la patience du lecteur en
décrivant une à une les autres belles épées prêtées par
MM. Riggs, Gautier, Lœwengard, Daulnoy, Orville,
Weber, Lcsrel, Dupasquier, Reubell et Michel, énuméra-
tion forcément sèche et monotone. Contentons-nous d’ap-
peler l’attention sur une épée de M. Riggs, à poignée de
fer incrusté d’or et d’argent du xvic siècle et lame d’un
Picinino du xvue; sur deux autres, au même (vitrine 59),
l’une de Clemens Horn de Solingen, l’autre de Peter
Munstcn de la même ville, qui marquait du même poin-
çon, le Perillo, que le célèbre Julian del Rev de Tolède,
pour donner le change aux clients sans doute; enfin sur
les épées du xvmc siècle, de M. Michel. Maintenant que
nous avons examiné ensemble le type par excellence de
l’arme blanche, l’épée, ne vous semble-t-il pas, comme à
nous, qu'en s’escrimant avec elle sur l’acier du harnais de
guerre, on perdait son temps et on risquait fort en outre
de perdre la vie, et la lame de son arme ? Si l’on ne décou-
vrait pas le défaut de la cuirasse, ce qui était fort difficile,
ou si l’on ne parvenait pas à blesser le cheval, la lutte
n’était pas égale; il n’y a pas, à notre avis, à hésiter sur ce
point.
L’usage des espadons, pourtant peu pratiques, et la
variété des armes d’hast prouvent bien qu’il y avait une
lacune à combler et que l’épée était insuffisante.
Il n’y a pas à dissimuler que Y espadon fut surtout une
arme de parade, se portant sur l’épaule. Cependant, les
Suisses spécialement en usaient volontiers à la guerre et
l’employaient à couper les jarrets des chevaux, fauchant là
comme dans un pré et se rendant maîtres ensuite du cava-
lier. Que cette arme exigeât les bras robustes et l’adresse
remarquable des montagnards de l’Oberland, c’est incon-
testable ; si l’épée à deux mains, à la belle poignée de buis
sculpté, n° 638, collection Spitzer, épée de corporation,
est relativement maniable, Yespadon à l’aigle d’Empire, de
M. Riggs (vitrine 57), et celui ayant appartenu à un Jean
Wissing de Lucerne, n° 196 de la collection Dupasquier,
font songer à cet Archambaud de Douglas des chroniques
de Froissart, combattant avec une épée de deux aunes de
lame que ses camarades pouvaient à peine soulever de
terre, et nous doutons cependant que lesdits camarades
fussent atteints de rachitisme.
Avant d’entreprendre les armes d’hast, un mot de
quelques autres armes blanches peu fréquentes et par suite
peu connues : par exemple, une épée du xvic siècle, à lame
assez courte et large au talon, de la collection Riggs, et
que portaient les capitaines de coustiliers, soldats armés de
coustilles ou de langues de bœuf; cette épée a exactement
la forme d’une coustille, laquelle n’en diffère que par sa
qualité d’arme d’hast;
Deux malchus du xvi° siècle de la même collection
(vitrine 57), l'un allemand, l’autre offrant, sur l’écusson,
les chaînettes croisées des Schiavone : ces sabres inspirés
des cimeterres orientaux étaient des armes de bourreau;
on les voit aussi sur les représentations des guerriers an-
tiques ; ainsi Persée, dans la rondache en cuir de la collec-
tion Spitzer, tient un malclius;
Une badelaire (collection Riggs), dont la lame à
facettes est signée Faustino Guelph, de Brescia, celui à
qui il fallait faire ses commandes trois ans à l’avance ;
Enfin, deux épées de bourreau allemandes (collection
Riggs), à larges lames carrées du bout, agrémentées sur le
talon d’inscriptions gravées, aussi aimables qu’on peut le
souhaiter pour les victimes, et une clajrmore écossaise
(même collection, vitrine 18 , avec lame d’Andrea Ferrara,
armurier vénitien de la fin du xvi° siècle.
En matière de dagues, nous ne trouvons guère à signa-
ler que celles de la collection de M. Reubell et trois
cinquedea, à M. Riggs, ces couteaux de chasse que Rabe-
lais appelle sangdenez, leur seul nom en français, et qu’on
désigne à tort sous le nom de langues de bœuf, armes
d’hast, complètement différentes et parfaitement définies,
du xve siècle; malheureusement, leur damasquine légère-
ment endommagée en rend les sujets un peu difficiles à
distinguer; les plus illustres armuriers, tels que Hercule,
de Pesaro, l’auteur de l’épée de César Borgia, n’ont pas
dédaigné de mettre la main à ces armes modestes, ce qui
ne contribue pas médiocrement à en élever le prix.
Les armes blanches de piétons les plus dangereuses
pour l’homme d’armes bardé de fer étaient, sans contre-
dit, les armes d’hast ; les anciens auteurs sont passablement
obscurs à leur propos et les confondent assez volontiers ;
néanmoins, au xvi° siècle, la nomenclature en est suffi-
samment bien arrêtée pour qu’on puisse s’y reconnaître.
Leur but est triple; avec elles, il s’agissait ou de faus-
ser les pièces de l’armure, et, par la même occasion, si
l’on était assez musclé, d’assommer le cavalier, ou de tuer
soit le cheval, soit l’homme démonté, en introduisant
délicatement le fer entre les plates, ou, enfin, de renverser
le cavalier, invulnérable sur sa monture ; là était le vrai
joint. La plupart réunissent les deux dernières conditions.
Dans la première catégorie, rentrent, par exemple, les
marteaux d’armes des xve et xvie siècles, tels que celui de
la vitrine 25, de la collection Riggs, poinçonné à la
lettre L de Lucerne, ou celui de la vitrine 57, de la même
collection, en bronze à cire perdue, aux armes d’un car-
dinal qui pouvait canoniquement se permettre ce genre de
défense, l’Eglise interdisant bien de verser le sang, mais
ne prohibant pas les autres façons de se débarrasser des
gêneurs; tels sont encore les fléaux du xvc siècle, armes
terribles, dont le nom caractéristique dispense de toute
autre explication; ou, enfin, les morgenstern de la même
époque (vitrine 25, collection Riggs), doux euphémisme
sorti, en un jour de verve, sans doute, du cerveau de
quelque lansquenet allemand, pour désigner un puissant
épieu à picots qui ne rappelle que de loin le scintillement
des astres; à rapprocher du godendag flamand, très rare
et absent malheureusement à l’Exposition, mot qui se
traduit en notre langue par bonjour : salut poli qui vaut
bien la poétique étoile du matin, surtout pour celui qui le
recevait sur la tête.
Dans la deuxième classe se placent les coustilles du
xve siècle (vitrine 25, collection Riggs), qui, comme les
langues de bœuf, les véritables alors, s’insinuaient, on l’a
déjà vu, entre les lames du harnois, à la manière d’un
couteau dans la carapace du homard ; les fauchards,
comme celui de la vitrine 28 (collection Riggs), au poin-
çon de l’arsenal de Venise: les couteaux de brèche,
comme le n° 266 de la collection Dupasquier, aux armes
de Ferdinand II, empereur d’Allemagne, daté de 1620;
les fourches, telles que celle de la vitrine 18 (collection
Riggs', aux armes de Savoie ; les spiedi, sortes de cor-
sesques en forme de trident, dont M. Gautier a exposé
deux spécimens, n° 371 ; les haches d'armes, dont les
variétés très nombreuses sont, entre autres, les haches
écossaises (vitrine q3, collection Riggs) ; la hache d’assaut
de brèche, fort rare (vitrine 36, même collection' ; la hache
d’armes à rondelle, du xve siècle, n° 110, à M. Chabrières-
Arlès ; la hache (vitrine 26, collection Riggs) des gardes
du Conseil des Dix de Venise, au lion et au croissant de
cette ville ; la bardiche, arme des soldats russes (vitrine 15,
collection Riggs), etc. ; enfin, les pertuisanes, transforma-