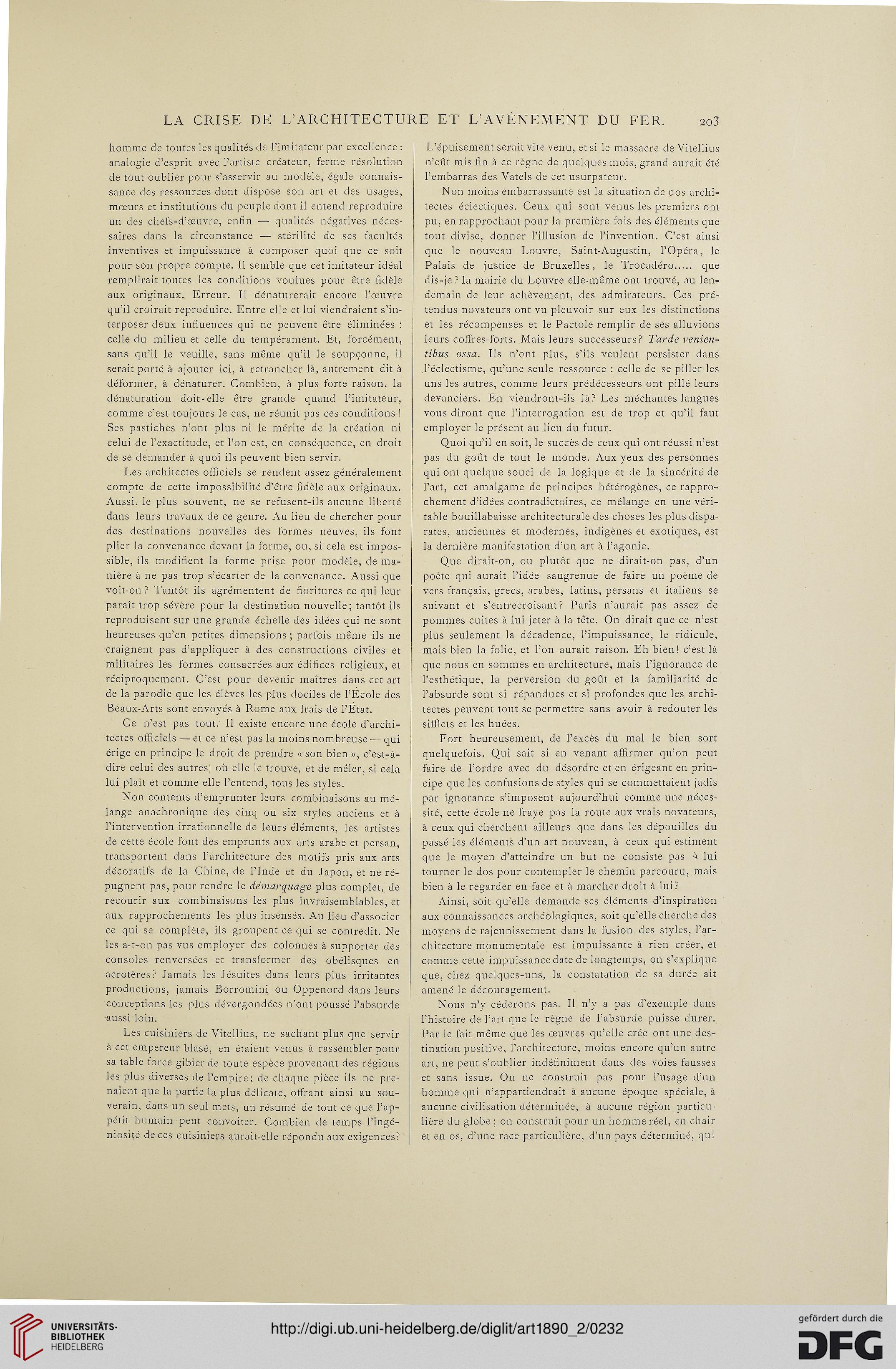LA CRISE DE L’ARCHITECTURE ET L’AVÈNEMENT DU FER.
203
homme de toutes les qualités de l’imitateur par excellence :
analogie d’esprit avec l’artiste créateur, ferme résolution
de tout oublier pour s’asservir au modèle, égale connais-
sance des ressources dont dispose son art et des usages,
mœurs et institutions du peuple dont il entend reproduire
un des chefs-d’œuvre, enfin — qualités négatives néces-
saires dans la circonstance — stérilité de ses facultés
inventives et impuissance à composer quoi que ce soit
pour son propre compte. Il semble que cet imitateur idéal
remplirait toutes les conditions voulues pour être fidèle
aux originaux. Erreur. Il dénaturerait encore l’œuvre
qu’il croirait reproduire. Entre elle et lui viendraient s’in-
terposer deux influences qui ne peuvent être éliminées :
celle du milieu et celle du tempérament. Et, forcément,
sans qu’il le veuille, sans même qu’il le soupçonne, il
serait porté à ajouter ici, à retrancher là, autrement dit à
déformer, à dénaturer. Combien, à plus forte raison, la
dénaturation doit-elle être grande quand l’imitateur,
comme c’est toujours le cas, ne réunit pas ces conditions !
Ses pastiches n’ont plus ni le mérite de la création ni
celui de l’exactitude, et l’on est, en conséquence, en droit
de se demander à quoi ils peuvent bien servir.
Les architectes officiels se rendent assez généralement
compte de cette impossibilité d’être fidèle aux originaux.
Aussi, le plus souvent, ne se refusent-ils aucune liberté
dans leurs travaux de ce genre. Au lieu de chercher pour
des destinations nouvelles des formes neuves, ils font
plier la convenance devant la forme, ou, si cela est impos-
sible, ils modifient la forme prise pour modèle, de ma-
nière à ne pas trop s’écarter de la convenance. Aussi que
voit-on? Tantôt ils agrémentent de fioritures ce qui leur
paraît trop sévère pour la destination nouvelle; tantôt ils
reproduisent sur une grande échelle des idées qui ne sont
heureuses qu’en petites dimensions; parfois même ils ne
craignent pas d’appliquer à des constructions civiles et
militaires les formes consacrées aux édifices religieux, et
réciproquement. C’est pour devenir maîtres dans cet art
de la parodie que les élèves les plus dociles de l’Ecole des
Beaux-Arts sont envoyés à Rome aux frais de l’Etat.
Ce n’est pas tout.' Il existe encore une école d’archi-
tectes officiels — et ce n’est pas la moins nombreuse — qui
érige en principe le droit de prendre « son bien », c’est-à-
dire celui des autres) où elle le trouve, et de mêler, si cela
lui plaît et comme elle l’entend, tous les styles.
Non contents d’emprunter leurs combinaisons au mé-
lange anachronique des cinq ou six styles anciens et à
l’intervention irrationnelle de leurs éléments, les artistes
de cette école font des emprunts aux arts arabe et persan,
transportent dans l’architecture des motifs pris aux arts
décoratifs de la Chine, de l’Inde et du Japon, et ne ré-
pugnent pas, pour rendre le démarquage plus complet, de
recourir aux combinaisons les plus invraisemblables, et
aux rapprochements les plus insensés. Au lieu d’associer
ce qui se complète, ils groupent ce qui se contredit. Ne
les a-t-on pas vus employer des colonnes à supporter des
consoles renversées et transformer des obélisques en
acrotères? Jamais les Jésuites dans leurs plus irritantes
productions, jamais Borromini ou Oppenord dans leurs
conceptions les plus dévergondées n’ont poussé l’absurde
•aussi loin.
Les cuisiniers de Vitellius, ne sachant plus que servir
à cet empereur blasé, en étaient venus à rassembler pour
sa table force gibier de toute espèce provenant des régions
les plus diverses de l’empire; de chaque pièce ils ne pre-
naient que la partie la plus délicate, offrant ainsi au sou-
verain, dans un seul mets, un résumé de tout ce que l’ap-
pétit humain peut convoiter. Combien de temps l’ingé-
niosité de ces cuisiniers aurait-elle répondu aux exigences?
L’épuisement serait vite venu, et si le massacre de Vitellius
n’eût mis fin à ce règne de quelques mois, grand aurait été
l’embarras des Vatels de cet usurpateur.
Non moins embarrassante est la situation de nos archi-
tectes éclectiques. Ceux qui sont venus les premiers ont
pu, en rapprochant pour la première fois des éléments que
tout divise, donner l’illusion de l’invention. C’est ainsi
que le nouveau Louvre, Saint-Augustin, l’Opéra, le
Palais de justice de Bruxelles, le Trocadéro. que
dis-je ? la mairie du Louvre elle-même ont trouvé, au len-
demain de leur achèvement, des admirateurs. Ces pré-
tendus novateurs ont vu pleuvoir sur eux les distinctions
et les récompenses et le Pactole remplir de ses alluvions
leurs coffres-forts. Mais leurs successeurs? Tarde venien-
tibus ossa. Ils n’ont plus, s’ils veulent persister dans
l’éclectisme, qu’une seule ressource : celle de se piller les
uns les autres, comme leurs prédécesseurs ont pillé leurs
devanciers. En viendront-ils là? Les méchantes langues
vous diront que l’interrogation est de trop et qu’il faut
employer le présent au lieu du futur.
Quoi qu’il en soit, le succès de ceux qui ont réussi n’est
pas du goût de tout le monde. Aux yeux des personnes
qui ont quelque souci de la logique et de la sincérité de
l’art, cet amalgame de principes hétérogènes, ce rappro-
chement d’idées contradictoires, ce mélange en une véri-
table bouillabaisse architecturale des choses les plus dispa-
rates, anciennes et modernes, indigènes et exotiques, est
la dernière manifestation d’un art à l’agonie.
Que dirait-on, ou plutôt que ne dirait-on pas, d’un
poète qui aurait l’idée saugrenue de faire un poème de
vers français, grecs, arabes, latins, persans et italiens se
suivant et s’entrecroisant? Paris n’aurait pas assez de
pommes cuites à lui jeter à la tête. On dirait que ce n’est
plus seulement la décadence, l’impuissance, le ridicule,
mais bien la folie, et l’on aurait raison. Eh bien! c’est là
que nous en sommes en architecture, mais l’ignorance de
l’esthétique, la perversion du goût et la familiarité de
l’absurde sont si répandues et si profondes que les archi-
tectes peuvent tout se permettre sans avoir à redouter les
sifflets et les huées.
Fort heureusement, de l’excès du mal le bien sort
quelquefois. Qui sait si en venant affirmer qu’on peut
faire de l’ordre avec du désordre et en érigeant en prin-
cipe que les confusions de styles qui se commettaient jadis
par ignorance s’imposent aujourd’hui comme une néces-
sité, cette école ne fraye pas la route aux vrais novateurs,
à ceux qui cherchent ailleurs que dans les dépouilles du
passé les éléments d’un art nouveau, à ceux qui estiment
que le moyen d’atteindre un but ne consiste pas A lui
tourner le dos pour contempler le chemin parcouru, mais
bien à le regarder en face et à marcher droit à lui?
Ainsi, soit qu’elle demande ses éléments d’inspiration
aux connaissances archéologiques, soit qu’elle cherche des
moyens de rajeunissement dans la fusion des styles, l’ar-
chitecture monumentale est impuissante à rien créer, et
comme cette impuissance date de longtemps, on s’explique
que, chez quelques-uns, la constatation de sa durée ait
amené le découragement.
Nous n’y céderons pas. Il n’y a pas d’exemple dans
l’histoire de l’art que le règne de l’absurde puisse durer.
Par le fait même que les œuvres qu’elle crée ont une des-
tination positive, l’architecture, moins encore qu’un autre
art, ne peut s’oublier indéfiniment dans des voies fausses
et sans issue. On ne construit pas pour l’usage d’un
homme qui n’appartiendrait à aucune époque spéciale, à
aucune civilisation déterminée, à aucune région particu-
lière du globe; on construit pour un homme réel, en chair
et en os, d’une race particulière, d’un pays déterminé, qui
203
homme de toutes les qualités de l’imitateur par excellence :
analogie d’esprit avec l’artiste créateur, ferme résolution
de tout oublier pour s’asservir au modèle, égale connais-
sance des ressources dont dispose son art et des usages,
mœurs et institutions du peuple dont il entend reproduire
un des chefs-d’œuvre, enfin — qualités négatives néces-
saires dans la circonstance — stérilité de ses facultés
inventives et impuissance à composer quoi que ce soit
pour son propre compte. Il semble que cet imitateur idéal
remplirait toutes les conditions voulues pour être fidèle
aux originaux. Erreur. Il dénaturerait encore l’œuvre
qu’il croirait reproduire. Entre elle et lui viendraient s’in-
terposer deux influences qui ne peuvent être éliminées :
celle du milieu et celle du tempérament. Et, forcément,
sans qu’il le veuille, sans même qu’il le soupçonne, il
serait porté à ajouter ici, à retrancher là, autrement dit à
déformer, à dénaturer. Combien, à plus forte raison, la
dénaturation doit-elle être grande quand l’imitateur,
comme c’est toujours le cas, ne réunit pas ces conditions !
Ses pastiches n’ont plus ni le mérite de la création ni
celui de l’exactitude, et l’on est, en conséquence, en droit
de se demander à quoi ils peuvent bien servir.
Les architectes officiels se rendent assez généralement
compte de cette impossibilité d’être fidèle aux originaux.
Aussi, le plus souvent, ne se refusent-ils aucune liberté
dans leurs travaux de ce genre. Au lieu de chercher pour
des destinations nouvelles des formes neuves, ils font
plier la convenance devant la forme, ou, si cela est impos-
sible, ils modifient la forme prise pour modèle, de ma-
nière à ne pas trop s’écarter de la convenance. Aussi que
voit-on? Tantôt ils agrémentent de fioritures ce qui leur
paraît trop sévère pour la destination nouvelle; tantôt ils
reproduisent sur une grande échelle des idées qui ne sont
heureuses qu’en petites dimensions; parfois même ils ne
craignent pas d’appliquer à des constructions civiles et
militaires les formes consacrées aux édifices religieux, et
réciproquement. C’est pour devenir maîtres dans cet art
de la parodie que les élèves les plus dociles de l’Ecole des
Beaux-Arts sont envoyés à Rome aux frais de l’Etat.
Ce n’est pas tout.' Il existe encore une école d’archi-
tectes officiels — et ce n’est pas la moins nombreuse — qui
érige en principe le droit de prendre « son bien », c’est-à-
dire celui des autres) où elle le trouve, et de mêler, si cela
lui plaît et comme elle l’entend, tous les styles.
Non contents d’emprunter leurs combinaisons au mé-
lange anachronique des cinq ou six styles anciens et à
l’intervention irrationnelle de leurs éléments, les artistes
de cette école font des emprunts aux arts arabe et persan,
transportent dans l’architecture des motifs pris aux arts
décoratifs de la Chine, de l’Inde et du Japon, et ne ré-
pugnent pas, pour rendre le démarquage plus complet, de
recourir aux combinaisons les plus invraisemblables, et
aux rapprochements les plus insensés. Au lieu d’associer
ce qui se complète, ils groupent ce qui se contredit. Ne
les a-t-on pas vus employer des colonnes à supporter des
consoles renversées et transformer des obélisques en
acrotères? Jamais les Jésuites dans leurs plus irritantes
productions, jamais Borromini ou Oppenord dans leurs
conceptions les plus dévergondées n’ont poussé l’absurde
•aussi loin.
Les cuisiniers de Vitellius, ne sachant plus que servir
à cet empereur blasé, en étaient venus à rassembler pour
sa table force gibier de toute espèce provenant des régions
les plus diverses de l’empire; de chaque pièce ils ne pre-
naient que la partie la plus délicate, offrant ainsi au sou-
verain, dans un seul mets, un résumé de tout ce que l’ap-
pétit humain peut convoiter. Combien de temps l’ingé-
niosité de ces cuisiniers aurait-elle répondu aux exigences?
L’épuisement serait vite venu, et si le massacre de Vitellius
n’eût mis fin à ce règne de quelques mois, grand aurait été
l’embarras des Vatels de cet usurpateur.
Non moins embarrassante est la situation de nos archi-
tectes éclectiques. Ceux qui sont venus les premiers ont
pu, en rapprochant pour la première fois des éléments que
tout divise, donner l’illusion de l’invention. C’est ainsi
que le nouveau Louvre, Saint-Augustin, l’Opéra, le
Palais de justice de Bruxelles, le Trocadéro. que
dis-je ? la mairie du Louvre elle-même ont trouvé, au len-
demain de leur achèvement, des admirateurs. Ces pré-
tendus novateurs ont vu pleuvoir sur eux les distinctions
et les récompenses et le Pactole remplir de ses alluvions
leurs coffres-forts. Mais leurs successeurs? Tarde venien-
tibus ossa. Ils n’ont plus, s’ils veulent persister dans
l’éclectisme, qu’une seule ressource : celle de se piller les
uns les autres, comme leurs prédécesseurs ont pillé leurs
devanciers. En viendront-ils là? Les méchantes langues
vous diront que l’interrogation est de trop et qu’il faut
employer le présent au lieu du futur.
Quoi qu’il en soit, le succès de ceux qui ont réussi n’est
pas du goût de tout le monde. Aux yeux des personnes
qui ont quelque souci de la logique et de la sincérité de
l’art, cet amalgame de principes hétérogènes, ce rappro-
chement d’idées contradictoires, ce mélange en une véri-
table bouillabaisse architecturale des choses les plus dispa-
rates, anciennes et modernes, indigènes et exotiques, est
la dernière manifestation d’un art à l’agonie.
Que dirait-on, ou plutôt que ne dirait-on pas, d’un
poète qui aurait l’idée saugrenue de faire un poème de
vers français, grecs, arabes, latins, persans et italiens se
suivant et s’entrecroisant? Paris n’aurait pas assez de
pommes cuites à lui jeter à la tête. On dirait que ce n’est
plus seulement la décadence, l’impuissance, le ridicule,
mais bien la folie, et l’on aurait raison. Eh bien! c’est là
que nous en sommes en architecture, mais l’ignorance de
l’esthétique, la perversion du goût et la familiarité de
l’absurde sont si répandues et si profondes que les archi-
tectes peuvent tout se permettre sans avoir à redouter les
sifflets et les huées.
Fort heureusement, de l’excès du mal le bien sort
quelquefois. Qui sait si en venant affirmer qu’on peut
faire de l’ordre avec du désordre et en érigeant en prin-
cipe que les confusions de styles qui se commettaient jadis
par ignorance s’imposent aujourd’hui comme une néces-
sité, cette école ne fraye pas la route aux vrais novateurs,
à ceux qui cherchent ailleurs que dans les dépouilles du
passé les éléments d’un art nouveau, à ceux qui estiment
que le moyen d’atteindre un but ne consiste pas A lui
tourner le dos pour contempler le chemin parcouru, mais
bien à le regarder en face et à marcher droit à lui?
Ainsi, soit qu’elle demande ses éléments d’inspiration
aux connaissances archéologiques, soit qu’elle cherche des
moyens de rajeunissement dans la fusion des styles, l’ar-
chitecture monumentale est impuissante à rien créer, et
comme cette impuissance date de longtemps, on s’explique
que, chez quelques-uns, la constatation de sa durée ait
amené le découragement.
Nous n’y céderons pas. Il n’y a pas d’exemple dans
l’histoire de l’art que le règne de l’absurde puisse durer.
Par le fait même que les œuvres qu’elle crée ont une des-
tination positive, l’architecture, moins encore qu’un autre
art, ne peut s’oublier indéfiniment dans des voies fausses
et sans issue. On ne construit pas pour l’usage d’un
homme qui n’appartiendrait à aucune époque spéciale, à
aucune civilisation déterminée, à aucune région particu-
lière du globe; on construit pour un homme réel, en chair
et en os, d’une race particulière, d’un pays déterminé, qui