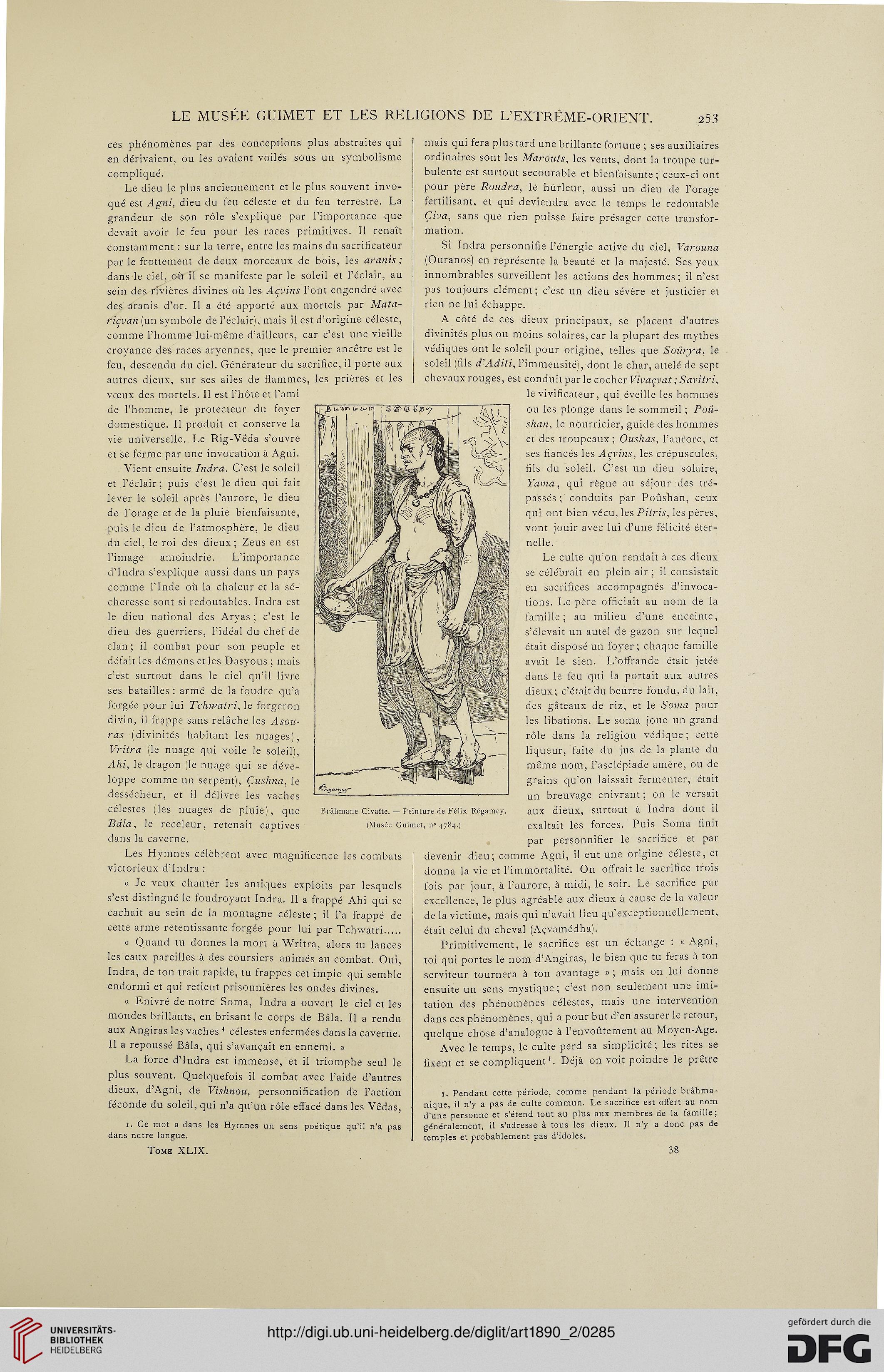LE MUSÉE GUIMET ET LES RELIGIONS DE L’EXTRÊME-ORIENT.
253
ces phénomènes par des conceptions plus abstraites qui
en dérivaient, ou les avaient voilés sous un symbolisme
compliqué.
Le dieu le plus anciennement et le plus souvent invo-
qué est Agni, dieu du feu céleste et du feu terrestre. La
grandeur de son rôle s’explique par l’importance que
devait avoir le feu pour les races primitives. Il renaît
constamment : sur la terre, entre les mains du sacrificateur
par le frottement de deux morceaux de bois, les aranis ;
dans le ciel, où il se manifeste par le soleil et l’éclair, au
sein des rivières divines où les Acvins l’ont engendré avec
des aranis d’or. Il a été apporté aux mortels par Mata-
riçvan (un symbole de l’éclair), mais il est d’origine céleste,
comme l’homme lui-même d’ailleurs, car c’est une vieille
croyance des races aryennes, que le premier ancêtre est le
feu, descendu du ciel. Générateur du sacrifice, il porte aux
autres dieux, sur ses ailes de flammes, les prières et les
vœux des mortels. Il est l’hôte et l’ami
de l’homme, le protecteur du foyer
domestique. Il produit et conserve la
vie universelle. Le Rig-Vêda s’ouvre
et se ferme par une invocation à Agni.
Vient ensuite Indra. C’est le soleil
et l’éclair; puis c’est le dieu qui fait
lever le soleil après l’aurore, le dieu
de l'orage et de la pluie bienfaisante,
puis le dieu de l’atmosphère, le dieu
du ciel, le roi des dieux ; Zeus en est
l’image amoindrie. L’importance
d’Indra s’explique aussi dans un pays
comme l’Inde où la chaleur et la sé-
cheresse sont si redoutables. Indra est
le dieu national des Aryas ; c’est le
dieu des guerriers, l’idéal du chef de
clan ; il combat pour son peuple et
défait les démons etles Dasyous ; mais
c’est surtout dans le ciel qu’il livre
ses batailles : armé de la foudre qu’a
forgée pour lui Tchwatri, le forgeron
divin, il frappe sans relâche les Asou-
ras (divinités habitant les nuages),
Vritra (le nuage qui voile le soleil),
Ahi, le dragon (le nuage qui se déve-
loppe comme un serpent), Çushna, le
dessécheur, et il délivre les vaches
célestes (les nuages de pluie), que
Bdla, le receleur, retenait captives
dans la caverne.
Les Hymnes célèbrent avec magnificence les combats
victorieux d’Indra :
« Je veux chanter les antiques exploits par lesquels
s’est distingué le foudroyant Indra. Il a frappé Ahi qui se
cachait au sein de la montagne céleste ; il l’a frappé de
cette arme retentissante forgée pour lui par Tchwatri.
« Quand tu donnes la mort à Writra, alors tu lances
les eaux pareilles à des coursiers animés au combat. Oui,
Indra, de ton trait rapide, tu frappes cet impie qui semble
endormi et qui retient prisonnières les ondes divines.
« Enivré de notre Sonia, Indra a ouvert le ciel et les
mondes brillants, en brisant le corps de Bàla. Il a rendu
aux Angiras les vaches ' célestes enfermées dans la caverne.
Il a repoussé Bâla, qui s’avançait en ennemi. »
La force d’Indra est immense, et il triomphe seul le
plus souvent. Quelquefois il combat avec l’aide d’autres
dieux, d’Agni, de Vishnou, personnification de l’action
féconde du soleil, qui n’a qu’un rôle effacé dans les Vêdas,
i. Ce mot a dans les Hymnes un sens poétique qu’il n’a pas
dans notre langue.
Tome XLIX.
Brâhmane Civaïte. — Peinture de Félix Régamey.
(Musée Guimet, n° 4784.)
mais qui fera plus tard une brillante fortune ; ses auxiliaires
ordinaires sont les Marouts, les vents, dont la troupe tur-
bulente est surtout secourable et bienfaisante ; ceux-ci ont
pour père Roudra, le hurleur, aussi un dieu de l’orage
fertilisant, et qui deviendra avec le temps le redoutable
Çiva, sans que rien puisse faire présager cette transfor-
mation.
Si Indra personnifie l’énergie active du ciel, Varouna
(Ouranos) en représente la beauté et la majesté. Ses yeux
innombrables surveillent les actions des hommes; il n’est
pas toujours clément; c’est un dieu sévère et justicier et
rien ne lui échappe.
A côté de ces dieux principaux, se placent d’autres
divinités plus ou moins solaires, car la plupart des mythes
védiques ont le soleil pour origine, telles que Soûrya, le
soleil (fils d’Aditi, l’immensité), dont le char, attelé de sept
chevaux rouges, est conduit par le cocher Vivaçvat ; Savitri,
le vivificateur, qui éveille les hommes
ou les plonge dans le sommeil ; Poû-
shan, le nourricier, guide des hommes
et des troupeaux; Oushas, l’aurore, et
ses fiancés les Acvins, les crépuscules,
fils du soleil. C’est un dieu solaire,
Yama, qui règne au séjour des tré-
passés ; conduits par Poûshan, ceux
qui ont bien vécu, les Pitris, les pères,
vont jouir avec lui d’une félicité éter-
nelle.
Le culte qu’on rendait à ces dieux
se célébrait en plein air ; il consistait
en sacrifices accompagnés d’invoca-
tions. Le père officiait au nom de la
famille; au milieu d’une enceinte,
s’élevait un autel de gazon sur lequel
était disposé un foyer; chaque famille
avait le sien. L’offrande était jetée
dans le feu qui la portait aux autres
dieux; c’était du beurre fondu, du lait,
des gâteaux de riz, et le Sonia pour
les libations. Le soma joue un grand
rôle dans la religion védique ; cette
liqueur, faite du jus de la plante du
même nom, l’asclépiade amère, ou de
grains qu'on laissait fermenter, était
un breuvage enivrant ; on le versait
aux dieux, surtout à Indra dont il
exaltait les forces. Puis Soma finit
par personnifier le sacrifice et par
devenir dieu; comme Agni, il eut une origine céleste, et
donna la vie et l’immortalité. On offrait le sacrifice trois
fois par jour, à l’aurore, à midi, le soir. Le sacrifice pai
excellence, le plus agréable aux dieux à cause de la valeur
de la victime, mais qui n’avait lieu qu exceptionnellement,
était celui du cheval (Açvamédha).
Primitivement, le sacrifice est un échange : « Agni,
toi qui portes le nom d’Angiras, le bien que tu feras à ton
serviteur tournera à ton avantage » ; mais on lui donne
ensuite un sens mystique; c’est non seulement une imi-
tation des phénomènes célestes, mais une intervention
dans ces phénomènes, qui a pour but d en assurer le retour,
quelque chose d’analogue à l’envoûtement au Moyen-Age.
Avec le temps, le culte perd sa simplicité, les rites se
fixent et se compliquent L Déjà on voit poindre le prêtre
1. Pendant cette période, comme pendant la période brâhma-
nique, il n’y a pas de culte commun. Le sacrifice est offert au nom
d’une personne et s’étend tout au plus aux membres de la famille;
généralement, il s’adresse à tous les dieux. Il n'y a donc pas de
temples et probablement pas d’idoles.
38
253
ces phénomènes par des conceptions plus abstraites qui
en dérivaient, ou les avaient voilés sous un symbolisme
compliqué.
Le dieu le plus anciennement et le plus souvent invo-
qué est Agni, dieu du feu céleste et du feu terrestre. La
grandeur de son rôle s’explique par l’importance que
devait avoir le feu pour les races primitives. Il renaît
constamment : sur la terre, entre les mains du sacrificateur
par le frottement de deux morceaux de bois, les aranis ;
dans le ciel, où il se manifeste par le soleil et l’éclair, au
sein des rivières divines où les Acvins l’ont engendré avec
des aranis d’or. Il a été apporté aux mortels par Mata-
riçvan (un symbole de l’éclair), mais il est d’origine céleste,
comme l’homme lui-même d’ailleurs, car c’est une vieille
croyance des races aryennes, que le premier ancêtre est le
feu, descendu du ciel. Générateur du sacrifice, il porte aux
autres dieux, sur ses ailes de flammes, les prières et les
vœux des mortels. Il est l’hôte et l’ami
de l’homme, le protecteur du foyer
domestique. Il produit et conserve la
vie universelle. Le Rig-Vêda s’ouvre
et se ferme par une invocation à Agni.
Vient ensuite Indra. C’est le soleil
et l’éclair; puis c’est le dieu qui fait
lever le soleil après l’aurore, le dieu
de l'orage et de la pluie bienfaisante,
puis le dieu de l’atmosphère, le dieu
du ciel, le roi des dieux ; Zeus en est
l’image amoindrie. L’importance
d’Indra s’explique aussi dans un pays
comme l’Inde où la chaleur et la sé-
cheresse sont si redoutables. Indra est
le dieu national des Aryas ; c’est le
dieu des guerriers, l’idéal du chef de
clan ; il combat pour son peuple et
défait les démons etles Dasyous ; mais
c’est surtout dans le ciel qu’il livre
ses batailles : armé de la foudre qu’a
forgée pour lui Tchwatri, le forgeron
divin, il frappe sans relâche les Asou-
ras (divinités habitant les nuages),
Vritra (le nuage qui voile le soleil),
Ahi, le dragon (le nuage qui se déve-
loppe comme un serpent), Çushna, le
dessécheur, et il délivre les vaches
célestes (les nuages de pluie), que
Bdla, le receleur, retenait captives
dans la caverne.
Les Hymnes célèbrent avec magnificence les combats
victorieux d’Indra :
« Je veux chanter les antiques exploits par lesquels
s’est distingué le foudroyant Indra. Il a frappé Ahi qui se
cachait au sein de la montagne céleste ; il l’a frappé de
cette arme retentissante forgée pour lui par Tchwatri.
« Quand tu donnes la mort à Writra, alors tu lances
les eaux pareilles à des coursiers animés au combat. Oui,
Indra, de ton trait rapide, tu frappes cet impie qui semble
endormi et qui retient prisonnières les ondes divines.
« Enivré de notre Sonia, Indra a ouvert le ciel et les
mondes brillants, en brisant le corps de Bàla. Il a rendu
aux Angiras les vaches ' célestes enfermées dans la caverne.
Il a repoussé Bâla, qui s’avançait en ennemi. »
La force d’Indra est immense, et il triomphe seul le
plus souvent. Quelquefois il combat avec l’aide d’autres
dieux, d’Agni, de Vishnou, personnification de l’action
féconde du soleil, qui n’a qu’un rôle effacé dans les Vêdas,
i. Ce mot a dans les Hymnes un sens poétique qu’il n’a pas
dans notre langue.
Tome XLIX.
Brâhmane Civaïte. — Peinture de Félix Régamey.
(Musée Guimet, n° 4784.)
mais qui fera plus tard une brillante fortune ; ses auxiliaires
ordinaires sont les Marouts, les vents, dont la troupe tur-
bulente est surtout secourable et bienfaisante ; ceux-ci ont
pour père Roudra, le hurleur, aussi un dieu de l’orage
fertilisant, et qui deviendra avec le temps le redoutable
Çiva, sans que rien puisse faire présager cette transfor-
mation.
Si Indra personnifie l’énergie active du ciel, Varouna
(Ouranos) en représente la beauté et la majesté. Ses yeux
innombrables surveillent les actions des hommes; il n’est
pas toujours clément; c’est un dieu sévère et justicier et
rien ne lui échappe.
A côté de ces dieux principaux, se placent d’autres
divinités plus ou moins solaires, car la plupart des mythes
védiques ont le soleil pour origine, telles que Soûrya, le
soleil (fils d’Aditi, l’immensité), dont le char, attelé de sept
chevaux rouges, est conduit par le cocher Vivaçvat ; Savitri,
le vivificateur, qui éveille les hommes
ou les plonge dans le sommeil ; Poû-
shan, le nourricier, guide des hommes
et des troupeaux; Oushas, l’aurore, et
ses fiancés les Acvins, les crépuscules,
fils du soleil. C’est un dieu solaire,
Yama, qui règne au séjour des tré-
passés ; conduits par Poûshan, ceux
qui ont bien vécu, les Pitris, les pères,
vont jouir avec lui d’une félicité éter-
nelle.
Le culte qu’on rendait à ces dieux
se célébrait en plein air ; il consistait
en sacrifices accompagnés d’invoca-
tions. Le père officiait au nom de la
famille; au milieu d’une enceinte,
s’élevait un autel de gazon sur lequel
était disposé un foyer; chaque famille
avait le sien. L’offrande était jetée
dans le feu qui la portait aux autres
dieux; c’était du beurre fondu, du lait,
des gâteaux de riz, et le Sonia pour
les libations. Le soma joue un grand
rôle dans la religion védique ; cette
liqueur, faite du jus de la plante du
même nom, l’asclépiade amère, ou de
grains qu'on laissait fermenter, était
un breuvage enivrant ; on le versait
aux dieux, surtout à Indra dont il
exaltait les forces. Puis Soma finit
par personnifier le sacrifice et par
devenir dieu; comme Agni, il eut une origine céleste, et
donna la vie et l’immortalité. On offrait le sacrifice trois
fois par jour, à l’aurore, à midi, le soir. Le sacrifice pai
excellence, le plus agréable aux dieux à cause de la valeur
de la victime, mais qui n’avait lieu qu exceptionnellement,
était celui du cheval (Açvamédha).
Primitivement, le sacrifice est un échange : « Agni,
toi qui portes le nom d’Angiras, le bien que tu feras à ton
serviteur tournera à ton avantage » ; mais on lui donne
ensuite un sens mystique; c’est non seulement une imi-
tation des phénomènes célestes, mais une intervention
dans ces phénomènes, qui a pour but d en assurer le retour,
quelque chose d’analogue à l’envoûtement au Moyen-Age.
Avec le temps, le culte perd sa simplicité, les rites se
fixent et se compliquent L Déjà on voit poindre le prêtre
1. Pendant cette période, comme pendant la période brâhma-
nique, il n’y a pas de culte commun. Le sacrifice est offert au nom
d’une personne et s’étend tout au plus aux membres de la famille;
généralement, il s’adresse à tous les dieux. Il n'y a donc pas de
temples et probablement pas d’idoles.
38