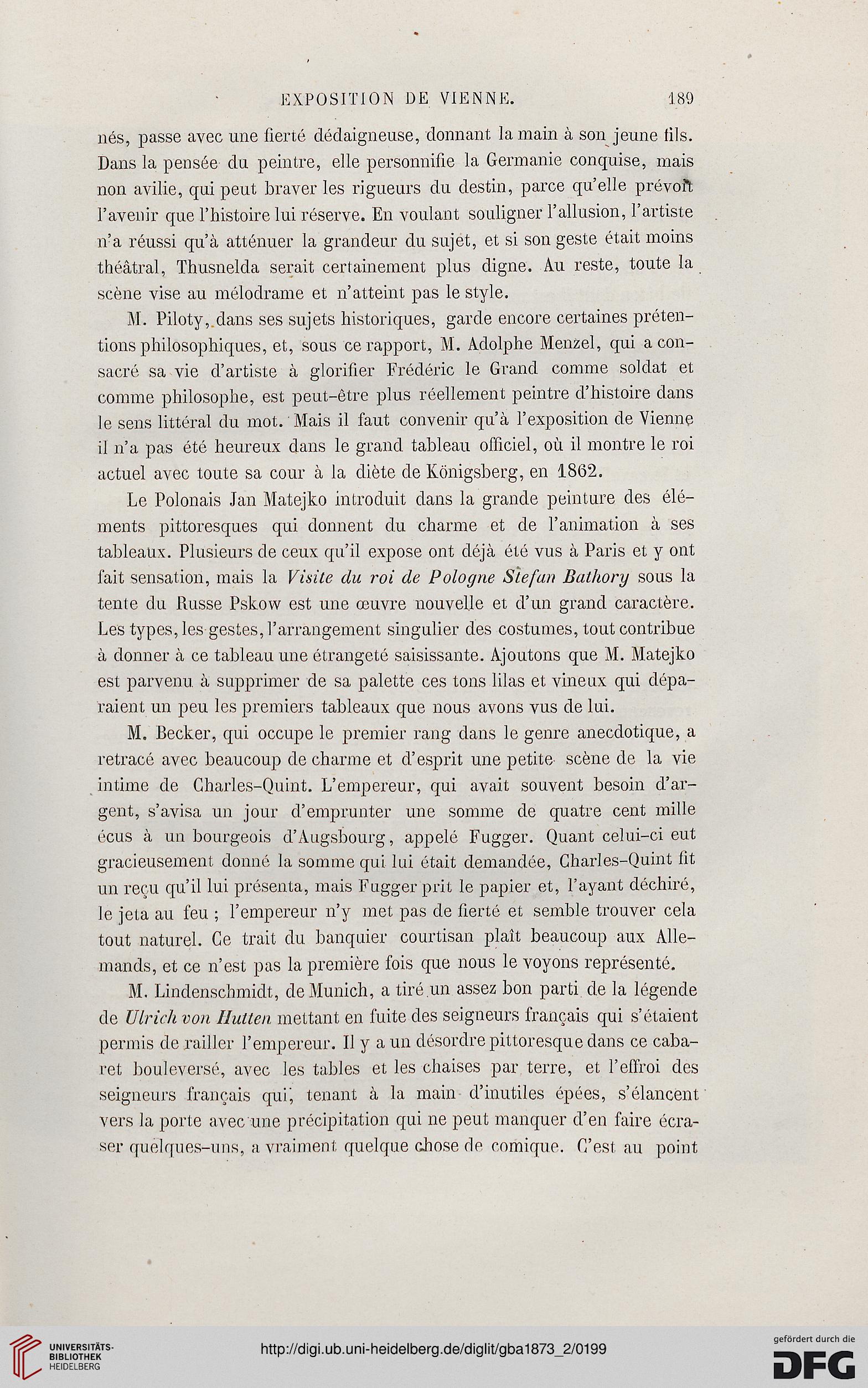EXPOSITION DE VIENNE.
189
nés, passe avec une fierté dédaigneuse, donnant la main à son jeune fils.
Dans la pensée du peintre, elle personnifie la Germanie conquise, mais
non avilie, qui peut braver les rigueurs du destin, parce qu’elle prévdTt
l’avenir que l’histoire lui réserve. En voulant souligner l’allusion, l’artiste
n’a réussi qu’à atténuer la grandeur du sujet, et si son geste était moins
théâtral, Thusnelda serait certainement plus digne. Au reste, toute la
scène vise au mélodrame et n’atteint pas le style.
M. Piloty, dans ses sujets historiques, garde encore certaines préten-
tions philosophiques, et, sous ce rapport, M. Adolphe Menzel, qui a con-
sacré sa vie d’artiste à glorifier Frédéric le Grand comme soldat et
comme philosophe, est peut-être plus réellement peintre d’histoire dans
le sens littéral du mot. Mais il faut convenir qu’à l’exposition de Vienne
il n’a pas été heureux dans le grand tableau officiel, où il montre le roi
actuel avec toute sa cour à la diète de Kônigsberg, en 1862.
Le Polonais Jan Matejko introduit dans la grande peinture des élé-
ments pittoresques qui donnent du charme et de l’animation à ses
tableaux. Plusieurs de ceux qu’il expose ont déjà été vus à Paris et y ont
fait sensation, mais la Visite du roi de Pologne Stefan Bathory sous la
tente du Russe Pskow est une œuvre nouvelle et d’un grand caractère.
Les types, les gestes, l’arrangement singulier des costumes, tout contribue
à donner à ce tableau une étrangeté saisissante. Ajoutons que M. Matejko
est parvenu à supprimer de sa palette ces tons lilas et vineux qui dépa-
raient un peu les premiers tableaux que nous avons vus de lui.
M. Becker, qui occupe le premier rang dans le genre anecdotique, a
retracé avec beaucoup de charme et d’esprit une petite scène de la vie
intime de Charles-Quint. L’empereur, qui avait souvent besoin d’ar-
gent, s’avisa un jour d’emprunter une somme de quatre cent mille
écus à un bourgeois d’Augsbourg, appelé Fugger. Quant celui-ci eut
gracieusement donné la somme qui lui était demandée, Charles-Quint fit
un reçu qu’il lui présenta, mais Fugger prit le papier et, l’ayant déchiré,
le jeta au feu ; l’empereur n’y met pas de fierté et semble trouver cela
tout naturel. Ce trait du banquier courtisan plaît beaucoup aux Alle-
mands, et ce n’est pas la première fois que nous le voyons représenté.
M. Lindenschmidt, de Munich, a tiré un assez bon parti de la légende
de Ulrich von Ilulten mettant en fuite des seigneurs français qui s’étaient
permis de railler l’empereur. Il y a un désordre pittoresque dans ce caba-
ret bouleversé, avec les tables et les chaises })ar terre, et l’effroi des
seigneurs français qui', tenant à la main d’inutiles épées, s’élancent
vers la porte avec une précipitation qui ne peut manquer d’en faire écra-
ser quelques-uns, a vraiment quelque chose de comique. C’est au point
189
nés, passe avec une fierté dédaigneuse, donnant la main à son jeune fils.
Dans la pensée du peintre, elle personnifie la Germanie conquise, mais
non avilie, qui peut braver les rigueurs du destin, parce qu’elle prévdTt
l’avenir que l’histoire lui réserve. En voulant souligner l’allusion, l’artiste
n’a réussi qu’à atténuer la grandeur du sujet, et si son geste était moins
théâtral, Thusnelda serait certainement plus digne. Au reste, toute la
scène vise au mélodrame et n’atteint pas le style.
M. Piloty, dans ses sujets historiques, garde encore certaines préten-
tions philosophiques, et, sous ce rapport, M. Adolphe Menzel, qui a con-
sacré sa vie d’artiste à glorifier Frédéric le Grand comme soldat et
comme philosophe, est peut-être plus réellement peintre d’histoire dans
le sens littéral du mot. Mais il faut convenir qu’à l’exposition de Vienne
il n’a pas été heureux dans le grand tableau officiel, où il montre le roi
actuel avec toute sa cour à la diète de Kônigsberg, en 1862.
Le Polonais Jan Matejko introduit dans la grande peinture des élé-
ments pittoresques qui donnent du charme et de l’animation à ses
tableaux. Plusieurs de ceux qu’il expose ont déjà été vus à Paris et y ont
fait sensation, mais la Visite du roi de Pologne Stefan Bathory sous la
tente du Russe Pskow est une œuvre nouvelle et d’un grand caractère.
Les types, les gestes, l’arrangement singulier des costumes, tout contribue
à donner à ce tableau une étrangeté saisissante. Ajoutons que M. Matejko
est parvenu à supprimer de sa palette ces tons lilas et vineux qui dépa-
raient un peu les premiers tableaux que nous avons vus de lui.
M. Becker, qui occupe le premier rang dans le genre anecdotique, a
retracé avec beaucoup de charme et d’esprit une petite scène de la vie
intime de Charles-Quint. L’empereur, qui avait souvent besoin d’ar-
gent, s’avisa un jour d’emprunter une somme de quatre cent mille
écus à un bourgeois d’Augsbourg, appelé Fugger. Quant celui-ci eut
gracieusement donné la somme qui lui était demandée, Charles-Quint fit
un reçu qu’il lui présenta, mais Fugger prit le papier et, l’ayant déchiré,
le jeta au feu ; l’empereur n’y met pas de fierté et semble trouver cela
tout naturel. Ce trait du banquier courtisan plaît beaucoup aux Alle-
mands, et ce n’est pas la première fois que nous le voyons représenté.
M. Lindenschmidt, de Munich, a tiré un assez bon parti de la légende
de Ulrich von Ilulten mettant en fuite des seigneurs français qui s’étaient
permis de railler l’empereur. Il y a un désordre pittoresque dans ce caba-
ret bouleversé, avec les tables et les chaises })ar terre, et l’effroi des
seigneurs français qui', tenant à la main d’inutiles épées, s’élancent
vers la porte avec une précipitation qui ne peut manquer d’en faire écra-
ser quelques-uns, a vraiment quelque chose de comique. C’est au point