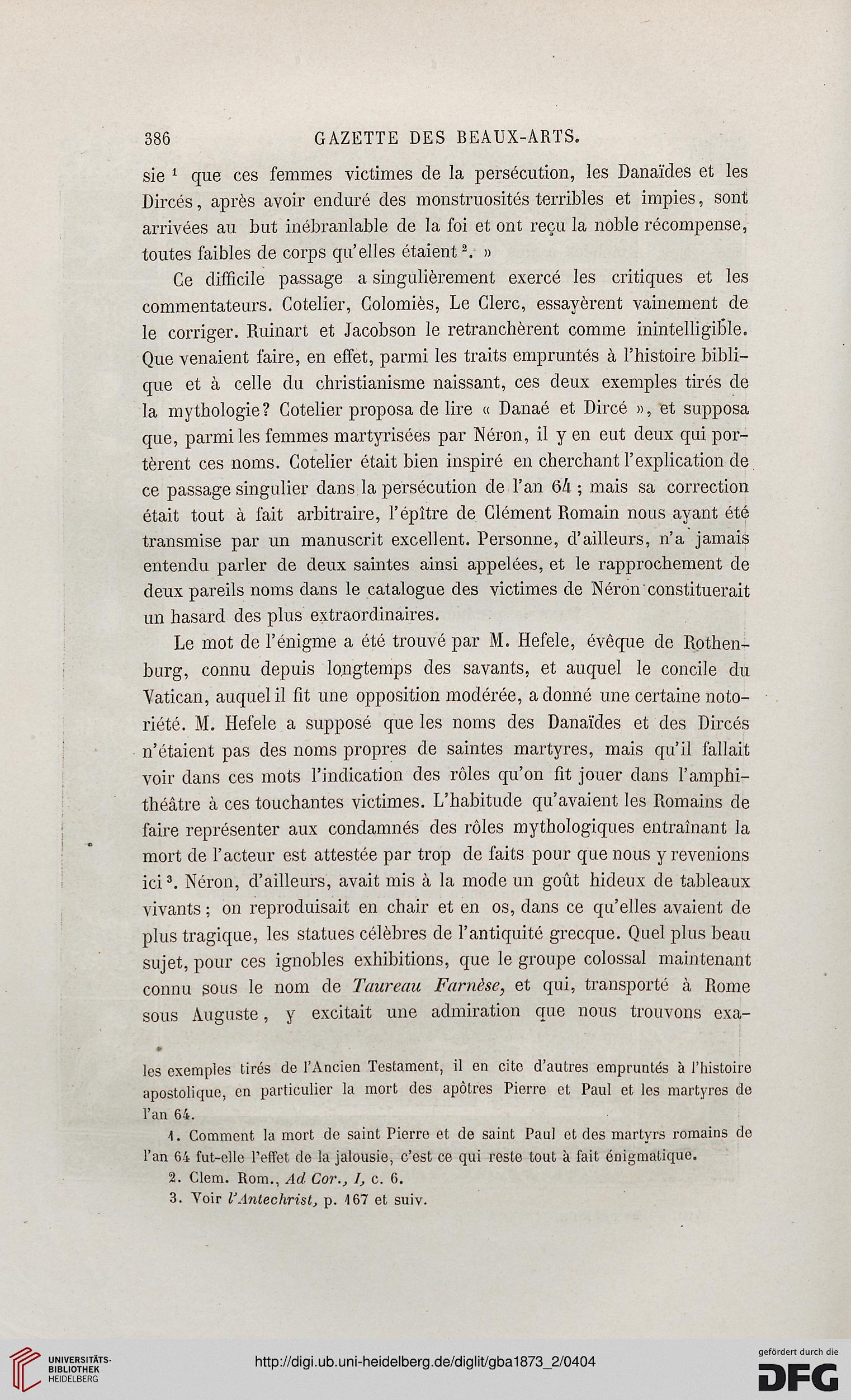386
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
sie 1 que ces femmes victimes de la persécution, les Danaïdes et les
Dircés, après avoir enduré des monstruosités terribles et impies, sont
arrivées au but inébranlable de la foi et ont reçu la noble récompense,
toutes faibles de corps qu’elles étaient2. »
Ce difficile passage a singulièrement exercé les critiques et les
commentateurs. Cotelier, Colomiès, Le Clerc, essayèrent vainement de
le corriger. Ruinart et Jacobson le retranchèrent comme inintelligible.
Que venaient faire, en effet, parmi les traits empruntés à l’histoire bibli-
que et à celle du christianisme naissant, ces deux exemples tirés de
la mythologie? Cotelier proposa de lire « Danaé et Dircé », et supposa
que, parmi les femmes martyrisées par Néron, il y en eut deux qui por-
tèrent ces noms. Cotelier était bien inspiré en cherchant l’explication de
ce passage singulier dans la persécution de l’an 64 ; mais sa correction
était tout à fait arbitraire, l’épître de Clément Romain nous ayant été
transmise par un manuscrit excellent. Personne, d’ailleurs, n’a jamais
entendu parler de deux saintes ainsi appelées, et le rapprochement de
deux pareils noms dans le catalogue des victimes de Néron constituerait
un hasard des plus extraordinaires.
Le mot de l’énigme a été trouvé par M. Hefele, évêque de Rothen-
burg, connu depuis longtemps des savants, et auquel le concile du
Vatican, auquel il fit une opposition modérée, adonné une certaine noto-
riété. M. Hefele a supposé que les noms des Danaïdes et des Dircés
n’étaient pas des noms propres de saintes martyres, mais qu’il fallait
voir dans ces mots l’indication des rôles qu’on fit jouer dans l’amphi-
théâtre à ces touchantes victimes. L’habitude qu’avaient les Romains de
faire représenter aux condamnés des rôles mythologiques entraînant la
mort de l’acteur est attestée par trop de faits pour que nous y revenions
ici3. Néron, d’ailleurs, avait mis à la mode un goût hideux de tableaux
vivants ; on reproduisait en chair et en os, dans ce qu’elles avaient de
plus tragique, les statues célèbres de l’antiquité grecque. Quel plus beau
sujet, pour ces ignobles exhibitions, que le groupe colossal maintenant
connu sous le nom de Taureau Farnèse, et qui, transporté à Rome
sous Auguste, y excitait une admiration que nous trouvons exa-
•
les exemples tirés de l’Ancien Testament, il en cite d’autres empruntés à l’histoire
apostolique, en particulier la mort des apôtres Pierre et Paul et les martyres de
l’an 64.
1. Comment la mort de saint Pierre et de saint Paul et des martyrs romains de
l’an 64 fut-elle l’effet de la jalousie, c’est ce qui reste tout à fait énigmatique.
2. Clem. Rom., Ad Cor., I, c. 6.
3. Voir VAntéchrist, p. 167 et suiv.
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
sie 1 que ces femmes victimes de la persécution, les Danaïdes et les
Dircés, après avoir enduré des monstruosités terribles et impies, sont
arrivées au but inébranlable de la foi et ont reçu la noble récompense,
toutes faibles de corps qu’elles étaient2. »
Ce difficile passage a singulièrement exercé les critiques et les
commentateurs. Cotelier, Colomiès, Le Clerc, essayèrent vainement de
le corriger. Ruinart et Jacobson le retranchèrent comme inintelligible.
Que venaient faire, en effet, parmi les traits empruntés à l’histoire bibli-
que et à celle du christianisme naissant, ces deux exemples tirés de
la mythologie? Cotelier proposa de lire « Danaé et Dircé », et supposa
que, parmi les femmes martyrisées par Néron, il y en eut deux qui por-
tèrent ces noms. Cotelier était bien inspiré en cherchant l’explication de
ce passage singulier dans la persécution de l’an 64 ; mais sa correction
était tout à fait arbitraire, l’épître de Clément Romain nous ayant été
transmise par un manuscrit excellent. Personne, d’ailleurs, n’a jamais
entendu parler de deux saintes ainsi appelées, et le rapprochement de
deux pareils noms dans le catalogue des victimes de Néron constituerait
un hasard des plus extraordinaires.
Le mot de l’énigme a été trouvé par M. Hefele, évêque de Rothen-
burg, connu depuis longtemps des savants, et auquel le concile du
Vatican, auquel il fit une opposition modérée, adonné une certaine noto-
riété. M. Hefele a supposé que les noms des Danaïdes et des Dircés
n’étaient pas des noms propres de saintes martyres, mais qu’il fallait
voir dans ces mots l’indication des rôles qu’on fit jouer dans l’amphi-
théâtre à ces touchantes victimes. L’habitude qu’avaient les Romains de
faire représenter aux condamnés des rôles mythologiques entraînant la
mort de l’acteur est attestée par trop de faits pour que nous y revenions
ici3. Néron, d’ailleurs, avait mis à la mode un goût hideux de tableaux
vivants ; on reproduisait en chair et en os, dans ce qu’elles avaient de
plus tragique, les statues célèbres de l’antiquité grecque. Quel plus beau
sujet, pour ces ignobles exhibitions, que le groupe colossal maintenant
connu sous le nom de Taureau Farnèse, et qui, transporté à Rome
sous Auguste, y excitait une admiration que nous trouvons exa-
•
les exemples tirés de l’Ancien Testament, il en cite d’autres empruntés à l’histoire
apostolique, en particulier la mort des apôtres Pierre et Paul et les martyres de
l’an 64.
1. Comment la mort de saint Pierre et de saint Paul et des martyrs romains de
l’an 64 fut-elle l’effet de la jalousie, c’est ce qui reste tout à fait énigmatique.
2. Clem. Rom., Ad Cor., I, c. 6.
3. Voir VAntéchrist, p. 167 et suiv.