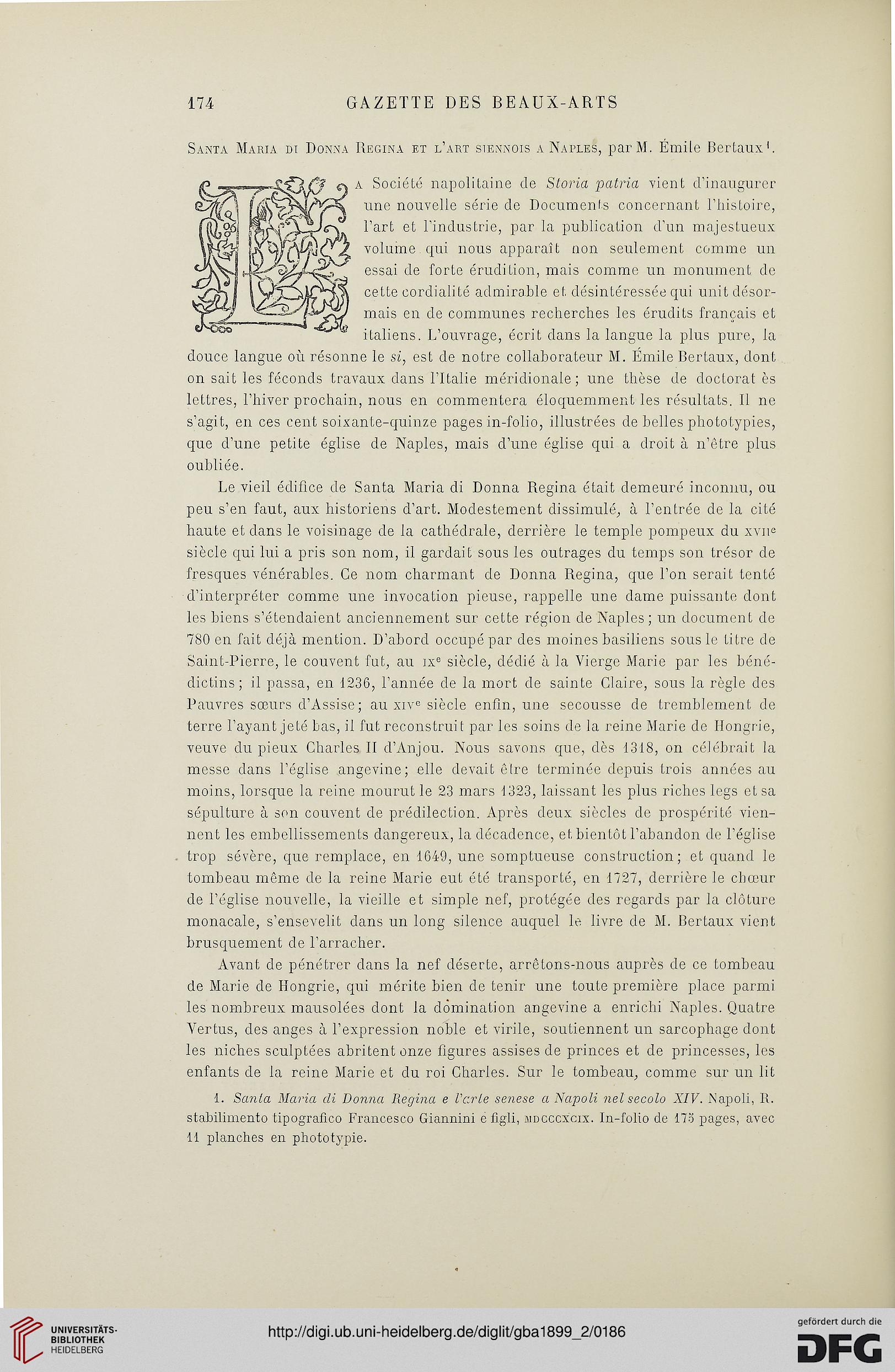174
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Santa Maria di Donna Regina et l’art siennois a Naples, parM. Émile Bertaux1.
a Société napolitaine de Storia patria vient d’inaugurer
une nouvelle série de Documents concernant l’histoire,
l’art et l’industrie, par la publication d’un majestueux
volume, qui nous apparaît non seulement comme un
essai de forte érudition, mais comme un monument de
cette cordialité admirable et désintéressée qui unit désor-
mais en de communes recherches les érudits français et
italiens. L’ouvrage, écrit dans la langue la plus pure, la
douce langue où résonne le si, est de notre collaborateur M. Émile Bertaux, dont
on sait les féconds travaux dans l’Italie méridionale; une thèse de doctorat ès
lettres, l’hiver prochain, nous en commentera éloquemment les résultats. Il ne
s’agit, en ces cent soixante-quinze pages in-folio, illustrées de belles phototypies,
que d’une petite église de Naples, mais d’une église qui a droit à n’être plus
oubliée.
Le vieil édifice de Santa Maria di Donna Regina était demeuré inconnu, ou
peu s’en faut, aux historiens d’art. Modestement dissimulé, à l’entrée de la cité
haute et dans le voisinage de la cathédrale, derrière le temple pompeux du xvne
siècle qui lui a pris son nom, il gardait sous les outrages du temps son trésor de
fresques vénérables. Ce nom charmant de Donna Regina, que l’on serait tenté
d’interpréter comme une invocation pieuse, rappelle une dame puissante dont
les biens s’étendaient anciennement sur cette région de Naples; un document de
780 en fait déjà mention. D’abord occupé par des moines basiliens sous le Litre de
Saint-Pierre, le couvent fut, au ixe siècle, dédié à la Vierge Marie par les béné-
dictins ; il passa, en 1236, l’année de la mort de sainte Claire, sous la règle des
Pauvres sœurs d’Assise; au xive siècle enfin, une secousse de tremblement de
terre l’ayant jeté bas, il fut reconstruit par les soins de la reine Marie de Hongrie,
veuve du pieux Charles II d’Anjou. Nous savons que, dès 1318, on célébrait la
messe dans l’église angevine; elle devait être terminée depuis trois années au
moins, lorsque la reine mourut le 23 mars 1323, laissant les plus riches legs et sa
sépulture à son couvent de prédilection. Après deux siècles de prospérité vien-
nent les embellissements dangereux, la décadence, et bientôt l’abandon de l’église
trop sévère, que remplace, en 1649, une somptueuse construction; et quand le
tombeau même de la reine Marie eut été transporté, en 1727, derrière le chœur
de l’église nouvelle, la vieille et simple nef, protégée des regards par la clôture
monacale, s’ensevelit dans un long silence auquel le livre de M. Bertaux vient
brusquement de l’arracher.
Avant de pénétrer dans la nef déserte, arrêtons-nous auprès de ce tombeau
de Marie de Hongrie, qui mérite bien de tenir une toute première place parmi
les nombreux mausolées dont la domination angevine a enrichi Naples. Quatre
Vertus, des anges à l’expression noble et virile, soutiennent un sarcophage dont
les niches sculptées abritent onze figures assises de princes et de princesses, les
enfants de la reine Marie et du roi Charles. Sur le tombeau, comme sur un lit
1. Santa Maria di Donna Regina e Varie senese a Napoli nel secolo XIV. Napoli, R.
stabilimento tipografico Francesco Giannini e figli, mdgccxcix. In-folio de 175 pages, avec
11 planches en phototypie.
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Santa Maria di Donna Regina et l’art siennois a Naples, parM. Émile Bertaux1.
a Société napolitaine de Storia patria vient d’inaugurer
une nouvelle série de Documents concernant l’histoire,
l’art et l’industrie, par la publication d’un majestueux
volume, qui nous apparaît non seulement comme un
essai de forte érudition, mais comme un monument de
cette cordialité admirable et désintéressée qui unit désor-
mais en de communes recherches les érudits français et
italiens. L’ouvrage, écrit dans la langue la plus pure, la
douce langue où résonne le si, est de notre collaborateur M. Émile Bertaux, dont
on sait les féconds travaux dans l’Italie méridionale; une thèse de doctorat ès
lettres, l’hiver prochain, nous en commentera éloquemment les résultats. Il ne
s’agit, en ces cent soixante-quinze pages in-folio, illustrées de belles phototypies,
que d’une petite église de Naples, mais d’une église qui a droit à n’être plus
oubliée.
Le vieil édifice de Santa Maria di Donna Regina était demeuré inconnu, ou
peu s’en faut, aux historiens d’art. Modestement dissimulé, à l’entrée de la cité
haute et dans le voisinage de la cathédrale, derrière le temple pompeux du xvne
siècle qui lui a pris son nom, il gardait sous les outrages du temps son trésor de
fresques vénérables. Ce nom charmant de Donna Regina, que l’on serait tenté
d’interpréter comme une invocation pieuse, rappelle une dame puissante dont
les biens s’étendaient anciennement sur cette région de Naples; un document de
780 en fait déjà mention. D’abord occupé par des moines basiliens sous le Litre de
Saint-Pierre, le couvent fut, au ixe siècle, dédié à la Vierge Marie par les béné-
dictins ; il passa, en 1236, l’année de la mort de sainte Claire, sous la règle des
Pauvres sœurs d’Assise; au xive siècle enfin, une secousse de tremblement de
terre l’ayant jeté bas, il fut reconstruit par les soins de la reine Marie de Hongrie,
veuve du pieux Charles II d’Anjou. Nous savons que, dès 1318, on célébrait la
messe dans l’église angevine; elle devait être terminée depuis trois années au
moins, lorsque la reine mourut le 23 mars 1323, laissant les plus riches legs et sa
sépulture à son couvent de prédilection. Après deux siècles de prospérité vien-
nent les embellissements dangereux, la décadence, et bientôt l’abandon de l’église
trop sévère, que remplace, en 1649, une somptueuse construction; et quand le
tombeau même de la reine Marie eut été transporté, en 1727, derrière le chœur
de l’église nouvelle, la vieille et simple nef, protégée des regards par la clôture
monacale, s’ensevelit dans un long silence auquel le livre de M. Bertaux vient
brusquement de l’arracher.
Avant de pénétrer dans la nef déserte, arrêtons-nous auprès de ce tombeau
de Marie de Hongrie, qui mérite bien de tenir une toute première place parmi
les nombreux mausolées dont la domination angevine a enrichi Naples. Quatre
Vertus, des anges à l’expression noble et virile, soutiennent un sarcophage dont
les niches sculptées abritent onze figures assises de princes et de princesses, les
enfants de la reine Marie et du roi Charles. Sur le tombeau, comme sur un lit
1. Santa Maria di Donna Regina e Varie senese a Napoli nel secolo XIV. Napoli, R.
stabilimento tipografico Francesco Giannini e figli, mdgccxcix. In-folio de 175 pages, avec
11 planches en phototypie.