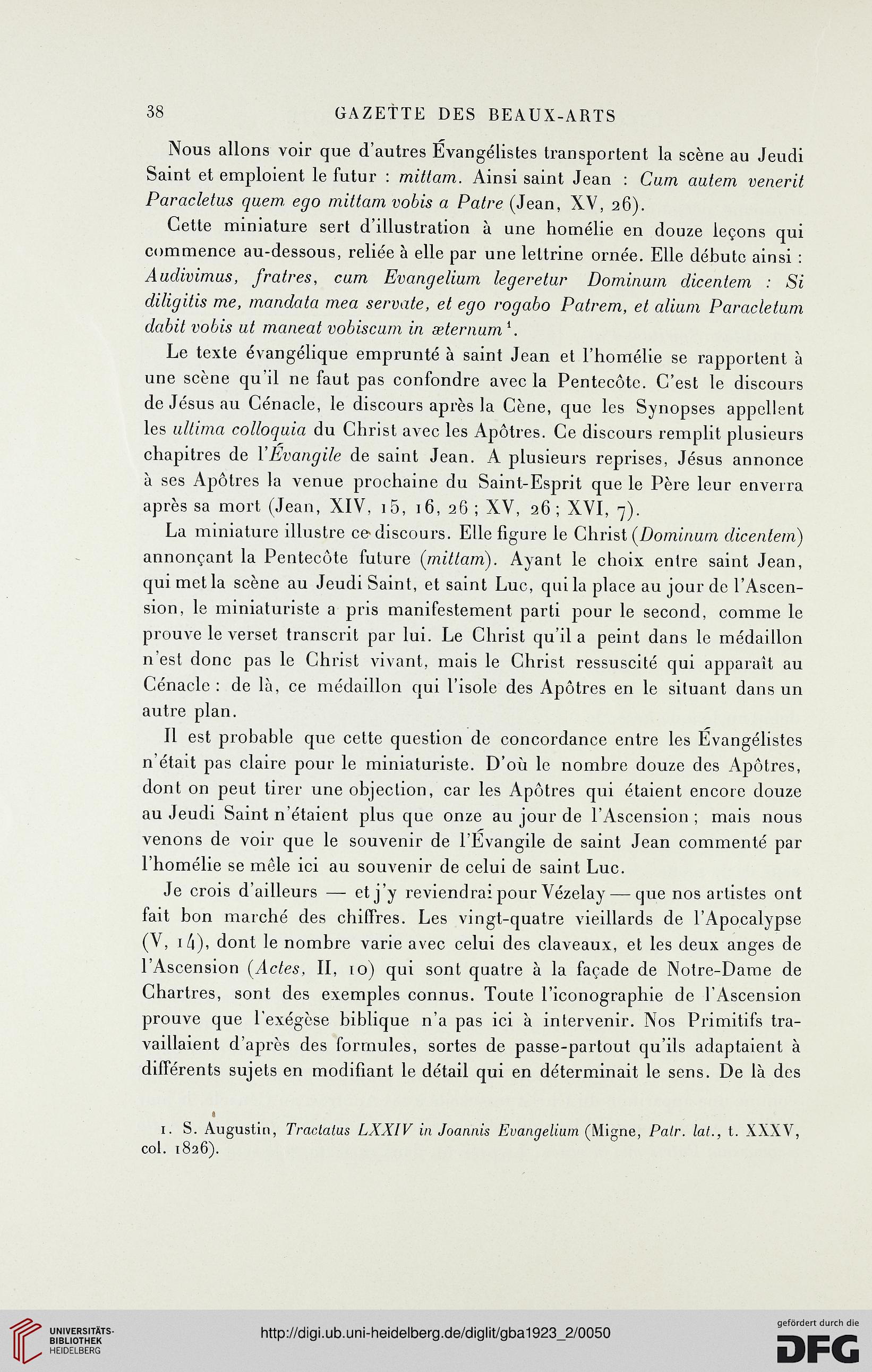38
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Nous allons voir que d’autres Évangélistes transportent la scène au Jeudi
Saint et emploient le futur : mitlam. Ainsi saint Jean : Cum autem venerit
Paracletus quem ego mittam vobis a Pâtre (Jean, XV, 26).
Cette miniature sert d’illustration à une homélie en douze leçons qui
commence au-dessous, reliée à elle par une lettrine ornée. Elle débute ainsi :
Auclivimus, fratres, cam Evangelium legeretur Dominurn dicentem : Si
diligitis me, mandata mea servate, et ego rogabo Patrem, et alium Paracletum
dabit vobis ut maneat vobiscum in æternum1.
Le texte évangélique emprunté à saint Jean et l’homélie se rapportent à
une scène qu'il ne faut pas confondre avec la Pentecôte. C’est le discours
de Jésus au Cénacle, le discours après la Cène, que les Synopses appellent
les ultima colloquia du Christ avec les Apôtres. Ce discours remplit plusieurs
chapitres de Y Evangile de saint Jean. A plusieurs reprises, Jésus annonce
à ses Apôtres la venue prochaine du Saint-Esprit que le Père leur enverra
après sa mort (Jean, XIV, i5, 16, 26 ; XV, 26; XVI, 7).
La miniature illustre ce discours. Elle figure le Christ (Dominum dicentem)
annonçant la Pentecôte future (mittam). Ayant le choix entre saint Jean,
qui met la scène au Jeudi Saint, et saint Luc, qui la place au jour de l’Ascen-
sion, le miniaturiste a pris manifestement parti pour le second, comme le
prouve le verset transcrit par lui. Le Christ qu il a peint dans le médaillon
n’est donc pas le Christ vivant, mais le Christ ressuscité qui apparaît au
Cénacle : de là, ce médaillon qui l’isole des Apôtres en le situant dans un
autre plan.
Il est probable que cette question de concordance entre les Evangélistes
n était pas claire pour le miniaturiste. D’où le nombre douze des Apôtres,
dont on peut tirer une objection, car les Apôtres qui étaient encore douze
au Jeudi Saint n’étaient plus que onze au jour de l’Ascension ; mais nous
venons de voir que le souvenir de l Evangile de saint Jean commenté par
l’homélie se mêle ici au souvenir de celui de saint Luc.
Je crois d’ailleurs — et j ’y reviendrai pour Vézelay — que nos artistes ont
fait bon marché des chiffres. Les vingt-quatre vieillards de l’Apocalypse
(V, 14), dont le nombre varie avec celui des claveaux, et les deux anges de
l’Ascension (Actes, II, 10) qui sont quatre à la façade de Notre-Dame de
Chartres, sont des exemples connus. Toute l’iconographie de l'Ascension
prouve que l'exégèse biblique n’a pas ici à intervenir. Nos Primitifs tra-
vaillaient d'après des formules, sortes de passe-partout qu’ils adaptaient à
différents sujets en modifiant le détail qui en déterminait le sens. De là des
ft
1. S. Augustin, Tractatus LXXIV in Joannis Evangelium (Migne, Pair, lat., t. XXXV,
col. 1826).
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Nous allons voir que d’autres Évangélistes transportent la scène au Jeudi
Saint et emploient le futur : mitlam. Ainsi saint Jean : Cum autem venerit
Paracletus quem ego mittam vobis a Pâtre (Jean, XV, 26).
Cette miniature sert d’illustration à une homélie en douze leçons qui
commence au-dessous, reliée à elle par une lettrine ornée. Elle débute ainsi :
Auclivimus, fratres, cam Evangelium legeretur Dominurn dicentem : Si
diligitis me, mandata mea servate, et ego rogabo Patrem, et alium Paracletum
dabit vobis ut maneat vobiscum in æternum1.
Le texte évangélique emprunté à saint Jean et l’homélie se rapportent à
une scène qu'il ne faut pas confondre avec la Pentecôte. C’est le discours
de Jésus au Cénacle, le discours après la Cène, que les Synopses appellent
les ultima colloquia du Christ avec les Apôtres. Ce discours remplit plusieurs
chapitres de Y Evangile de saint Jean. A plusieurs reprises, Jésus annonce
à ses Apôtres la venue prochaine du Saint-Esprit que le Père leur enverra
après sa mort (Jean, XIV, i5, 16, 26 ; XV, 26; XVI, 7).
La miniature illustre ce discours. Elle figure le Christ (Dominum dicentem)
annonçant la Pentecôte future (mittam). Ayant le choix entre saint Jean,
qui met la scène au Jeudi Saint, et saint Luc, qui la place au jour de l’Ascen-
sion, le miniaturiste a pris manifestement parti pour le second, comme le
prouve le verset transcrit par lui. Le Christ qu il a peint dans le médaillon
n’est donc pas le Christ vivant, mais le Christ ressuscité qui apparaît au
Cénacle : de là, ce médaillon qui l’isole des Apôtres en le situant dans un
autre plan.
Il est probable que cette question de concordance entre les Evangélistes
n était pas claire pour le miniaturiste. D’où le nombre douze des Apôtres,
dont on peut tirer une objection, car les Apôtres qui étaient encore douze
au Jeudi Saint n’étaient plus que onze au jour de l’Ascension ; mais nous
venons de voir que le souvenir de l Evangile de saint Jean commenté par
l’homélie se mêle ici au souvenir de celui de saint Luc.
Je crois d’ailleurs — et j ’y reviendrai pour Vézelay — que nos artistes ont
fait bon marché des chiffres. Les vingt-quatre vieillards de l’Apocalypse
(V, 14), dont le nombre varie avec celui des claveaux, et les deux anges de
l’Ascension (Actes, II, 10) qui sont quatre à la façade de Notre-Dame de
Chartres, sont des exemples connus. Toute l’iconographie de l'Ascension
prouve que l'exégèse biblique n’a pas ici à intervenir. Nos Primitifs tra-
vaillaient d'après des formules, sortes de passe-partout qu’ils adaptaient à
différents sujets en modifiant le détail qui en déterminait le sens. De là des
ft
1. S. Augustin, Tractatus LXXIV in Joannis Evangelium (Migne, Pair, lat., t. XXXV,
col. 1826).