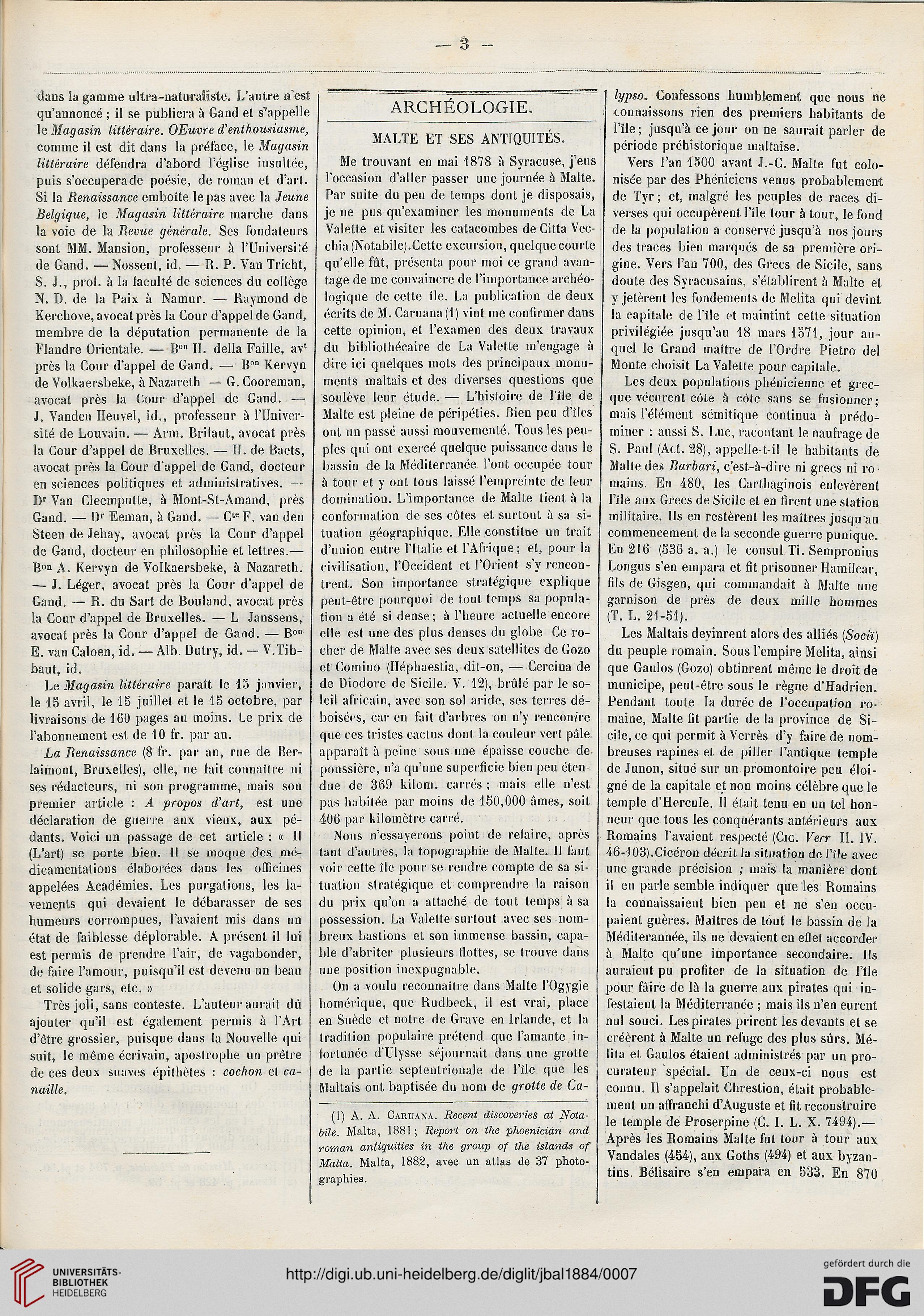— 3 -
dans la gamme ultra-naturaliste. L'autre n'est
qu'annoncé ; il se publiera à Gand et s1appelle
le Magasin littéraire. OEuvre d'enthousiasme,
comme il est dit dans la préface, le Magasin
littéraire défendra d'abord l'église insultée,
puis s'occuperade poésie, de roman et d'art.
Si la Renaissance emboîte le pas avec la Jeune
Belgique, le Magasin littéraire marche dans
la voie de la Revue générale. Ses fondateurs
sont MM. Mansion, professeur à l'Université
de Gand. — Nossent, id. — R. P. Van Tricht,
S. J., prof, à la laculté de sciences du collège
N. D. de la Paix à Namur. — Raymond de
Kerchove, avocat près la Cour d'appel de Gand,
membre de la députation permanente de la
Flandre Orientale. — B"n H. délia Faille, avl
près la Cour d'appel de Gand. — Bon Kervyn
de Volkaersbeke, à Nazareth — G. Cooreman,
avocat près la Cour d'appel de Gand. —
J. Vanden Heuvel, id., professeur à l'Univer-
sité de Louvain. — Arm. Britaut, avocat près
la Cour d'appel de Bruxelles. — H. de Baets,
avocat près la Cour d'appel de Gand, docteur
en sciences politiques et administratives. —
Dr Van Cleemputte, à Mont-St-Amand, près
Gand. — Dr Eeman, à Gand. — Cte F. van den
Steen de Jehay, avocat près la Cour d'appel
de Gand, docteur en philosophie et lettres.—
Boa A. Kervyn de Volkaersbeke, à Nazareth.
— J. Léger, avocat près la Cour d'appel de
Gand. — R. du Sart de Bouland, avocat près
la Cour d'appel de Bruxelles. — L Janssens,
avocat près la Cour d'appel de Gand. — B°"
E. van Caloen, id. — Alb. Dutry, id. — V.Tib-
baut, id.
Le Magasin littéraire paraît le do janvier,
le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre, par
livraisons de 160 pages au moins. Le prix de
l'abonnement est de 10 fr. par an.
La Renaissance (8 fr. par an, rue de Ber-
laimont, Bruxelles), elle, ne lait connaître ni
ses rédacteurs, ni son programme, mais son
premier article : A propos d'art, est une
déclaration de guerre aux vieux, aux pé-
dants. Voici un passage de cet article : « Il
(L'art) se porte bien. Il se moque des, mé-
dicamentations élaborées dans les odieines
appelées Académies. Les purgations, les la-
vemepts qui devaient le débarasser de ses
humeurs corrompues, l'avaient mis dans un
état de faiblesse déplorable. A présent il lui
est permis de prendre l'air, de vagabonder,
de faire l'amour, puisqu'il est devenu un beau
et solide gars, etc. »
Très joli, sans conteste. L'auteur aurait dù
ajouter qu'il est également permis à l'Art
d'être grossier, puisque dans la Nouvelle qui
suit, le même écrivain, apostrophe un prêtre
de ces deux suaves épilhèles : cochon et ca-
naille.
ARCHÉOLOGIE.
MALTE ET SES ANTIQUITÉS.
Me trouvant en mai 1878 & Syracuse, j'eus
l'occasion d'aller passer une journée à Malle.
Par suite du peu de temps dont je disposais,
je ne pus qu'examiner les monuments de La
Valette et visiter les catacombes de Citta Vec-
chia(Notabile).Cette excursion, quelque courte
qu'elle fût, présenta pour moi ce grand avan-
tage de me convaincre de l'importance archéo-
logique de celte île. La publication de deux
écrits de M. Caruana (1) vint me confirmer dans
cette opinion, et l'examen des deux travaux
du bibliothécaire de La Valette m'engage à
dire ici quelques mots des principaux monu-
ments maltais et des diverses questions que
soulève leur étude. — L'histoire de l'île de
Malte est pleine de péripéties. Bien peu d'îles
ont un passé aussi mouvementé. Tous les peu-
ples qui ont exercé quelque puissance dans le
bassin de la Méditerranée l'ont occupée tour
à tour et y ont tous laissé l'empreinte de leur
domination. L'importance de Malte tient à la
conformation de ses côtes et surtout à sa si-
tuation géographique. Elle constitue un trait
d'union entre l'Italie et l'Afrique; et, pour la
civilisation, l'Occident et l'Orient s'y rencon-
trent. Son importance stratégique explique
peut-être pourquoi de tout temps sa popula-
tion a été si dense; à l'heure actuelle encore
elle est une des plus denses du globe Ce ro-
cher de Malle avec ses deux satellites de Gozo
et Comino (Héphaestia, dit-on, — Cercina de
de Diodore de Sicile. V. 12), brûlé par le so-
leil africain, avec son sol aride, ses terres dé-
boisées, car en fait d'arbres on n'y rencontre
que ces tristes cactus dont la couleur vert pâle
apparaît à peine sous une épaisse couche de
poussière, n'a qu'une superficie bien peu éten-
due de 369 kilom. carrés ; mais elle n'est
pas habitée par moins de 150,000 âmes, soit
406 par kilomètre carré.
Nous n'essayerons point de refaire, après
tant d'autres, la topographie de Malte. Il faut
voir cette île pour se rendre compte de sa si-
tuation stratégique et comprendre la raison
du prix qu'on a attaché de tout temps à sa
possession. La Valette surtout avec ses nom-
breux bastions et son immense bassin, capa-
ble d'abriter plusieurs Hottes, se trouve dans
une position inexpugnable.
On a voulu reconnaître dans Malle l'Ogygie
homérique, que Rudbeck, il est vrai, place
en Suède et notre de Grave en Irlande, et la
tradition populaire prétend que l'amante in-
fortunée d'Ulysse séjournait dans une grotte
de la partie septentrionale de l'île que les
Maltais ont baptisée du nom de grotte de Ca-
(I) A. A. Caruana. Recent discoveries at Nota-
bile. Mal ta, 1881; Report on the phoenician and
roman antiquities in the group of the islands of
Malia. Malta, 1882, avec un atlas de 37 photo-
graphies.
lypso. Confessons humblement que nous ne
connaissons rien des premiers habitants de
l'île; jusqu'à ce jour on ne saurait parler de
période préhistorique maltaise.
Vers l'an 1500 avant J.-C. Malle fut colo-
nisée par des Phéniciens venus probablement
de Tyr; et, malgré les peuples de races di-
verses qui occupèrent l'île tour à tour, le fond
de la population a conservé jusqu'à nos jours
des traces bien marqués de sa première ori-
gine. Vers l'an 700, des Grecs de Sicile, sans
doute des Syracusains, s'établirent à Malte et
y jetèrent les fondements de Melita qui devint
la capitale de l'île et maintint cette situation
privilégiée jusqu'au 18 mars 1571, jour au-
quel le Grand maître de l'Ordre Pietro del
Monte choisit La Valette pour capitale.
Les deux populations phénicienne et grec-
que vécurent côte à côte sans se fusionner;
mais l'élément sémitique continua à prédo-
miner : aussi S. Luc, racontant le naufrage de
S. Paul (Act. 28), appelle-t-il le habitants de
Malte des Rarbari, c'est-à-dire ni grecs ni ro-
mains. En 480, les Carthaginois enlevèrent
l'île aux Grecs de Sicile et en firent une station
militaire. Ils en restèrent les maîtres jusqu au
commencement de la seconde guerre punique.
En 216 (536 a. a.) le consul Ti. Sempronius
Longus s'en empara et fit prisonner Hamilcar,
fils de Gisgen, qui commandait à Malte une
garnison de près de deux mille hommes
(T. L. 21-51).
Les Maltais devinrent alors des alliés (Sociï)
du peuple romain. Sous l'empire Melita, ainsi
que Gaulos (Gozo) obtinrent même le droit de
municipe, peut-être sous le règne d'Hadrien.
Pendant toute la durée de l'occupation ro-
maine, Malte fit partie de la province de Si-
cile, ce qui permit àVerrès d'y faire de nom-
breuses rapines et de piller l'antique temple
de Junon, situé sur un promontoire peu éloi-
gné de la capitale et non moins célèbre que le
temple d'Hercule. 11 était tenu en un tel hon-
neur que tous les conquérants antérieurs aux
Romains l'avaient respecté (Cic. Verr II. IV.
46-J03).Cicéron décrit la situation de l'île avec
une grande précision ; mais la manière dont
il en parle semble indiquer que les Romains
la connaissaient bien peu et ne s'en occu-
paient guères. Maîtres de tout le bassin de la
Méditerannée, ils ne devaient en effet accorder
à Malte qu'une importance secondaire. Ils
auraient pu profiter de la situation de l'île
pour faire de là la guerre aux pirates qui in-
festaient la Méditerranée ; mais ils n'en eurent
nul souci. Les pirates prirent les devants et se
créèrent à Malte un refuge des plus sûrs. Mé-
lita et Gaulos étaient administrés par un pro-
curateur spécial. Un de ceux-ci nous est
connu. 11 s'appelait Chrestion, était probable-
ment un affranchi d'Auguste et fit reconstruire
le temple de Proserpine (C. I. L. X. 7494).—
Après les Romains Malte fut tour à tour aux
Vandales (454), aux Goths (494) et aux byzan-
tins. Bélisaire s'en empara en 533. En 870
dans la gamme ultra-naturaliste. L'autre n'est
qu'annoncé ; il se publiera à Gand et s1appelle
le Magasin littéraire. OEuvre d'enthousiasme,
comme il est dit dans la préface, le Magasin
littéraire défendra d'abord l'église insultée,
puis s'occuperade poésie, de roman et d'art.
Si la Renaissance emboîte le pas avec la Jeune
Belgique, le Magasin littéraire marche dans
la voie de la Revue générale. Ses fondateurs
sont MM. Mansion, professeur à l'Université
de Gand. — Nossent, id. — R. P. Van Tricht,
S. J., prof, à la laculté de sciences du collège
N. D. de la Paix à Namur. — Raymond de
Kerchove, avocat près la Cour d'appel de Gand,
membre de la députation permanente de la
Flandre Orientale. — B"n H. délia Faille, avl
près la Cour d'appel de Gand. — Bon Kervyn
de Volkaersbeke, à Nazareth — G. Cooreman,
avocat près la Cour d'appel de Gand. —
J. Vanden Heuvel, id., professeur à l'Univer-
sité de Louvain. — Arm. Britaut, avocat près
la Cour d'appel de Bruxelles. — H. de Baets,
avocat près la Cour d'appel de Gand, docteur
en sciences politiques et administratives. —
Dr Van Cleemputte, à Mont-St-Amand, près
Gand. — Dr Eeman, à Gand. — Cte F. van den
Steen de Jehay, avocat près la Cour d'appel
de Gand, docteur en philosophie et lettres.—
Boa A. Kervyn de Volkaersbeke, à Nazareth.
— J. Léger, avocat près la Cour d'appel de
Gand. — R. du Sart de Bouland, avocat près
la Cour d'appel de Bruxelles. — L Janssens,
avocat près la Cour d'appel de Gand. — B°"
E. van Caloen, id. — Alb. Dutry, id. — V.Tib-
baut, id.
Le Magasin littéraire paraît le do janvier,
le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre, par
livraisons de 160 pages au moins. Le prix de
l'abonnement est de 10 fr. par an.
La Renaissance (8 fr. par an, rue de Ber-
laimont, Bruxelles), elle, ne lait connaître ni
ses rédacteurs, ni son programme, mais son
premier article : A propos d'art, est une
déclaration de guerre aux vieux, aux pé-
dants. Voici un passage de cet article : « Il
(L'art) se porte bien. Il se moque des, mé-
dicamentations élaborées dans les odieines
appelées Académies. Les purgations, les la-
vemepts qui devaient le débarasser de ses
humeurs corrompues, l'avaient mis dans un
état de faiblesse déplorable. A présent il lui
est permis de prendre l'air, de vagabonder,
de faire l'amour, puisqu'il est devenu un beau
et solide gars, etc. »
Très joli, sans conteste. L'auteur aurait dù
ajouter qu'il est également permis à l'Art
d'être grossier, puisque dans la Nouvelle qui
suit, le même écrivain, apostrophe un prêtre
de ces deux suaves épilhèles : cochon et ca-
naille.
ARCHÉOLOGIE.
MALTE ET SES ANTIQUITÉS.
Me trouvant en mai 1878 & Syracuse, j'eus
l'occasion d'aller passer une journée à Malle.
Par suite du peu de temps dont je disposais,
je ne pus qu'examiner les monuments de La
Valette et visiter les catacombes de Citta Vec-
chia(Notabile).Cette excursion, quelque courte
qu'elle fût, présenta pour moi ce grand avan-
tage de me convaincre de l'importance archéo-
logique de celte île. La publication de deux
écrits de M. Caruana (1) vint me confirmer dans
cette opinion, et l'examen des deux travaux
du bibliothécaire de La Valette m'engage à
dire ici quelques mots des principaux monu-
ments maltais et des diverses questions que
soulève leur étude. — L'histoire de l'île de
Malte est pleine de péripéties. Bien peu d'îles
ont un passé aussi mouvementé. Tous les peu-
ples qui ont exercé quelque puissance dans le
bassin de la Méditerranée l'ont occupée tour
à tour et y ont tous laissé l'empreinte de leur
domination. L'importance de Malte tient à la
conformation de ses côtes et surtout à sa si-
tuation géographique. Elle constitue un trait
d'union entre l'Italie et l'Afrique; et, pour la
civilisation, l'Occident et l'Orient s'y rencon-
trent. Son importance stratégique explique
peut-être pourquoi de tout temps sa popula-
tion a été si dense; à l'heure actuelle encore
elle est une des plus denses du globe Ce ro-
cher de Malle avec ses deux satellites de Gozo
et Comino (Héphaestia, dit-on, — Cercina de
de Diodore de Sicile. V. 12), brûlé par le so-
leil africain, avec son sol aride, ses terres dé-
boisées, car en fait d'arbres on n'y rencontre
que ces tristes cactus dont la couleur vert pâle
apparaît à peine sous une épaisse couche de
poussière, n'a qu'une superficie bien peu éten-
due de 369 kilom. carrés ; mais elle n'est
pas habitée par moins de 150,000 âmes, soit
406 par kilomètre carré.
Nous n'essayerons point de refaire, après
tant d'autres, la topographie de Malte. Il faut
voir cette île pour se rendre compte de sa si-
tuation stratégique et comprendre la raison
du prix qu'on a attaché de tout temps à sa
possession. La Valette surtout avec ses nom-
breux bastions et son immense bassin, capa-
ble d'abriter plusieurs Hottes, se trouve dans
une position inexpugnable.
On a voulu reconnaître dans Malle l'Ogygie
homérique, que Rudbeck, il est vrai, place
en Suède et notre de Grave en Irlande, et la
tradition populaire prétend que l'amante in-
fortunée d'Ulysse séjournait dans une grotte
de la partie septentrionale de l'île que les
Maltais ont baptisée du nom de grotte de Ca-
(I) A. A. Caruana. Recent discoveries at Nota-
bile. Mal ta, 1881; Report on the phoenician and
roman antiquities in the group of the islands of
Malia. Malta, 1882, avec un atlas de 37 photo-
graphies.
lypso. Confessons humblement que nous ne
connaissons rien des premiers habitants de
l'île; jusqu'à ce jour on ne saurait parler de
période préhistorique maltaise.
Vers l'an 1500 avant J.-C. Malle fut colo-
nisée par des Phéniciens venus probablement
de Tyr; et, malgré les peuples de races di-
verses qui occupèrent l'île tour à tour, le fond
de la population a conservé jusqu'à nos jours
des traces bien marqués de sa première ori-
gine. Vers l'an 700, des Grecs de Sicile, sans
doute des Syracusains, s'établirent à Malte et
y jetèrent les fondements de Melita qui devint
la capitale de l'île et maintint cette situation
privilégiée jusqu'au 18 mars 1571, jour au-
quel le Grand maître de l'Ordre Pietro del
Monte choisit La Valette pour capitale.
Les deux populations phénicienne et grec-
que vécurent côte à côte sans se fusionner;
mais l'élément sémitique continua à prédo-
miner : aussi S. Luc, racontant le naufrage de
S. Paul (Act. 28), appelle-t-il le habitants de
Malte des Rarbari, c'est-à-dire ni grecs ni ro-
mains. En 480, les Carthaginois enlevèrent
l'île aux Grecs de Sicile et en firent une station
militaire. Ils en restèrent les maîtres jusqu au
commencement de la seconde guerre punique.
En 216 (536 a. a.) le consul Ti. Sempronius
Longus s'en empara et fit prisonner Hamilcar,
fils de Gisgen, qui commandait à Malte une
garnison de près de deux mille hommes
(T. L. 21-51).
Les Maltais devinrent alors des alliés (Sociï)
du peuple romain. Sous l'empire Melita, ainsi
que Gaulos (Gozo) obtinrent même le droit de
municipe, peut-être sous le règne d'Hadrien.
Pendant toute la durée de l'occupation ro-
maine, Malte fit partie de la province de Si-
cile, ce qui permit àVerrès d'y faire de nom-
breuses rapines et de piller l'antique temple
de Junon, situé sur un promontoire peu éloi-
gné de la capitale et non moins célèbre que le
temple d'Hercule. 11 était tenu en un tel hon-
neur que tous les conquérants antérieurs aux
Romains l'avaient respecté (Cic. Verr II. IV.
46-J03).Cicéron décrit la situation de l'île avec
une grande précision ; mais la manière dont
il en parle semble indiquer que les Romains
la connaissaient bien peu et ne s'en occu-
paient guères. Maîtres de tout le bassin de la
Méditerannée, ils ne devaient en effet accorder
à Malte qu'une importance secondaire. Ils
auraient pu profiter de la situation de l'île
pour faire de là la guerre aux pirates qui in-
festaient la Méditerranée ; mais ils n'en eurent
nul souci. Les pirates prirent les devants et se
créèrent à Malte un refuge des plus sûrs. Mé-
lita et Gaulos étaient administrés par un pro-
curateur spécial. Un de ceux-ci nous est
connu. 11 s'appelait Chrestion, était probable-
ment un affranchi d'Auguste et fit reconstruire
le temple de Proserpine (C. I. L. X. 7494).—
Après les Romains Malte fut tour à tour aux
Vandales (454), aux Goths (494) et aux byzan-
tins. Bélisaire s'en empara en 533. En 870