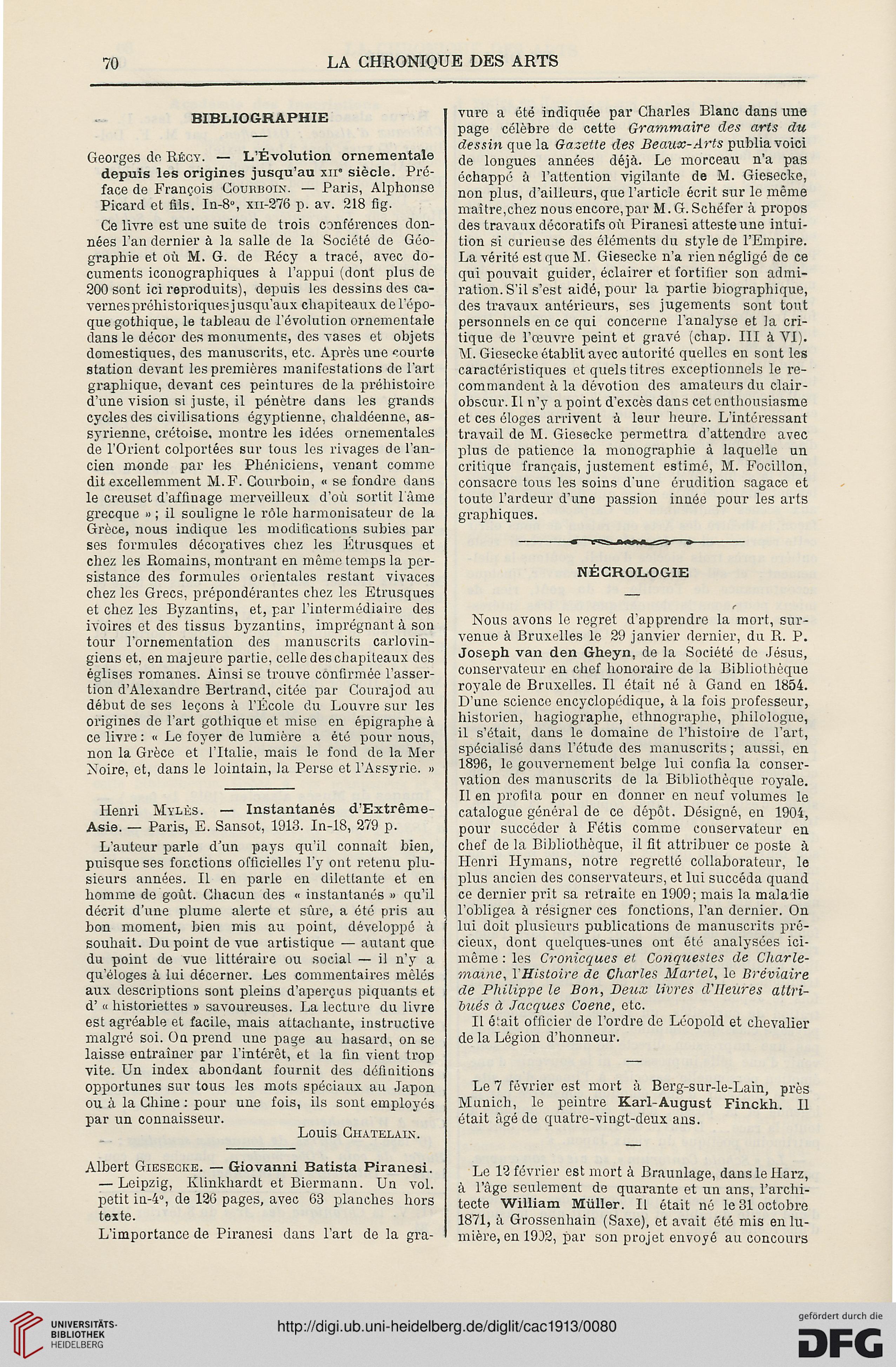70
LA CHRONIQUE DES ARTS
BIBLIOGRAPHIE
Georges dn Récy. — L'Évolution ornementale
depuis les origines jusqu'au xn° siècle. Pré-
face de François Courboix. — Paris, Alphonse
Picard et fils. In-8°, xn-276 p. av. 218 fig.
Ce livre est une suite de trois conférences don-
nées l'an dernier à la salle de la Société de Géo-
graphie et où M. G. de Récy a tracé, avec do-
cuments iconographiques à l'appui (dont plus de
200 sont ici reproduits), depuis les dessins des ca-
vernespréhistoriquesjusqu'aux chapiteaux de l'épo-
que gothique, le tableau de l'évolution ornementale
dans le décor des monuments, des vases et objets
domestiques, des manuscrits, etc. Après une courte
station devant les premières manifestations do l'art
graphique, devant ces peintures de la préhistoire
d'une vision si juste, il pénètre dans les grands
cycles des civilisations égyptienne, chaldéenne, as-
syrienne, crétoise. montre les idées ornementales
de l'Orient colportées sur tous les rivages de l'an-
cien monde par les Phéniciens, venant comme
dit excellemment M. F. Courboin, « se fondre dans
le creuset d'affinage merveilleux d'où sortit l'âme
grecque » ; il souligne le rôle harmonisateur de la
Grèce, nous indique les modifications subies par
ses formules décoratives chez les Étrusques et
chez les Romains, montrant en mémo temps la per-
sistance des formules orientales restant vivaces
chez les Grecs, prépondérantes chez les Etrusques
et chez les Byzantins, et, par l'intermédiaire des
ivoires et des tissus byzantins, imprégnant à son
tour l'ornementation des manuscrits carlovin-
giens et, en majeure partie, celle des chapiteaux des
églises romanes. Ainsi se trouve confirmée l'asser-
tion d'Alexandre Bertrand, citée par Courajod au
début de ses leçons à l'École du Louvre sur les
origines de l'art gothique et mise en épigraphe à
ce livre : « Le foyer de lumière a été pour nous,
non la Grèce et l'Italie, mais le fond do la Mer
Noire, et, dans le lointain, la Perse et l'Assyrie. »
Henri Mylès. — Instantanés d'Extrême-
Asie. — Paris, E. Sansot, 1913. In-18, 379 p.
L'auteur parle d'un pays qu'il connaît bien,
puisque ses fonctions officielles l'y ont retenu plu-
sieurs années. Il en parle en dilettante et en
homme de goût. Chacun des « instantanés » qu'il
décrit d'une plume alerte et sûre, a été pris au
bon moment, bien mis au point, développé à
souhait. Du point de vue artistique — autant que
du point de vue littéraire ou social — il n'y a
qu'éloges à lui décerner. Les commentaires mêlés
aux descriptions sont pleins d'aperçus piquants et
d'« historiettes » savoureuses. La lecture du livre
est agréable et facile, mais attachante, instructive
malgré soi. On prend une page au hasard, on se
laisse entraîner par l'intérêt, et la fin vient trop
vite. Un index abondant fournit des définitions
opportunes sur tous les mots spéciaux au Japon
ou à la Chine : pour une fois, ils sont employés
par un connaisseur.
Louis Châtelain.
Albert Giesecke. — Giovanni Batista Piranesi.
— Leipzig, Ktinkhardt et Biermann. Un vol.
petit in-4°, de 12G pages, avec 63 planches hors
texte.
L'importance de Piranesi dans l'art de la gra-
vure a été indiquée par Charles Blanc dans une
page célèbre de cette Grammaire des arts du
dessin que la Gazette des Beaux-Arts publia voici
de longues années déjà. Le morceau n'a pas
échappé à l'attention vigilante de M. Giesecke,
non plus, d'ailleurs, que l'article écrit sur le même
maître,chez nous encore,par M. G. Schéfer à propos
des travaux décoratifs où Piranesi atteste une intui-
tion si curieuse des éléments du style de l'Empire.
La vérité est que M. Giesecke n'a rien négligé de ce
qui pouvait guider, éclairer et fortifier son admi-
ration. S'il s'est aidé, pour la partie biographique,
des travaux antérieurs, ses jugements sont tout
personnels en ce qui concerne l'analyse et ]a cri-
tique de l'œuvre peint et gravé (chap. III à VI).
M. Giesecke établit avec autorité quelles en sont les
caractéristiques et quels titres exceptionnels le re-
commandent à la dévotion des amateurs du clair-
obscur. Il n'y a point d'excès dans cet enthousiasme
et ces éloges arrivent à leur heure. L'intéressant
travail de M. Giesecke permettra d'attendre avec
plus de patience la monographie à laquelle un
critique français, justement estimé, M. Focillon,
consacre tous les soins d'une érudition sagace et
toute l'ardeur d'une passion innée pour les arts
graphiques.
NÉCROLOGIE
Nous avons le regret d'apprendre la mort, sur-
venue à Bruxelles le 29 janvier dernier, du R. P.
Joseph van den Gheyn, de la Société de Jésus,
conservateur en chef honoraire de la Bibliothèque
royale de Bruxelles. Il était né à Gand en 1854.
D'une science encyclopédique, à la fois professeur,
historien, hagiographie, ethnographe, philologue,
il s'était, dans le domaine de l'histoire de l'art,
spécialisé dans l'étude des manuscrits ; aussi, en
1896, le gouvernement belge lui confia la conser-
vation des manuscrits de la Bibliothèque royale.
Il en profila pour en donner en neuf volumes le
catalogue général de ce dépôt. Désigné, en 1904,
pour succéder à Fétis comme conservateur en
chef de la Bibliothèque, il fit attribuer ce poste à
Henri Hymans, notre regretté collaborateur, le
plus ancien des conservateurs, et lui succéda quand
ce dernier prit sa retraite en 1909; mais la maladie
l'obligea à résigner ces fonctions, l'an dernier. On
lui doit plusieurs publications de manuscrits pré-
cieux, dont quelques-unes ont été analysées ici-
même : les Cronicques et Conquestes de Charle-
maine, YHistoire de Charles Martel, le Bréviaire
de Philippe le Bon, Deux livres d'Heures attri-
bués à Jacques Coene, etc.
Il était officier de l'ordre de Léopold et chevalier
de la Légion d'honneur.
Le 7 février est mort à Berg-sur-le-Lain, près
Munich, le peintre Karl-August Finckh. Il
était âgé de quatre-vingt-deux ans.
Le 12 février est mort à Braunlage, dansleHarz,
à l'âge seulement de quarante et un ans, l'archi-
tecte William Mûller. Il était né le 31 octobre
1871, à Grossenhain (Saxe), et avait été mis en lu-
mière, en 1932, par son projet envoyé au concours
LA CHRONIQUE DES ARTS
BIBLIOGRAPHIE
Georges dn Récy. — L'Évolution ornementale
depuis les origines jusqu'au xn° siècle. Pré-
face de François Courboix. — Paris, Alphonse
Picard et fils. In-8°, xn-276 p. av. 218 fig.
Ce livre est une suite de trois conférences don-
nées l'an dernier à la salle de la Société de Géo-
graphie et où M. G. de Récy a tracé, avec do-
cuments iconographiques à l'appui (dont plus de
200 sont ici reproduits), depuis les dessins des ca-
vernespréhistoriquesjusqu'aux chapiteaux de l'épo-
que gothique, le tableau de l'évolution ornementale
dans le décor des monuments, des vases et objets
domestiques, des manuscrits, etc. Après une courte
station devant les premières manifestations do l'art
graphique, devant ces peintures de la préhistoire
d'une vision si juste, il pénètre dans les grands
cycles des civilisations égyptienne, chaldéenne, as-
syrienne, crétoise. montre les idées ornementales
de l'Orient colportées sur tous les rivages de l'an-
cien monde par les Phéniciens, venant comme
dit excellemment M. F. Courboin, « se fondre dans
le creuset d'affinage merveilleux d'où sortit l'âme
grecque » ; il souligne le rôle harmonisateur de la
Grèce, nous indique les modifications subies par
ses formules décoratives chez les Étrusques et
chez les Romains, montrant en mémo temps la per-
sistance des formules orientales restant vivaces
chez les Grecs, prépondérantes chez les Etrusques
et chez les Byzantins, et, par l'intermédiaire des
ivoires et des tissus byzantins, imprégnant à son
tour l'ornementation des manuscrits carlovin-
giens et, en majeure partie, celle des chapiteaux des
églises romanes. Ainsi se trouve confirmée l'asser-
tion d'Alexandre Bertrand, citée par Courajod au
début de ses leçons à l'École du Louvre sur les
origines de l'art gothique et mise en épigraphe à
ce livre : « Le foyer de lumière a été pour nous,
non la Grèce et l'Italie, mais le fond do la Mer
Noire, et, dans le lointain, la Perse et l'Assyrie. »
Henri Mylès. — Instantanés d'Extrême-
Asie. — Paris, E. Sansot, 1913. In-18, 379 p.
L'auteur parle d'un pays qu'il connaît bien,
puisque ses fonctions officielles l'y ont retenu plu-
sieurs années. Il en parle en dilettante et en
homme de goût. Chacun des « instantanés » qu'il
décrit d'une plume alerte et sûre, a été pris au
bon moment, bien mis au point, développé à
souhait. Du point de vue artistique — autant que
du point de vue littéraire ou social — il n'y a
qu'éloges à lui décerner. Les commentaires mêlés
aux descriptions sont pleins d'aperçus piquants et
d'« historiettes » savoureuses. La lecture du livre
est agréable et facile, mais attachante, instructive
malgré soi. On prend une page au hasard, on se
laisse entraîner par l'intérêt, et la fin vient trop
vite. Un index abondant fournit des définitions
opportunes sur tous les mots spéciaux au Japon
ou à la Chine : pour une fois, ils sont employés
par un connaisseur.
Louis Châtelain.
Albert Giesecke. — Giovanni Batista Piranesi.
— Leipzig, Ktinkhardt et Biermann. Un vol.
petit in-4°, de 12G pages, avec 63 planches hors
texte.
L'importance de Piranesi dans l'art de la gra-
vure a été indiquée par Charles Blanc dans une
page célèbre de cette Grammaire des arts du
dessin que la Gazette des Beaux-Arts publia voici
de longues années déjà. Le morceau n'a pas
échappé à l'attention vigilante de M. Giesecke,
non plus, d'ailleurs, que l'article écrit sur le même
maître,chez nous encore,par M. G. Schéfer à propos
des travaux décoratifs où Piranesi atteste une intui-
tion si curieuse des éléments du style de l'Empire.
La vérité est que M. Giesecke n'a rien négligé de ce
qui pouvait guider, éclairer et fortifier son admi-
ration. S'il s'est aidé, pour la partie biographique,
des travaux antérieurs, ses jugements sont tout
personnels en ce qui concerne l'analyse et ]a cri-
tique de l'œuvre peint et gravé (chap. III à VI).
M. Giesecke établit avec autorité quelles en sont les
caractéristiques et quels titres exceptionnels le re-
commandent à la dévotion des amateurs du clair-
obscur. Il n'y a point d'excès dans cet enthousiasme
et ces éloges arrivent à leur heure. L'intéressant
travail de M. Giesecke permettra d'attendre avec
plus de patience la monographie à laquelle un
critique français, justement estimé, M. Focillon,
consacre tous les soins d'une érudition sagace et
toute l'ardeur d'une passion innée pour les arts
graphiques.
NÉCROLOGIE
Nous avons le regret d'apprendre la mort, sur-
venue à Bruxelles le 29 janvier dernier, du R. P.
Joseph van den Gheyn, de la Société de Jésus,
conservateur en chef honoraire de la Bibliothèque
royale de Bruxelles. Il était né à Gand en 1854.
D'une science encyclopédique, à la fois professeur,
historien, hagiographie, ethnographe, philologue,
il s'était, dans le domaine de l'histoire de l'art,
spécialisé dans l'étude des manuscrits ; aussi, en
1896, le gouvernement belge lui confia la conser-
vation des manuscrits de la Bibliothèque royale.
Il en profila pour en donner en neuf volumes le
catalogue général de ce dépôt. Désigné, en 1904,
pour succéder à Fétis comme conservateur en
chef de la Bibliothèque, il fit attribuer ce poste à
Henri Hymans, notre regretté collaborateur, le
plus ancien des conservateurs, et lui succéda quand
ce dernier prit sa retraite en 1909; mais la maladie
l'obligea à résigner ces fonctions, l'an dernier. On
lui doit plusieurs publications de manuscrits pré-
cieux, dont quelques-unes ont été analysées ici-
même : les Cronicques et Conquestes de Charle-
maine, YHistoire de Charles Martel, le Bréviaire
de Philippe le Bon, Deux livres d'Heures attri-
bués à Jacques Coene, etc.
Il était officier de l'ordre de Léopold et chevalier
de la Légion d'honneur.
Le 7 février est mort à Berg-sur-le-Lain, près
Munich, le peintre Karl-August Finckh. Il
était âgé de quatre-vingt-deux ans.
Le 12 février est mort à Braunlage, dansleHarz,
à l'âge seulement de quarante et un ans, l'archi-
tecte William Mûller. Il était né le 31 octobre
1871, à Grossenhain (Saxe), et avait été mis en lu-
mière, en 1932, par son projet envoyé au concours