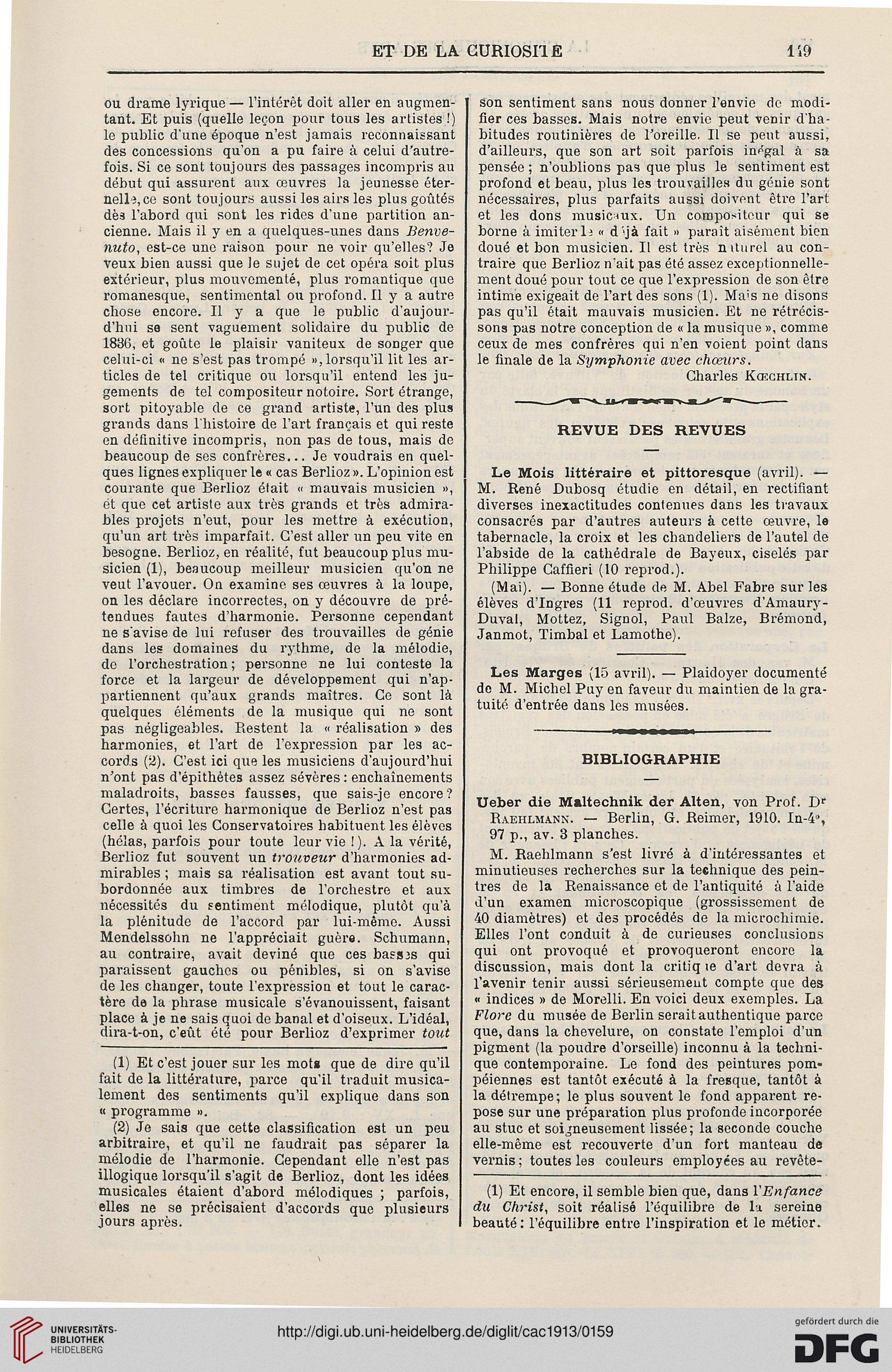ET DE LA
ou drame lyrique — l'intérêt doit aller en augmen-
tant. Et puis (quelle leçon pour tous les artistes !)
le public d'une époque n'est jamais reconnaissant
des concessions qu'on a pu faire à celui d'autre-
fois. Si ce sont toujours des passages incompris au
début qui assurent aux œuvres la jeunesse éter-
nelle, ce sont toujours aussi les airs les plus goûtés
dès l'abord qui sont les rides d'une partition an-
cienne. Mais il y en a quelques-unes dans Benve-
nuto, est-ce une raison pour ne voir qu'elles? Je
veux bien aussi que le sujet de cet opéra soit plus
extérieur, plus mouvementé, plus romantique que
romanesque, sentimental ou profond. Il y a autre
chose encore. Il y a que le public d'aujour-
d'hui se sent vaguement solidaire du public de
183G, et goûte le plaisir vaniteux de songer que
celui-ci « ne s'est pas trompé », lorsqu'il lit les ar-
ticles de tel critique ou lorsqu'il entend les ju-
gements de tel compositeur notoire. Sort étrange,
sort pitoyable de ce grand artiste, l'un des plus
grands dans l'histoire de l'art français et qui reste
on définitive incompris, non pas de tous, mais de
beaucoup de ses confrères... Je voudrais en quel-
ques lignes expliquer le « cas Berlioz ». L'opinion est
courante que Berlioz était « mauvais musicien »,
ët que cet artiste aux très grands et très admira-
bles projets n'eut, pour les mettre à exécution,
qu'un art très imparfait. C'est aller un peu vite en
besogne. Berlioz, en réalité, fut beaucoup plus mu-
sicien (1), beaucoup meilleur musicien qu'on ne
veut l'avouer. On examine ses œuvres à la loupe,
on les déclare incorrectes, on y découvre de pré-
tendues fautes d'harmonie. Personne cependant
ne s'avise de lui refuser des trouvailles de génie
dans les domaines du rythme, do la mélodie,
de l'orchestration ; personne ne lui conteste la
force et la largeur de développement qui n'ap-
partiennent qu'aux grands maîtres. Ce sont là
quelques éléments de la musique qui ne sont
pas négligeables. Bestent la « réalisation » des
harmonies, et l'art de l'expression par les ac-
cords (2). C'est ici que les musiciens d'aujourd'hui
n'ont pas d'épithétes assez sévères : enchaînements
maladroits, basses fausses, que sais-je encore?
Certes, l'écriture harmonique de Berlioz n'est pas
celle à quoi les Conservatoires habituent les élèves
(hélas, parfois pour toute leur vie 1). A la vérité,
Berlioz fut souvent un trouveur d'harmonies ad-
mirables ; mais sa réalisation est avant tout su-
bordonnée aux timbres de l'orchestre et aux
nécessités du sentiment mélodique, plutôt qu'à
la plénitude de l'accord par lui-même. Aussi
Mendelssohn ne l'appréciait guère. Schumann,
au contraire, avait deviné que ces bassjs qui
paraissent gauches ou pénibles, si on s'avise
de les changer, toute l'expression et tout le carac-
tère de la phrase musicale s'évanouissent, faisant
place à je ne sais quoi de banal et d'oiseux. L'idéal,
dira-t-on, c'eût été pour Berlioz d'exprimer tout
(1) Et c'est jouer sur les mot» que de dire qu'il
fait de la littérature, parce qu'il traduit musica-
lement des sentiments qu'il explique dans son
« programme ».
(2) Je sais que cette classification est un peu
arbitraire, et qu'il ne faudrait pas séparer la
mélodie de l'harmonie. Cependant elle n'est pas
illogique lorsqu'il s'agit de Berlioz, dont les idées
musicales étaient d'abord mélodiques ; parfois,
elles ne se précisaient d'accords que plusieurs
jours après.
GURIOSI1E 119
son sentiment sans nous donner l'envie de modi-
fier ces basses. Mais notre envie peut venir d'ha-
bitudes routinières de l'oreille. Il se peut aussi,
d'ailleurs, que son art soit parfois inégal à sa
pensée ; n'oublions pas que plus le sentiment est
profond et beau, plus les trouvailles du géuie sont
nécessaires, plus parfaits aussi doivent être l'art
et les dons musicaux. Un compositeur qui se
borne à imiter 1j « d'jà fait » paraît aisément bien
doué et bon musicien. Il est très niturel au con-
traire que Berlioz n'ait pas été assez exceptionnelle-
ment doué pour tout ce que l'expression de son être
intime exigeait de l'art des sons (l). Ma;s ne disons
pas qu'il était mauvais musicien. Et ne rétrécis-
sons pas notre conception de « la musique », comme
ceux de mes confrères qui n'en voient point dans
le finale de la Symphonie avec chœurs.
Charles Kœghlin.
REVUE DES REVUES
Le Mois littéraire et pittoresque (avril). —
M. René Dubosq étudie en détail, en rectifiant
diverses inexactitudes contenues dans les travaux
consacrés par d'autres auteurs à cette œuvre, le
tabernacle, la croix et les chandeliers de l'autel de
l'abside de la cathédrale de Bayeux, ciselés par
Philippe Caffieri (10 reprod.).
(Mai). — Bonne étude de M. Abel Fabre sur les
élèves d'Ingres (11 reprod. d'œuvres d'Amaury-
Duval, Mottez, Signol, Paul Balze, Bréffiond,
Janmot, Timbal et Lamothe).
Les Marges (15 avril). — Plaidoyer documenté
de M. Michel Puy en faveur du maintien de la gra-
tuité d'entrée dans les musées.
BIBLIOGRAPHIE
Ueber die Maltechnik der AHen, von Prof. Dr
Baehlmann. — Berlin, G. Beimer, 1910. In-4°,
97 p., av. 3 planches.
M. Raehlmann s'est livré à d'intéressantes et
minutieuses recherches sur la technique des pein-
tres de la Benaissance et de l'antiquité à l'aide
d'un examen microscopique (grossissement de
40 diamètres) et des procédés de la microchimie.
Elles l'ont conduit à de curieuses conclusions
qui ont provoqué et provoqueront encore la
discussion, mais dont la critiq îe d'art devra à
l'avenir tenir aussi sérieusement compte que des
« indices » de Morelli. En voici deux exemples. La
Flore du musée de Berlin serait authentique parce
que, dans la chevelure, on constate l'emploi d'un
pigment (la poudre d'orseille) inconnu à la techni-
que contemporaine. Le fond des peintures pom-
péiennes est tantôt exécuté à la fresque, tantôt à
la délrempe; le plus souvent le fond apparent re-
pose sur une préparation plus profonde incorporée
au stuc et soigneusement lissée; la seconde couche
elle-même est recouverte d'un fort manteau de
vernis ; toutes les couleurs employées au revête-
(1) Et encore, il semble bien que, dans l'Enfance
du Christ, soit réalisé l'équilibre de la sereine
beauté : l'équilibre entre l'inspiration et le métier.
ou drame lyrique — l'intérêt doit aller en augmen-
tant. Et puis (quelle leçon pour tous les artistes !)
le public d'une époque n'est jamais reconnaissant
des concessions qu'on a pu faire à celui d'autre-
fois. Si ce sont toujours des passages incompris au
début qui assurent aux œuvres la jeunesse éter-
nelle, ce sont toujours aussi les airs les plus goûtés
dès l'abord qui sont les rides d'une partition an-
cienne. Mais il y en a quelques-unes dans Benve-
nuto, est-ce une raison pour ne voir qu'elles? Je
veux bien aussi que le sujet de cet opéra soit plus
extérieur, plus mouvementé, plus romantique que
romanesque, sentimental ou profond. Il y a autre
chose encore. Il y a que le public d'aujour-
d'hui se sent vaguement solidaire du public de
183G, et goûte le plaisir vaniteux de songer que
celui-ci « ne s'est pas trompé », lorsqu'il lit les ar-
ticles de tel critique ou lorsqu'il entend les ju-
gements de tel compositeur notoire. Sort étrange,
sort pitoyable de ce grand artiste, l'un des plus
grands dans l'histoire de l'art français et qui reste
on définitive incompris, non pas de tous, mais de
beaucoup de ses confrères... Je voudrais en quel-
ques lignes expliquer le « cas Berlioz ». L'opinion est
courante que Berlioz était « mauvais musicien »,
ët que cet artiste aux très grands et très admira-
bles projets n'eut, pour les mettre à exécution,
qu'un art très imparfait. C'est aller un peu vite en
besogne. Berlioz, en réalité, fut beaucoup plus mu-
sicien (1), beaucoup meilleur musicien qu'on ne
veut l'avouer. On examine ses œuvres à la loupe,
on les déclare incorrectes, on y découvre de pré-
tendues fautes d'harmonie. Personne cependant
ne s'avise de lui refuser des trouvailles de génie
dans les domaines du rythme, do la mélodie,
de l'orchestration ; personne ne lui conteste la
force et la largeur de développement qui n'ap-
partiennent qu'aux grands maîtres. Ce sont là
quelques éléments de la musique qui ne sont
pas négligeables. Bestent la « réalisation » des
harmonies, et l'art de l'expression par les ac-
cords (2). C'est ici que les musiciens d'aujourd'hui
n'ont pas d'épithétes assez sévères : enchaînements
maladroits, basses fausses, que sais-je encore?
Certes, l'écriture harmonique de Berlioz n'est pas
celle à quoi les Conservatoires habituent les élèves
(hélas, parfois pour toute leur vie 1). A la vérité,
Berlioz fut souvent un trouveur d'harmonies ad-
mirables ; mais sa réalisation est avant tout su-
bordonnée aux timbres de l'orchestre et aux
nécessités du sentiment mélodique, plutôt qu'à
la plénitude de l'accord par lui-même. Aussi
Mendelssohn ne l'appréciait guère. Schumann,
au contraire, avait deviné que ces bassjs qui
paraissent gauches ou pénibles, si on s'avise
de les changer, toute l'expression et tout le carac-
tère de la phrase musicale s'évanouissent, faisant
place à je ne sais quoi de banal et d'oiseux. L'idéal,
dira-t-on, c'eût été pour Berlioz d'exprimer tout
(1) Et c'est jouer sur les mot» que de dire qu'il
fait de la littérature, parce qu'il traduit musica-
lement des sentiments qu'il explique dans son
« programme ».
(2) Je sais que cette classification est un peu
arbitraire, et qu'il ne faudrait pas séparer la
mélodie de l'harmonie. Cependant elle n'est pas
illogique lorsqu'il s'agit de Berlioz, dont les idées
musicales étaient d'abord mélodiques ; parfois,
elles ne se précisaient d'accords que plusieurs
jours après.
GURIOSI1E 119
son sentiment sans nous donner l'envie de modi-
fier ces basses. Mais notre envie peut venir d'ha-
bitudes routinières de l'oreille. Il se peut aussi,
d'ailleurs, que son art soit parfois inégal à sa
pensée ; n'oublions pas que plus le sentiment est
profond et beau, plus les trouvailles du géuie sont
nécessaires, plus parfaits aussi doivent être l'art
et les dons musicaux. Un compositeur qui se
borne à imiter 1j « d'jà fait » paraît aisément bien
doué et bon musicien. Il est très niturel au con-
traire que Berlioz n'ait pas été assez exceptionnelle-
ment doué pour tout ce que l'expression de son être
intime exigeait de l'art des sons (l). Ma;s ne disons
pas qu'il était mauvais musicien. Et ne rétrécis-
sons pas notre conception de « la musique », comme
ceux de mes confrères qui n'en voient point dans
le finale de la Symphonie avec chœurs.
Charles Kœghlin.
REVUE DES REVUES
Le Mois littéraire et pittoresque (avril). —
M. René Dubosq étudie en détail, en rectifiant
diverses inexactitudes contenues dans les travaux
consacrés par d'autres auteurs à cette œuvre, le
tabernacle, la croix et les chandeliers de l'autel de
l'abside de la cathédrale de Bayeux, ciselés par
Philippe Caffieri (10 reprod.).
(Mai). — Bonne étude de M. Abel Fabre sur les
élèves d'Ingres (11 reprod. d'œuvres d'Amaury-
Duval, Mottez, Signol, Paul Balze, Bréffiond,
Janmot, Timbal et Lamothe).
Les Marges (15 avril). — Plaidoyer documenté
de M. Michel Puy en faveur du maintien de la gra-
tuité d'entrée dans les musées.
BIBLIOGRAPHIE
Ueber die Maltechnik der AHen, von Prof. Dr
Baehlmann. — Berlin, G. Beimer, 1910. In-4°,
97 p., av. 3 planches.
M. Raehlmann s'est livré à d'intéressantes et
minutieuses recherches sur la technique des pein-
tres de la Benaissance et de l'antiquité à l'aide
d'un examen microscopique (grossissement de
40 diamètres) et des procédés de la microchimie.
Elles l'ont conduit à de curieuses conclusions
qui ont provoqué et provoqueront encore la
discussion, mais dont la critiq îe d'art devra à
l'avenir tenir aussi sérieusement compte que des
« indices » de Morelli. En voici deux exemples. La
Flore du musée de Berlin serait authentique parce
que, dans la chevelure, on constate l'emploi d'un
pigment (la poudre d'orseille) inconnu à la techni-
que contemporaine. Le fond des peintures pom-
péiennes est tantôt exécuté à la fresque, tantôt à
la délrempe; le plus souvent le fond apparent re-
pose sur une préparation plus profonde incorporée
au stuc et soigneusement lissée; la seconde couche
elle-même est recouverte d'un fort manteau de
vernis ; toutes les couleurs employées au revête-
(1) Et encore, il semble bien que, dans l'Enfance
du Christ, soit réalisé l'équilibre de la sereine
beauté : l'équilibre entre l'inspiration et le métier.