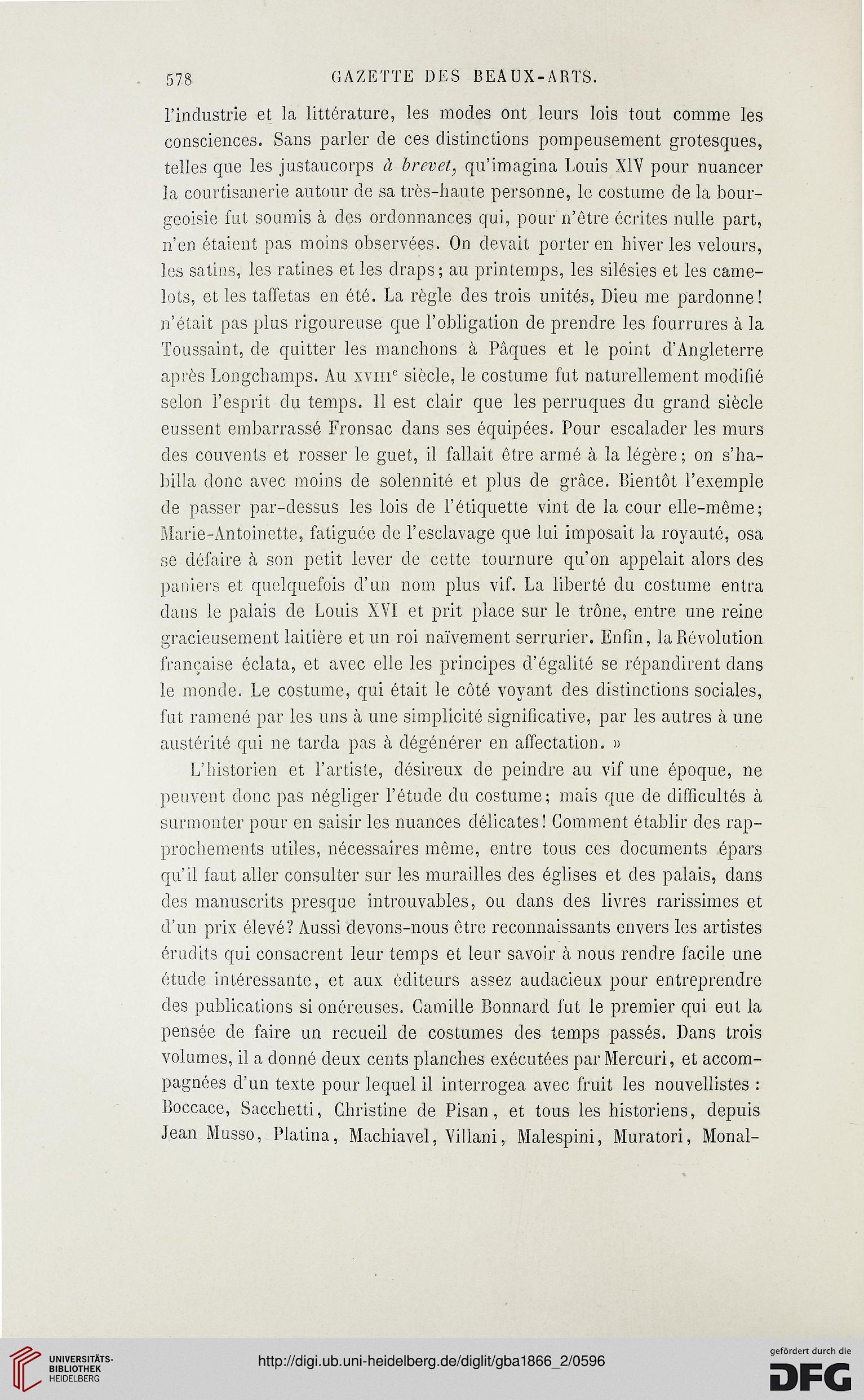578
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
l’industrie et la littérature, les modes ont leurs lois tout comme les
consciences. Sans parler de ces distinctions pompeusement grotesques,
telles que les justaucorps à brevet, qu’imagina Louis X1Y pour nuancer
la courtisanerie autour de sa très-haute personne, le costume de la bour-
geoisie fut soumis à des ordonnances qui, pour n’être écrites nulle part,
n’en étaient pas moins observées. On devait porter en hiver les velours,
les satins, les ratines et les draps; au printemps, les silésies et les came-
lots, et les taffetas en été. La règle des trois unités, Dieu me pardonne!
n’était pas plus rigoureuse que l’obligation de prendre les fourrures à la
Toussaint, de quitter les manchons à Pâques et le point d’Angleterre
après Longcbamps. Au xvine siècle, le costume fut naturellement modifié
selon l’esprit du temps. 11 est clair que les perruques du grand siècle
eussent embarrassé Fronsac dans ses équipées. Pour escalader les murs
des couvents et rosser le guet, il fallait être armé à la légère ; on s’ha-
billa donc avec moins de solennité et plus de grâce. Bientôt l’exemple
de passer par-dessus les lois de l’étiquette vint de la cour elle-même;
Marie-Antoinette, fatiguée de l’esclavage que lui imposait la royauté, osa
se défaire à son petit lever de cette tournure qu’on appelait alors des
paniers et quelquefois d’un nom plus vif. La liberté du costume entra
dans le palais de Louis XVI et prit place sur le trône, entre une reine
gracieusement laitière et un roi naïvement serrurier. Enfin, la Révolution
française éclata, et avec elle les principes d’égalité se répandirent dans
le monde. Le costume, qui était le côté voyant des distinctions sociales,
fut ramené par les uns à une simplicité significative, par les autres à une
austérité qui ne tarda pas à dégénérer en affectation. »
L’historien et l’artiste, désireux de peindre au vif une époque, 11e
peuvent donc pas négliger l’étude du costume; mais que de difficultés à
surmonter pour en saisir les nuances délicates! Gomment établir des rap-
prochements utiles, nécessaires même, entre tous ces documents épars
qu’il faut aller consulter sur les murailles des églises et des palais, dans
des manuscrits presque introuvables, ou dans des livres rarissimes et
d’un prix élevé? Aussi devons-nous être reconnaissants envers les artistes
érudits qui consacrent leur temps et leur savoir à nous rendre facile une
étude intéressante, et aux éditeurs assez audacieux pour entreprendre
des publications si onéreuses. Camille Bonnard fut le premier qui eut la
pensée de faire un recueil de costumes des temps passés. Dans trois
volumes, il a donné deux cents planches exécutées par Mercuri, et accom-
pagnées d’un texte pour lequel il interrogea avec fruit les nouvellistes :
Boccace, Sacchetti, Christine de Pisan, et tous les historiens, depuis
Jean Musso, Platina, Machiavel, Yillani, Malespini, Muratori, Monal-
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
l’industrie et la littérature, les modes ont leurs lois tout comme les
consciences. Sans parler de ces distinctions pompeusement grotesques,
telles que les justaucorps à brevet, qu’imagina Louis X1Y pour nuancer
la courtisanerie autour de sa très-haute personne, le costume de la bour-
geoisie fut soumis à des ordonnances qui, pour n’être écrites nulle part,
n’en étaient pas moins observées. On devait porter en hiver les velours,
les satins, les ratines et les draps; au printemps, les silésies et les came-
lots, et les taffetas en été. La règle des trois unités, Dieu me pardonne!
n’était pas plus rigoureuse que l’obligation de prendre les fourrures à la
Toussaint, de quitter les manchons à Pâques et le point d’Angleterre
après Longcbamps. Au xvine siècle, le costume fut naturellement modifié
selon l’esprit du temps. 11 est clair que les perruques du grand siècle
eussent embarrassé Fronsac dans ses équipées. Pour escalader les murs
des couvents et rosser le guet, il fallait être armé à la légère ; on s’ha-
billa donc avec moins de solennité et plus de grâce. Bientôt l’exemple
de passer par-dessus les lois de l’étiquette vint de la cour elle-même;
Marie-Antoinette, fatiguée de l’esclavage que lui imposait la royauté, osa
se défaire à son petit lever de cette tournure qu’on appelait alors des
paniers et quelquefois d’un nom plus vif. La liberté du costume entra
dans le palais de Louis XVI et prit place sur le trône, entre une reine
gracieusement laitière et un roi naïvement serrurier. Enfin, la Révolution
française éclata, et avec elle les principes d’égalité se répandirent dans
le monde. Le costume, qui était le côté voyant des distinctions sociales,
fut ramené par les uns à une simplicité significative, par les autres à une
austérité qui ne tarda pas à dégénérer en affectation. »
L’historien et l’artiste, désireux de peindre au vif une époque, 11e
peuvent donc pas négliger l’étude du costume; mais que de difficultés à
surmonter pour en saisir les nuances délicates! Gomment établir des rap-
prochements utiles, nécessaires même, entre tous ces documents épars
qu’il faut aller consulter sur les murailles des églises et des palais, dans
des manuscrits presque introuvables, ou dans des livres rarissimes et
d’un prix élevé? Aussi devons-nous être reconnaissants envers les artistes
érudits qui consacrent leur temps et leur savoir à nous rendre facile une
étude intéressante, et aux éditeurs assez audacieux pour entreprendre
des publications si onéreuses. Camille Bonnard fut le premier qui eut la
pensée de faire un recueil de costumes des temps passés. Dans trois
volumes, il a donné deux cents planches exécutées par Mercuri, et accom-
pagnées d’un texte pour lequel il interrogea avec fruit les nouvellistes :
Boccace, Sacchetti, Christine de Pisan, et tous les historiens, depuis
Jean Musso, Platina, Machiavel, Yillani, Malespini, Muratori, Monal-