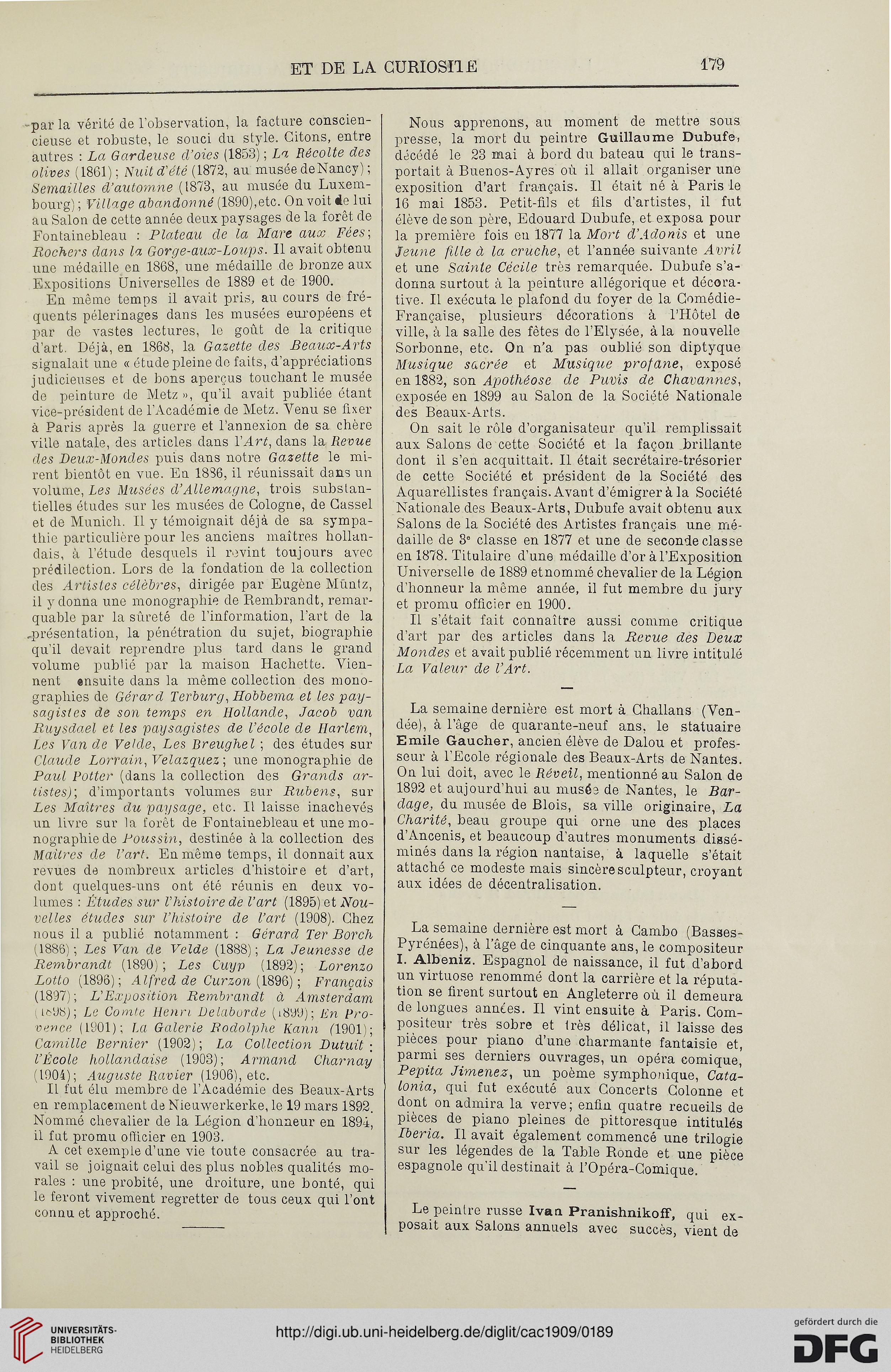ET DE LA CURI0SI1E
179
-parla vérité de l’observation, la facture conscien-
cieuse et robuste, le souci du style. Citons, entre
autres : La Gardeuse d’oics (1853) ; La Récolte des
olives (1861); Nuit d'été (1872, au musée de Nancy ) ;
Semailles d’automne (1873, au musée du Luxem-
bourg) ; Village abandonné (1890),etc. On voit 4e lui
au Salon de cette année deux paysages de la forêt de
Fontainebleau : Plateau de la Mare aux Fées;
Rochers dans la Gorge-aux-Loups. Il avait obtenu
une médaille en 1868, une médaille de bronze aux
Expositions Universelles de 1889 et de 1900.
En même temps il avait pris, au cours de fré-
quents pèlerinages dans les musées européens et
par de vastes lectures, le goût de la critique
d’art. Déjà, en 1868, la Gazette des Beaux-Arts
signalait une « étude pleine de faits, d’appréciations
judicieuses et de bons aperçus touchant le musée
de peinture de Metz », qu’il avait publiée étant
vice-président de l’Académie de Metz. Venu se fixer
à Paris après la guerre et l’annexion de sa chère
ville natale, des articles dans Y Art, dans la Revue
des Deux-Mondes puis dans notre Gazette le mi-
rent bientôt en vue. En 1886, il réunissait dans un
volume, Les Musées d’Allemagne, trois substan-
tielles études sur les musées de Cologne, de Cassel
et de Munich. Il y témoignait déjà de sa sympa-
thie particulière pour les anciens maîtres hollan-
dais, à l’étude desquels il revint toujours avec
prédilection. Lors de la fondation de la collection
des Artistes célèbres, dirigée par Eugène Müntz,
il y donna une monographie de Rembrandt, remar-
quable par la sûreté de l’information, l’art de la
^présentation, la pénétration du sujet, biographie
qu’il devait reprendre plus tard dans le grand
volume publié par la maison Hachette. Vien-
nent ensuite dans la même collection des mono-
graphies de Gérard Terburg, Hobbema et les pay-
sagistes de son temps en Hollande, Jacob van
Ruysdael et les paysagistes de l’école de Harlem,
Les Van de Velde, Les Breughel ; des études sur
Claude Lorrain, Velâzquez-, une monographie de
Paul Potter (dans la collection des Grands ar-
tistes)] d’importants volumes sur Rubens, sur
Les Maîtres du paysage, etc. Il laisse inachevés
un livre sur la forêt de Fontainebleau et une mo-
nographie de Poussin, destinée à la collection des
Maîtres de l’art. En même temps, il donnait aux
revues de nombreux articles d’histoire et d’art,
dont quelques-uns ont été réunis en deux vo-
lumes : Études sur l’histoire de l’art (1895) et Nou-
velles études sur l’histoire de l’art (1908). Chez
nous il a publié notamment : Gérard Ter Borch
(1886); Les Van de Velde (1888); La Jeunesse de
Rembrandt (1890); Les Cuyp (1892); Lorenzo
Lotto (1896); A Ifred de Curzon (1896) ; Français
(1897); L'Exposition Rembrandt à Amsterdam
;io98); Le Comte Henri Delaborde (i89ü); En Pro-
vence (L901); La Galerie Rodolphe Kami (190L;
Camille Bernier (1902); La Collection Dutuit :
l’École hollandaise (1903); Armand Charnay
(1904); Auguste Ravier (1906), etc.
Il fut élu membre de l’Académie des Beaux-Arts
en remplacement de Nieuwerkerke, le 19 mars 1892.
Nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1894,
il fut promu officier en 1903.
A cet exemple d’une vie toute consacrée au tra-
vail se joignait celui des plus nobles qualités mo-
rales : une probité, une droiture, une bonté, qui
le feront vivement regretter de tous ceux qui l’ont
connu et approché.
Nous apprenons, au moment de mettre sous
presse, la mort du peintre Guillaume Dubufe,
décédé le 23 mai à bord du bateau qui le trans-
portait à Buenos-Ayres où il allait organiser une
exposition d’art français. Il était né à Paris le
16 mai 1853. Petit-fils et fils d’artistes, il fut
élève de son père, Edouard Dubufe, et exposa pour
la première fois eu 1877 la Mort d’Adonis et une
Jeune fille à la cruche, et l’année suivante Avril
et une Sainte Cécile très remarquée. Dubufe s’a-
donna surtout à la peinture allégorique et décora-
tive. Il exécuta le plafond du foyer de la Comédie-
Française, plusieurs décorations à l’Hôtel de
ville, à la salle des fêtes de l’Elysée, à la nouvelle
Sorbonne, etc. On n’a pas oublié son diptyque
Musique sacrée et Musique profane, exposé
en 1882, son Apothéose de Puvis de Chavannes,
exposée en 1899 au Salon de la Société Nationale
des Beaux-Arts.
On sait le rôle d’organisateur qu’il remplissait
aux Salons de cette Société et la façon brillante
dont il s’en acquittait. Il était secrétaire-trésorier
de cette Société et président de la Société des
Aquarellistes français. Avant d’émigrer à la Société
Nationale des Beaux-Arts, Dubufe avait obtenu aux
Salons de la Société des Artistes français une mé-
daille de 3e classe en 1877 et une de seconde classe
en 1878. Titulaire d’une médaille d’or à l’Exposition
Universelle de 1889 etnommé chevalier de la Légion
d’honneur la même année, il fut membre du jury
et promu officier en 1900.
Il s’était fait connaître aussi comme critique
d’art par des articles dans la Revue des Deux
Mondes et avait publié récemment un livre intitulé
La Valeur de l’Art.
La semaine dernière est mort à Challans (Ven-
dée), à l’âge de quarante-neuf ans, le statuaire
Emile Gaucher, ancien élève de Dalou et profes-
seur à l’Ecole régionale des Beaux-Arts de Nantes.
On lui doit, avec le Réveil, mentionné au Salon de
1892 et aujourd’hui au musée de Nantes, le Bar-
dage, du musée de Blois, sa ville originaire, La
Charité,, beau groupe qui orne une des places
d’Ancenis, et beaucoup d’autres monuments dissé-
minés dans la région nantaise, à laquelle s’était
attaché ce modeste mais sincère sculpteur, croyant
aux idées de décentralisation.
La semaine dernière est mort à Garnbo (Basses-
Pyrénées), à l’âge de cinquante ans, le compositeur
I. Albeniz. Espagnol de naissance, il fut d’abord
un virtuose renommé dont la carrière et la réputa-
tion se firent surtout en Angleterre où il demeura
de longues années. Il vint ensuite à Paris. Com-
positeur très sobre et Irès délicat, il laisse des
pièces pour piano d’une charmante fantaisie et,
parmi ses derniers ouvrages, un opéra comique,'
Pépita Jimenez, un poème symphonique, Cata-
lonia, qui fut exécuté aux Concerts Colonne et
dont on admira la verve; enfin quatre recueils de
pièces de piano pleines de pittoresque intitulés
Lberia. Il avait également commencé une trilogie
sur les légendes de la Table Ronde et une pièce
espagnole qu’il destinait à l’Opéra-Comique.
Le peintre russe Ivan PranishnikofF, qui ex-
posait aux Salons annuels avec succès, vient de
179
-parla vérité de l’observation, la facture conscien-
cieuse et robuste, le souci du style. Citons, entre
autres : La Gardeuse d’oics (1853) ; La Récolte des
olives (1861); Nuit d'été (1872, au musée de Nancy ) ;
Semailles d’automne (1873, au musée du Luxem-
bourg) ; Village abandonné (1890),etc. On voit 4e lui
au Salon de cette année deux paysages de la forêt de
Fontainebleau : Plateau de la Mare aux Fées;
Rochers dans la Gorge-aux-Loups. Il avait obtenu
une médaille en 1868, une médaille de bronze aux
Expositions Universelles de 1889 et de 1900.
En même temps il avait pris, au cours de fré-
quents pèlerinages dans les musées européens et
par de vastes lectures, le goût de la critique
d’art. Déjà, en 1868, la Gazette des Beaux-Arts
signalait une « étude pleine de faits, d’appréciations
judicieuses et de bons aperçus touchant le musée
de peinture de Metz », qu’il avait publiée étant
vice-président de l’Académie de Metz. Venu se fixer
à Paris après la guerre et l’annexion de sa chère
ville natale, des articles dans Y Art, dans la Revue
des Deux-Mondes puis dans notre Gazette le mi-
rent bientôt en vue. En 1886, il réunissait dans un
volume, Les Musées d’Allemagne, trois substan-
tielles études sur les musées de Cologne, de Cassel
et de Munich. Il y témoignait déjà de sa sympa-
thie particulière pour les anciens maîtres hollan-
dais, à l’étude desquels il revint toujours avec
prédilection. Lors de la fondation de la collection
des Artistes célèbres, dirigée par Eugène Müntz,
il y donna une monographie de Rembrandt, remar-
quable par la sûreté de l’information, l’art de la
^présentation, la pénétration du sujet, biographie
qu’il devait reprendre plus tard dans le grand
volume publié par la maison Hachette. Vien-
nent ensuite dans la même collection des mono-
graphies de Gérard Terburg, Hobbema et les pay-
sagistes de son temps en Hollande, Jacob van
Ruysdael et les paysagistes de l’école de Harlem,
Les Van de Velde, Les Breughel ; des études sur
Claude Lorrain, Velâzquez-, une monographie de
Paul Potter (dans la collection des Grands ar-
tistes)] d’importants volumes sur Rubens, sur
Les Maîtres du paysage, etc. Il laisse inachevés
un livre sur la forêt de Fontainebleau et une mo-
nographie de Poussin, destinée à la collection des
Maîtres de l’art. En même temps, il donnait aux
revues de nombreux articles d’histoire et d’art,
dont quelques-uns ont été réunis en deux vo-
lumes : Études sur l’histoire de l’art (1895) et Nou-
velles études sur l’histoire de l’art (1908). Chez
nous il a publié notamment : Gérard Ter Borch
(1886); Les Van de Velde (1888); La Jeunesse de
Rembrandt (1890); Les Cuyp (1892); Lorenzo
Lotto (1896); A Ifred de Curzon (1896) ; Français
(1897); L'Exposition Rembrandt à Amsterdam
;io98); Le Comte Henri Delaborde (i89ü); En Pro-
vence (L901); La Galerie Rodolphe Kami (190L;
Camille Bernier (1902); La Collection Dutuit :
l’École hollandaise (1903); Armand Charnay
(1904); Auguste Ravier (1906), etc.
Il fut élu membre de l’Académie des Beaux-Arts
en remplacement de Nieuwerkerke, le 19 mars 1892.
Nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1894,
il fut promu officier en 1903.
A cet exemple d’une vie toute consacrée au tra-
vail se joignait celui des plus nobles qualités mo-
rales : une probité, une droiture, une bonté, qui
le feront vivement regretter de tous ceux qui l’ont
connu et approché.
Nous apprenons, au moment de mettre sous
presse, la mort du peintre Guillaume Dubufe,
décédé le 23 mai à bord du bateau qui le trans-
portait à Buenos-Ayres où il allait organiser une
exposition d’art français. Il était né à Paris le
16 mai 1853. Petit-fils et fils d’artistes, il fut
élève de son père, Edouard Dubufe, et exposa pour
la première fois eu 1877 la Mort d’Adonis et une
Jeune fille à la cruche, et l’année suivante Avril
et une Sainte Cécile très remarquée. Dubufe s’a-
donna surtout à la peinture allégorique et décora-
tive. Il exécuta le plafond du foyer de la Comédie-
Française, plusieurs décorations à l’Hôtel de
ville, à la salle des fêtes de l’Elysée, à la nouvelle
Sorbonne, etc. On n’a pas oublié son diptyque
Musique sacrée et Musique profane, exposé
en 1882, son Apothéose de Puvis de Chavannes,
exposée en 1899 au Salon de la Société Nationale
des Beaux-Arts.
On sait le rôle d’organisateur qu’il remplissait
aux Salons de cette Société et la façon brillante
dont il s’en acquittait. Il était secrétaire-trésorier
de cette Société et président de la Société des
Aquarellistes français. Avant d’émigrer à la Société
Nationale des Beaux-Arts, Dubufe avait obtenu aux
Salons de la Société des Artistes français une mé-
daille de 3e classe en 1877 et une de seconde classe
en 1878. Titulaire d’une médaille d’or à l’Exposition
Universelle de 1889 etnommé chevalier de la Légion
d’honneur la même année, il fut membre du jury
et promu officier en 1900.
Il s’était fait connaître aussi comme critique
d’art par des articles dans la Revue des Deux
Mondes et avait publié récemment un livre intitulé
La Valeur de l’Art.
La semaine dernière est mort à Challans (Ven-
dée), à l’âge de quarante-neuf ans, le statuaire
Emile Gaucher, ancien élève de Dalou et profes-
seur à l’Ecole régionale des Beaux-Arts de Nantes.
On lui doit, avec le Réveil, mentionné au Salon de
1892 et aujourd’hui au musée de Nantes, le Bar-
dage, du musée de Blois, sa ville originaire, La
Charité,, beau groupe qui orne une des places
d’Ancenis, et beaucoup d’autres monuments dissé-
minés dans la région nantaise, à laquelle s’était
attaché ce modeste mais sincère sculpteur, croyant
aux idées de décentralisation.
La semaine dernière est mort à Garnbo (Basses-
Pyrénées), à l’âge de cinquante ans, le compositeur
I. Albeniz. Espagnol de naissance, il fut d’abord
un virtuose renommé dont la carrière et la réputa-
tion se firent surtout en Angleterre où il demeura
de longues années. Il vint ensuite à Paris. Com-
positeur très sobre et Irès délicat, il laisse des
pièces pour piano d’une charmante fantaisie et,
parmi ses derniers ouvrages, un opéra comique,'
Pépita Jimenez, un poème symphonique, Cata-
lonia, qui fut exécuté aux Concerts Colonne et
dont on admira la verve; enfin quatre recueils de
pièces de piano pleines de pittoresque intitulés
Lberia. Il avait également commencé une trilogie
sur les légendes de la Table Ronde et une pièce
espagnole qu’il destinait à l’Opéra-Comique.
Le peintre russe Ivan PranishnikofF, qui ex-
posait aux Salons annuels avec succès, vient de