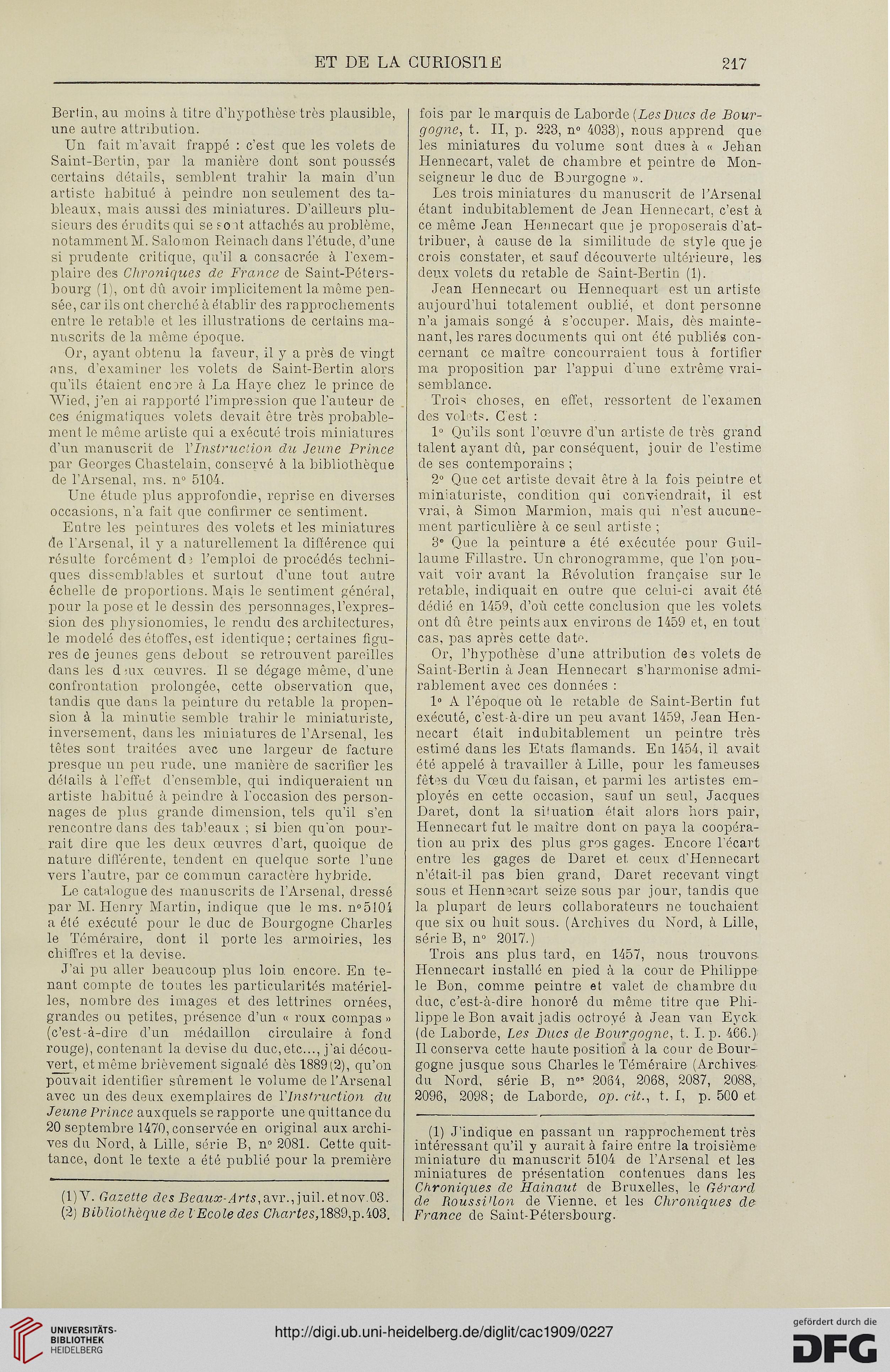ET DE LA CURI0SI1E
217
Berlin, au moins à titre d’hypothèse très plausible,
une autre attribution.
Un fait m’avait frappé : c’est que les volets de
Saint-Bertin, par la manière dont sont poussés
certains détails, semblent trahir la main d’un
artiste habitué à peindre non seulement des ta-
bleaux, mais aussi des miniatures. D’ailleurs plu-
sieurs des érudits qui se sont attachés au problème,
notamment M. Salomon Reinach dans l’étude, d’une
si prudente critique, qu’il a consacrée à l’exem-
plaire des Chroniques de France de Saint-Péters-
bourg (1), ont dû avoir implicitement la même pen-
sée, car ils ont cherché à établir des rapprochements
entre le retable et les illustrations de certains ma-
nuscrits de la même époque.
Or, ayant obtenu la faveur, il y a près de vingt
ans, d’examiner les volets de Saint-Bertin alors
qu’ils étaient encore à La Haye chez le prince de
Wied, j’en ai rapporté l’impression que l’auteur de
ces énigmatiques volets devait être très probable-
ment le même artiste qui a exécuté trois miniatures
d’un manuscrit de l'Instruction du Jeune Prince
par Georges Chastelain, conservé à la bibliothèque
de l’Arsenal, ms. n° 5104.
Une étude plus approfondie, reprise en diverses
occasions, n’a fait que confirmer ce sentiment.
Entre les peintures des volets et les miniatures
de l’Arsenal, il y a naturellement la différence qui
résulte forcément dj l’emploi de procédés techni-
ques dissemblables et surtout d’une tout autre
échelle de proportions. Mais le sentiment général,
pour la pose et le dessin des personnages,l’expres-
sion des physionomies, le rendu des architectures,
le modelé des étoffes, est identique; certaines figu-
res de jeunes gens debout se retrouvent pareilles
dans les dmx œuvres. Il se dégage même, d’une
confrontation prolongée, cette observation que,
tandis que dans la peinture du retable la propen-
sion à la minutie semble trahir le miniaturiste,
inversement, dans les miniatures de l’Arsenal, les
têtes sont traitées avec une largeur de facture
presque un peu rude, une manière de sacrifier les
délails à l’effet d’ensemble, qui indiqueraient un
artiste habitué à peindre à l'occasion des person-
nages de plus grande dimension, tels qu’il s’en
rencontre dans des tab’eaux ; si bien qu’on pour-
rait dire que les deux œuvres d’art, quoique de
nature différente, tendent en quelque sorte l’une
vers l’autre, par ce commun caractère hybride.
Le catalogue des manuscrits de l’Arsenal, dressé
par M. Henry Martin, indique que le ms. n°510i
a été exécuté pour le duc de Bourgogne Charles
le Téméraire, dont il porte les armoiries, les
chiffres et la devise.
J’ai pu aller beaucoup plus loin, encore. En te-
nant compte de toutes les particularités matériel-
les, nombre des images et des lettrines ornées,
grandes ou petites, présence d’un « roux compas »
(c’est à-dire d’un médaillon circulaire à fond
rouge), contenant la devise du duc,etc..., j’ai décou-
vert, et même brièvement signalé dès 1889 (2), qu’on
pouvait identifier sûrement le volume de l’Arsenal
avec un des deux exemplaires de l'Instruction du
Jeune Prince auxquels se rapporte une quittance du
20 septembre 1470, conservée en original aux archi-
ves du Nord, à Lille, série B, n° 2081. Cette quit-
tance, dont le texte a été publié pour la première
(1) A7. Gazette des Beaux-Arts,&\r.,]vL\\.eïno'v.03.
(2) Bibliothèque de l Ecole des Chartes, 1889,p.403.
fois par le marquis de Laborde [Les Ducs de Bour-
gogne, t. II, p. 223, n° 4033), nous apprend que
les miniatures du volume sont dues à « Jehan
Hennecart, valet de chambre et peintre de Mon-
seigneur le duc de Bourgogne ».
Les trois miniatures du manuscrit de l’Arsenal
étant indubitablement de Jean Hennecart, c’est à
ce même Jean Hennecart que je proposerais d’at-
tribuer, à cause de la similitude de style que je
crois constater, et sauf découverte ultérieure, les
deux volets du retable de Saint-Bertin (1).
Jean Hennecart ou Hennequart est un artiste
aujourd’hui totalement oublié, et dont personne
n’a jamais songé à s’occuper. Mais, dès mainte-
nant, les rares documents qui ont été publiés con-
cernant ce maître concourraient tous à fortifier
ma proposition par l’appui d'une extrême vrai-
semblance.
Trois choses, en effet, ressortent de l’examen
des volets. C'est :
1° Qu’ils sont l’œuvre d’un artiste de très grand
talent ayant dû, par conséquent, jouir de l’estime
de ses contemporains ;
2° Que cet artiste devait être à la fois peintre et
miniaturiste, condition qui conviendrait, il est
vrai, à Simon Marmion, mais qui n’est aucune-
ment particulière à ce seul artiste ;
3° Que la peinture a été exécutée pour Guil-
laume Fillastre. Un chronogramme, que l’on pou-
vait voir avant la Révolution française sur le
retable, indiquait en outre que celui-ci avait été
dédié en 1459, d’où cette conclusion que les volets
ont dû être peints aux environs de 1459 et, en tout
cas, pas après cette date.
Or, l’hypothèse d’une attribution des volets de
Saint-Berlin à Jean Hennecart s’harmonise admi-
rablement avec ces données :
1° A l’époque où le retable de Saint-Bertin fut
exécuté, c’est-à-dire un peu avant 1459, Jean Hen-
necart était indubitablement un peintre très
estimé dans les Etats flamands. En 1454, il avait
été appelé à travailler à Lille, pour les fameuses
fêtes du Vœu du faisan, et parmi les artistes em-
ployés en cette occasion, sauf un seul, Jacques
Daret, dont la situation était alors hors pair,
Hennecart fut le maître dont on pajm la coopéra-
tion au prix des plus gros gages. Encore l'écart
entre les gages de Daret et ceux d’Hennecart
n’était-il pas bien grand, Daret recevant vingt
sous et Hennecart seize sous par jour, tandis que
la plupart de leurs collaborateurs ne touchaient
que six ou huit sous. (Archives du Nord, à Lille,
série B, n» 2017.)
Trois ans plus tard, en 1457, nous trouvons
Hennecart installé en pied à la cour de Philippe
le Bon, comme peintre et valet de chambre du
duc, c’est-à-dire honoré du même titre que Phi-
lippe le Bon avait jadis octroyé à Jean van Evck
(de Laborde, Les Ducs de Bourgogne, t. I. p. 466.)
Il conserva cette haute position à la cour de Bour-
gogne jusque sous Charles le Téméraire (Archives-
du Nord, série B, n05 2 0 81, 2068, 2087, 2088,.
2096, 2098; de Laborde, op. oit., t. I, p. 500 et
(1) J'indique en passant un rapprochement très
intéressant qu’il y aurait à faire entre la troisième
miniature du manuscrit 5104 de l’Arsenal et les
miniatures de présentation contenues dans les
Chroniques de Hainaut de Bruxelles, le Gérard
de Roussi'lon de ATenne. et les Chroniques de
France de Saint-Pétersbourg.
217
Berlin, au moins à titre d’hypothèse très plausible,
une autre attribution.
Un fait m’avait frappé : c’est que les volets de
Saint-Bertin, par la manière dont sont poussés
certains détails, semblent trahir la main d’un
artiste habitué à peindre non seulement des ta-
bleaux, mais aussi des miniatures. D’ailleurs plu-
sieurs des érudits qui se sont attachés au problème,
notamment M. Salomon Reinach dans l’étude, d’une
si prudente critique, qu’il a consacrée à l’exem-
plaire des Chroniques de France de Saint-Péters-
bourg (1), ont dû avoir implicitement la même pen-
sée, car ils ont cherché à établir des rapprochements
entre le retable et les illustrations de certains ma-
nuscrits de la même époque.
Or, ayant obtenu la faveur, il y a près de vingt
ans, d’examiner les volets de Saint-Bertin alors
qu’ils étaient encore à La Haye chez le prince de
Wied, j’en ai rapporté l’impression que l’auteur de
ces énigmatiques volets devait être très probable-
ment le même artiste qui a exécuté trois miniatures
d’un manuscrit de l'Instruction du Jeune Prince
par Georges Chastelain, conservé à la bibliothèque
de l’Arsenal, ms. n° 5104.
Une étude plus approfondie, reprise en diverses
occasions, n’a fait que confirmer ce sentiment.
Entre les peintures des volets et les miniatures
de l’Arsenal, il y a naturellement la différence qui
résulte forcément dj l’emploi de procédés techni-
ques dissemblables et surtout d’une tout autre
échelle de proportions. Mais le sentiment général,
pour la pose et le dessin des personnages,l’expres-
sion des physionomies, le rendu des architectures,
le modelé des étoffes, est identique; certaines figu-
res de jeunes gens debout se retrouvent pareilles
dans les dmx œuvres. Il se dégage même, d’une
confrontation prolongée, cette observation que,
tandis que dans la peinture du retable la propen-
sion à la minutie semble trahir le miniaturiste,
inversement, dans les miniatures de l’Arsenal, les
têtes sont traitées avec une largeur de facture
presque un peu rude, une manière de sacrifier les
délails à l’effet d’ensemble, qui indiqueraient un
artiste habitué à peindre à l'occasion des person-
nages de plus grande dimension, tels qu’il s’en
rencontre dans des tab’eaux ; si bien qu’on pour-
rait dire que les deux œuvres d’art, quoique de
nature différente, tendent en quelque sorte l’une
vers l’autre, par ce commun caractère hybride.
Le catalogue des manuscrits de l’Arsenal, dressé
par M. Henry Martin, indique que le ms. n°510i
a été exécuté pour le duc de Bourgogne Charles
le Téméraire, dont il porte les armoiries, les
chiffres et la devise.
J’ai pu aller beaucoup plus loin, encore. En te-
nant compte de toutes les particularités matériel-
les, nombre des images et des lettrines ornées,
grandes ou petites, présence d’un « roux compas »
(c’est à-dire d’un médaillon circulaire à fond
rouge), contenant la devise du duc,etc..., j’ai décou-
vert, et même brièvement signalé dès 1889 (2), qu’on
pouvait identifier sûrement le volume de l’Arsenal
avec un des deux exemplaires de l'Instruction du
Jeune Prince auxquels se rapporte une quittance du
20 septembre 1470, conservée en original aux archi-
ves du Nord, à Lille, série B, n° 2081. Cette quit-
tance, dont le texte a été publié pour la première
(1) A7. Gazette des Beaux-Arts,&\r.,]vL\\.eïno'v.03.
(2) Bibliothèque de l Ecole des Chartes, 1889,p.403.
fois par le marquis de Laborde [Les Ducs de Bour-
gogne, t. II, p. 223, n° 4033), nous apprend que
les miniatures du volume sont dues à « Jehan
Hennecart, valet de chambre et peintre de Mon-
seigneur le duc de Bourgogne ».
Les trois miniatures du manuscrit de l’Arsenal
étant indubitablement de Jean Hennecart, c’est à
ce même Jean Hennecart que je proposerais d’at-
tribuer, à cause de la similitude de style que je
crois constater, et sauf découverte ultérieure, les
deux volets du retable de Saint-Bertin (1).
Jean Hennecart ou Hennequart est un artiste
aujourd’hui totalement oublié, et dont personne
n’a jamais songé à s’occuper. Mais, dès mainte-
nant, les rares documents qui ont été publiés con-
cernant ce maître concourraient tous à fortifier
ma proposition par l’appui d'une extrême vrai-
semblance.
Trois choses, en effet, ressortent de l’examen
des volets. C'est :
1° Qu’ils sont l’œuvre d’un artiste de très grand
talent ayant dû, par conséquent, jouir de l’estime
de ses contemporains ;
2° Que cet artiste devait être à la fois peintre et
miniaturiste, condition qui conviendrait, il est
vrai, à Simon Marmion, mais qui n’est aucune-
ment particulière à ce seul artiste ;
3° Que la peinture a été exécutée pour Guil-
laume Fillastre. Un chronogramme, que l’on pou-
vait voir avant la Révolution française sur le
retable, indiquait en outre que celui-ci avait été
dédié en 1459, d’où cette conclusion que les volets
ont dû être peints aux environs de 1459 et, en tout
cas, pas après cette date.
Or, l’hypothèse d’une attribution des volets de
Saint-Berlin à Jean Hennecart s’harmonise admi-
rablement avec ces données :
1° A l’époque où le retable de Saint-Bertin fut
exécuté, c’est-à-dire un peu avant 1459, Jean Hen-
necart était indubitablement un peintre très
estimé dans les Etats flamands. En 1454, il avait
été appelé à travailler à Lille, pour les fameuses
fêtes du Vœu du faisan, et parmi les artistes em-
ployés en cette occasion, sauf un seul, Jacques
Daret, dont la situation était alors hors pair,
Hennecart fut le maître dont on pajm la coopéra-
tion au prix des plus gros gages. Encore l'écart
entre les gages de Daret et ceux d’Hennecart
n’était-il pas bien grand, Daret recevant vingt
sous et Hennecart seize sous par jour, tandis que
la plupart de leurs collaborateurs ne touchaient
que six ou huit sous. (Archives du Nord, à Lille,
série B, n» 2017.)
Trois ans plus tard, en 1457, nous trouvons
Hennecart installé en pied à la cour de Philippe
le Bon, comme peintre et valet de chambre du
duc, c’est-à-dire honoré du même titre que Phi-
lippe le Bon avait jadis octroyé à Jean van Evck
(de Laborde, Les Ducs de Bourgogne, t. I. p. 466.)
Il conserva cette haute position à la cour de Bour-
gogne jusque sous Charles le Téméraire (Archives-
du Nord, série B, n05 2 0 81, 2068, 2087, 2088,.
2096, 2098; de Laborde, op. oit., t. I, p. 500 et
(1) J'indique en passant un rapprochement très
intéressant qu’il y aurait à faire entre la troisième
miniature du manuscrit 5104 de l’Arsenal et les
miniatures de présentation contenues dans les
Chroniques de Hainaut de Bruxelles, le Gérard
de Roussi'lon de ATenne. et les Chroniques de
France de Saint-Pétersbourg.