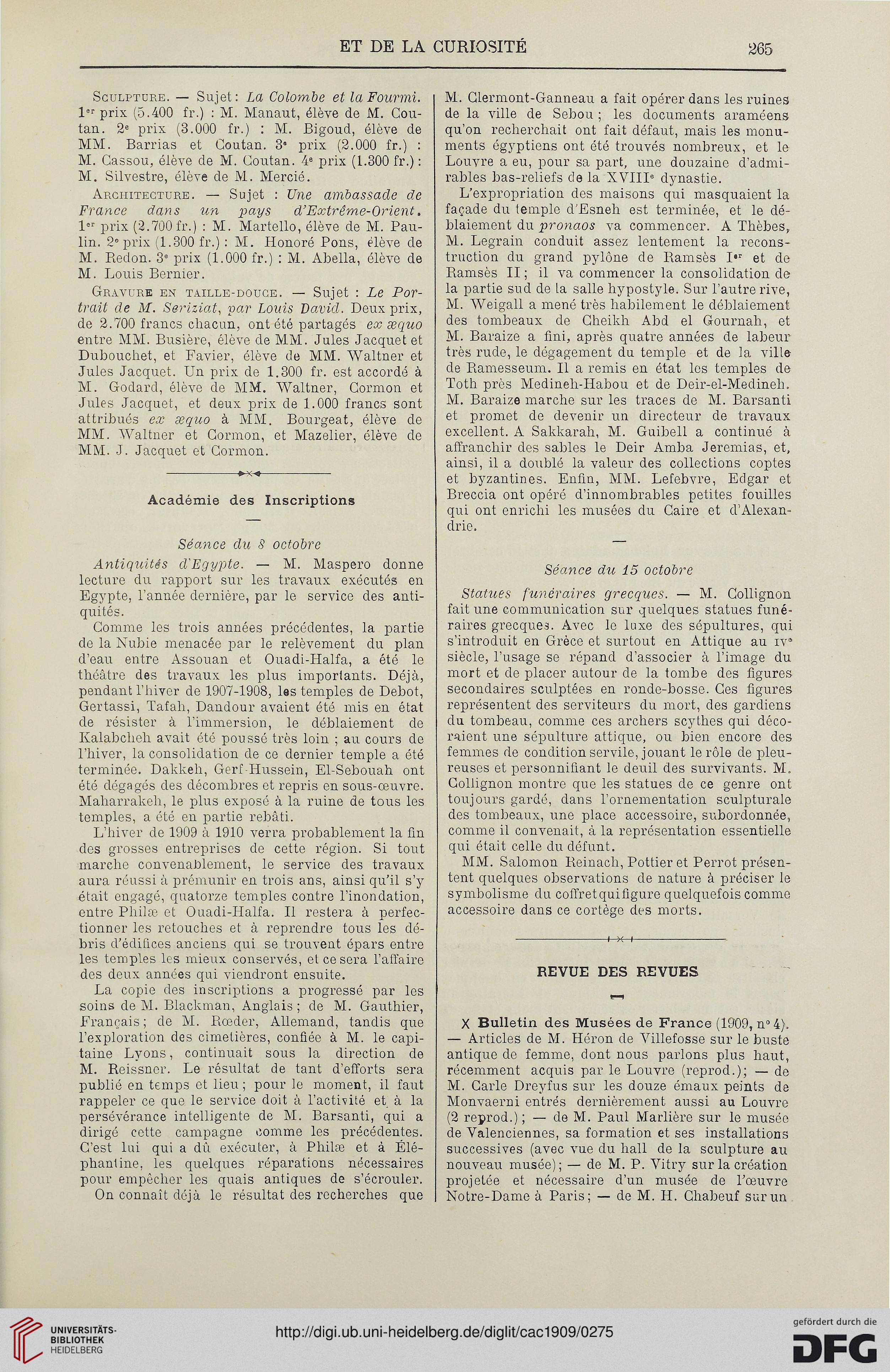ET DE LA CURIOSITÉ
265
Sculpture. — Sujet: La Colombe et la Fourmi.
l8r prix (5.400 fr.) : M. Manaut, élève de M. Cou-
tan. 2e prix (3.000 fr.) : M. Bigoud, élève de
MM. Barrias et Coutan. 3e prix (2.000 fr.) :
M. Cassou, élève de M. Coutan. 4e prix (1.300 fr.) :
M. Silvestre, élève de M. Mercié.
Architecture. — Sujet : Une ambassade de
France dans un pays d’Extrême-Orient.
1er prix (2.700 fr.) : M. Martello, élève de M. Pau-
lin. 2° prix (1.300 fr.) : M. Honoré Pons, élève de
M. Redon. 3e prix (1.000 fr.) : M. Abella, élève de
M. Louis Bernier.
Gravure en taille-douce. — Sujet : Le Por-
trait de M. Seriziat, par Louis David. Deux prix,
de 2.700 francs chacun, ont été partagés ex æquo
entre MM. Busière, élève de MM. Jules Jacquet et
Dubouchet, et Favier, élève de MM. Waltner et
Jules Jacquet. Un prix de 1.300 fr. est accordé à
M. Godard, élève de MM. Waltner, Cormon et
Jules Jacquet, et deux prix de 1.000 francs sont
attribués ex æquo à MM. Bourgeat, élève de
MM. Waltner et Cormon, et Mazelier, élève de
MM. J. Jacquet et Cormon.
Académie des Inscriptions
Séance du 8 octobre
Antiquités d'Egypte. — M. Maspero donne
lecture du rapport sur les travaux exécutés en
Egypte, l’année dernière, par le service des anti-
quités.
Comme les trois années précédentes, la partie
de la Nubie menacée par le relèvement du plan
d’eau entre Assouan et Ouadi-Halfa, a été le
théâtre des travaux les plus importants. Déjà,
pendant l’hiver de 1907-1908, les temples de Debot,
Gertassi, Tafah, Dandour avaient été mis en état
de résister à l’immersion, le déblaiement de
Kalabclieh avait été poussé très loin ; au cours de
l’hiver, la consolidation de ce dernier temple a été
terminée. Dakkeh, Gerf Hussein, El-Sebouah ont
été dégagés des décombres et repris en sous-œuvre.
Maharrakeh, le plus exposé à la ruine de tous les
temples, a été en partie rebâti.
L’hiver de 1909 à 1910 verra probablement la fin
des grosses entreprises de cette région. Si tout
marelie convenablement, le service des travaux
aura réussi à prémunir en trois ans, ainsi qu’il s’y
était engagé, quatorze temples contre l’inondation,
entre Philæ et Ouadi-Halfa. Il restera à perfec-
tionner les retouches et à reprendre tous les dé-
bris d’édifices anciens qui se trouvent épars entre
les temples les mieux conservés, et ce sera l’affaire
des deux années qui viendront ensuite.
La copie des inscriptions a progressé par les
soins de M. Blackman, Anglais ; de M. Gauthier,
Français ; de M. Boeder, Allemand, tandis que
l’exploration des cimetières, confiée à M. le capi-
taine Lvons, continuait sous la direction de
M. Reissner. Le résultat de tant d’efforts sera
publié en temps et lieu ; pour le moment, il faut
rappeler ce que le service doit à l’activité et à la
persévérance intelligente de M. Barsanti, qui a
dirigé cette campagne comme les précédentes.
C’est lui qui a dû exécuter, à Philæ et à Élé-
phantine, les quelques réparations nécessaires
pour empêcher les quais antiques de s’écrouler.
On connaît déjà le résultat des recherches que
M. Clermont-Ganneau a fait opérer dans les ruines
de la ville de Sebou ; les documents araméens
qu’on recherchait ont fait défaut, mais les monu-
ments égyptiens ont été trouvés nombreux, et le
Louvre a eu, pour sa part, une douzaine d’admi-
rables bas-reliefs de la XVIIIe dynastie.
L’expropriation des maisons qui masquaient la
façade du temple d'Esneh est terminée, et le dé-
blaiement du pronaos va commencer. A Thèbes,
M. Legrain conduit assez lentement la recons-
truction du grand pylône de Ramsès I,r et de
Ramsès II ; il va commencer la consolidation de
la partie sud de la salle hypostyle. Sur l’autre rive,
M. Weigall a mené très habilement le déblaiement
des tombeaux de Cheikh Abd el Gournah, et
M. Baraize a fini, après quatre années de labeur
très rude, le dégagement du temple et de la ville
de Ramesseum. II a remis en état les temples de
Toth près Medineh-Habou et de Deir-el-Medineh.
M. Baraize marche sur les traces de M. Barsanti
et promet de devenir un directeur de travaux
excellent. A Sakkarah, M. Guibell a continué à
affranchir des sables le Deir Amba Jeremias, et,
ainsi, il a doublé la valeur des collections coptes
et byzantines. Enfin, MM. Lefebvre, Edgar et
Breccia ont opéré d’innombrables petites fouilles
qui ont enrichi les musées du Caire et d’Alexan-
drie.
Séance du 15 octobre
Statues funéraires grecques. — M. Collignon
fait une communication sur quelques statues funé-
raires grecques. Avec le luxe des sépultures, qui
s’introduit en Grèce et surtout en Attique au iv“
siècle, l’usage se répand d’associer à l’image du
mort et de placer autour de la tombe des figures
secondaires sculptées en ronde-bosse. Ces figures
représentent des serviteurs du mort, des gardiens
du tombeau, comme ces archers scythes qui déco-
raient une sépulture attique, ou bien encore des
femmes de condition servile, jouant le rôle de pleu-
reuses et personnifiant le deuil des survivants. M.
Collignon montre que les statues de ce genre ont
toujours gardé, dans l’ornementation sculpturale
des tombeaux, une place accessoire, subordonnée,
comme il convenait, à la représentation essentielle
qui était celle du défunt.
MM. Salomon Reinacli, Pottier et Perrot présen-
tent quelques observations de nature à préciser le
symbolisme du coffret qui figure quelquefois comme
accessoire dans ce cortège des morts.
-h-H-i-
REVUE DES REVUES
X Bulletin des Musées de France (1909, n° 4).
— Articles de M. Héron de Villefosse sur le buste
antique de femme, dont nous parlons plus haut,
récemment acquis par le Louvre (reprod.); — de
M. Carie Dreyfus sur les douze émaux peints de
Monvaerni entrés dernièrement aussi au Louvre
(2 reprod.); — de M. Paul Marlière sur le musée
de Valenciennes, sa formation et ses installations
successives (avec vue du hall de la sculpture au
nouveau musée); — de M. P. Vitry sur la création
projetée et nécessaire d’un musée de l’œuvre
Notre-Dame à Paris; — de M. H. Chabeuf sur un
265
Sculpture. — Sujet: La Colombe et la Fourmi.
l8r prix (5.400 fr.) : M. Manaut, élève de M. Cou-
tan. 2e prix (3.000 fr.) : M. Bigoud, élève de
MM. Barrias et Coutan. 3e prix (2.000 fr.) :
M. Cassou, élève de M. Coutan. 4e prix (1.300 fr.) :
M. Silvestre, élève de M. Mercié.
Architecture. — Sujet : Une ambassade de
France dans un pays d’Extrême-Orient.
1er prix (2.700 fr.) : M. Martello, élève de M. Pau-
lin. 2° prix (1.300 fr.) : M. Honoré Pons, élève de
M. Redon. 3e prix (1.000 fr.) : M. Abella, élève de
M. Louis Bernier.
Gravure en taille-douce. — Sujet : Le Por-
trait de M. Seriziat, par Louis David. Deux prix,
de 2.700 francs chacun, ont été partagés ex æquo
entre MM. Busière, élève de MM. Jules Jacquet et
Dubouchet, et Favier, élève de MM. Waltner et
Jules Jacquet. Un prix de 1.300 fr. est accordé à
M. Godard, élève de MM. Waltner, Cormon et
Jules Jacquet, et deux prix de 1.000 francs sont
attribués ex æquo à MM. Bourgeat, élève de
MM. Waltner et Cormon, et Mazelier, élève de
MM. J. Jacquet et Cormon.
Académie des Inscriptions
Séance du 8 octobre
Antiquités d'Egypte. — M. Maspero donne
lecture du rapport sur les travaux exécutés en
Egypte, l’année dernière, par le service des anti-
quités.
Comme les trois années précédentes, la partie
de la Nubie menacée par le relèvement du plan
d’eau entre Assouan et Ouadi-Halfa, a été le
théâtre des travaux les plus importants. Déjà,
pendant l’hiver de 1907-1908, les temples de Debot,
Gertassi, Tafah, Dandour avaient été mis en état
de résister à l’immersion, le déblaiement de
Kalabclieh avait été poussé très loin ; au cours de
l’hiver, la consolidation de ce dernier temple a été
terminée. Dakkeh, Gerf Hussein, El-Sebouah ont
été dégagés des décombres et repris en sous-œuvre.
Maharrakeh, le plus exposé à la ruine de tous les
temples, a été en partie rebâti.
L’hiver de 1909 à 1910 verra probablement la fin
des grosses entreprises de cette région. Si tout
marelie convenablement, le service des travaux
aura réussi à prémunir en trois ans, ainsi qu’il s’y
était engagé, quatorze temples contre l’inondation,
entre Philæ et Ouadi-Halfa. Il restera à perfec-
tionner les retouches et à reprendre tous les dé-
bris d’édifices anciens qui se trouvent épars entre
les temples les mieux conservés, et ce sera l’affaire
des deux années qui viendront ensuite.
La copie des inscriptions a progressé par les
soins de M. Blackman, Anglais ; de M. Gauthier,
Français ; de M. Boeder, Allemand, tandis que
l’exploration des cimetières, confiée à M. le capi-
taine Lvons, continuait sous la direction de
M. Reissner. Le résultat de tant d’efforts sera
publié en temps et lieu ; pour le moment, il faut
rappeler ce que le service doit à l’activité et à la
persévérance intelligente de M. Barsanti, qui a
dirigé cette campagne comme les précédentes.
C’est lui qui a dû exécuter, à Philæ et à Élé-
phantine, les quelques réparations nécessaires
pour empêcher les quais antiques de s’écrouler.
On connaît déjà le résultat des recherches que
M. Clermont-Ganneau a fait opérer dans les ruines
de la ville de Sebou ; les documents araméens
qu’on recherchait ont fait défaut, mais les monu-
ments égyptiens ont été trouvés nombreux, et le
Louvre a eu, pour sa part, une douzaine d’admi-
rables bas-reliefs de la XVIIIe dynastie.
L’expropriation des maisons qui masquaient la
façade du temple d'Esneh est terminée, et le dé-
blaiement du pronaos va commencer. A Thèbes,
M. Legrain conduit assez lentement la recons-
truction du grand pylône de Ramsès I,r et de
Ramsès II ; il va commencer la consolidation de
la partie sud de la salle hypostyle. Sur l’autre rive,
M. Weigall a mené très habilement le déblaiement
des tombeaux de Cheikh Abd el Gournah, et
M. Baraize a fini, après quatre années de labeur
très rude, le dégagement du temple et de la ville
de Ramesseum. II a remis en état les temples de
Toth près Medineh-Habou et de Deir-el-Medineh.
M. Baraize marche sur les traces de M. Barsanti
et promet de devenir un directeur de travaux
excellent. A Sakkarah, M. Guibell a continué à
affranchir des sables le Deir Amba Jeremias, et,
ainsi, il a doublé la valeur des collections coptes
et byzantines. Enfin, MM. Lefebvre, Edgar et
Breccia ont opéré d’innombrables petites fouilles
qui ont enrichi les musées du Caire et d’Alexan-
drie.
Séance du 15 octobre
Statues funéraires grecques. — M. Collignon
fait une communication sur quelques statues funé-
raires grecques. Avec le luxe des sépultures, qui
s’introduit en Grèce et surtout en Attique au iv“
siècle, l’usage se répand d’associer à l’image du
mort et de placer autour de la tombe des figures
secondaires sculptées en ronde-bosse. Ces figures
représentent des serviteurs du mort, des gardiens
du tombeau, comme ces archers scythes qui déco-
raient une sépulture attique, ou bien encore des
femmes de condition servile, jouant le rôle de pleu-
reuses et personnifiant le deuil des survivants. M.
Collignon montre que les statues de ce genre ont
toujours gardé, dans l’ornementation sculpturale
des tombeaux, une place accessoire, subordonnée,
comme il convenait, à la représentation essentielle
qui était celle du défunt.
MM. Salomon Reinacli, Pottier et Perrot présen-
tent quelques observations de nature à préciser le
symbolisme du coffret qui figure quelquefois comme
accessoire dans ce cortège des morts.
-h-H-i-
REVUE DES REVUES
X Bulletin des Musées de France (1909, n° 4).
— Articles de M. Héron de Villefosse sur le buste
antique de femme, dont nous parlons plus haut,
récemment acquis par le Louvre (reprod.); — de
M. Carie Dreyfus sur les douze émaux peints de
Monvaerni entrés dernièrement aussi au Louvre
(2 reprod.); — de M. Paul Marlière sur le musée
de Valenciennes, sa formation et ses installations
successives (avec vue du hall de la sculpture au
nouveau musée); — de M. P. Vitry sur la création
projetée et nécessaire d’un musée de l’œuvre
Notre-Dame à Paris; — de M. H. Chabeuf sur un