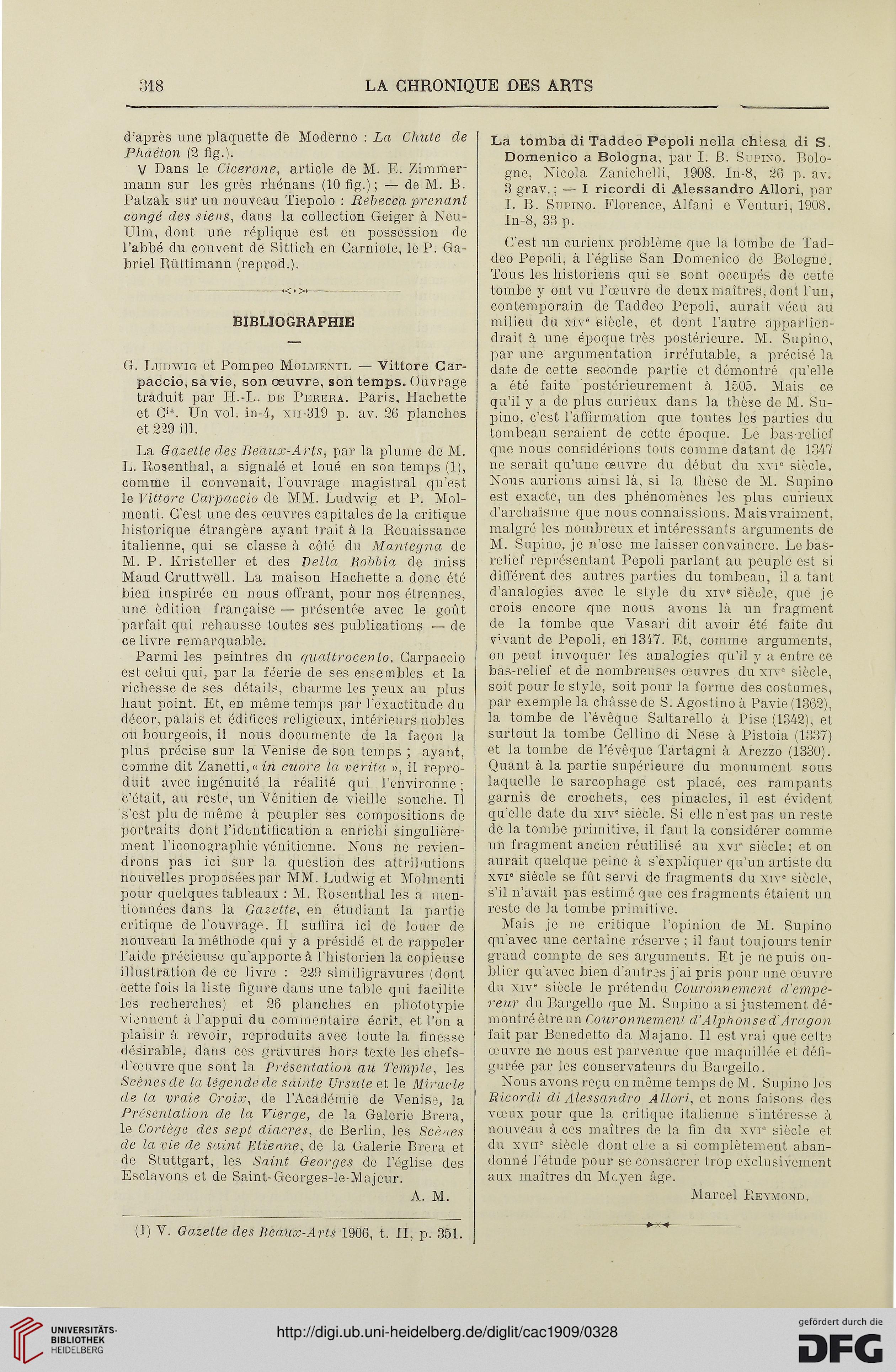318
LA CHRONIQUE DES ARTS
d’après une plaquette de Moderno : La Chute de
Phaéton (2 fig.).
V Dans le Cicerone, article de M. E. Zimmer-
mann sur les gi’ès rhénans (10 fig.); — de M. B.
Patzak sur un nouveau Tiepolo : Rebecca prenant
congé des siens, dans la collection Geiger à Neu-
Ulm, dont une réplique est en possession de
l’abbé du couvent de Sittich en Garnioie, le P. Ga-
briel Rüttimann (reprod.).
-K • X-
BIBLIOGRAPHIE
G. Ludwig et Pompeo Molmenti. — Vittore Car-
paccio, sa vie, son œuvre, son temps. Ouvrage
traduit par II.-L. de Perera. Paris, Hachette
et Cie. Un vol. in-4, xii-319 p. av. 26 planches
et 229 ill.
La Gazette des Beaux-Arts, par la plume de M.
L. Rosenthal, a signalé et loué en son temps (1),
comme il convenait, l’ouvrage magistral qu’est
le Vittore Carpaccio de MM. Ludwig et P. Mol-
menti. G’est une des oeuvres capitales de la critique
historique étrangère ayant Irait à la Renaissance
italienne, qui se classe à côté du Mantegna de
M. P. Kristeller et des Delta Robbia de miss
Maud Gruttwell. La maison Hachette a donc été
bien inspirée en nous offrant, pour nos étrennes,
une édition française — présentée avec le goût
parfait qui rehausse toutes ses publications — de
ce livre remarquable.
Parmi les peintres du quattrocento, Carpaccio
est celui qui, par la féerie de ses ensembles et la
richesse de ses détails, charme les yeux au plus
haut point. Et, eD même temps par l’exactitude du
décor, palais et édifices religieux, intérieurs nobles
ou bourgeois, il nous documente de la façon la
plus précise sur la Venise de son temps ; ayant,
comme dit Zanetti,«fn cuore la veriia », il repro-
duit avec ingénuité la réalité qui l’environne ;
c’était, au reste, un Vénitien de vieille souche. II
s’est plu de même à peupler ses compositions de
portraits dont l’identification a enrichi singulière-
ment l’iconographie vénitienue. Nous ne revien-
drons pas ici sur la question des attributions
nouvelles proposées par MM. Ludwig et Molmenti
pour quelques tableaux : M. Rosenthal les a men-
tionnées dans la Gazette, en étudiant la partie
critique de l’ouvrage. II suffira ici de louer de
nouveau la méthode qui y a présidé et de rappeler
l’aide précieuse qu’apporte à l’historien la copieuse
illustration de ce livre : 229 similigravures (dont
cette fois la liste figure dans une table qui facilite
les recherches) et 26 planches en phototypie
viennent à l’appui du commentaire écrit, et l’on a
plaisir à revoir, reproduits avec toute la finesse
désiraMe, dans ces gravures hors texte les chefs-
d’œüvre que sont la Présentation au Temple, les
Scènes de la légende de sainte Ursule et le Miracle
de ta vraie Croix, de l’Académie de Venise, la
Présentation de la Vierge, de la Galerie Brera,
le Cortège des sept diacres, de Berlin, les Scènes
de la vie de saint Etienne, de la Galerie Brera et
de Stuttgart, les Saint Georges de l’église des
Esclavons et de Saint-Georges-le-Majeur.
A. M.
La tomba di Taddeo Pepoli nella chiesa di S.
Domenico a Bologna, par I. B. Supino. Bolo-
gne, Nicola Zanichelli, 1908. In-8, 26 p. av.
3 grav. ; — I ricordi di Alessandro Allori, par
I. B. Supino. Florence, Alfani e Venturi, 1908.
In-8, 33 p.
G’est un curieux problème que la tombe de Tad-
deo Pepoli, à l’église San Domenico de Bologne.
Tous les historiens qui se sont occupés de cette
tombe y ont vu l’œuvre de deux maîtres, dont l’un,
contemporain de Taddeo Pepoli, aurait vécu au
milieu du xive siècle, et dont l’autre apparlien-
drait à une époque très postérieure. M. Supino,
par une argumentation irréfutable, a précisé la
date de cette seconde partie et démontré qu’elle
a été faite postérieurement à 1505. Mais ce
qu’il y a de plus curieux dans la thèse de M. Su-
pino, c’est l’affirmation que toutes les parties du
tombeau seraient de cette époque. Le bas-relief
que nous considérions tous comme datant de 1347
ne serait qu’une œuvre du début du xvie siècle.
Nous aurions ainsi là, si la thèse de M. Supino
est exacte, un des phénomènes les plus curieux
d’archaïsme que nous connaissions. Maisvraiment,
malgré les nombreux et intéressants arguments de
M. Supino, je n’ose me laisser convaincre. Le bas-
relief représentant Pepoli parlant au peuple est si
différent des autres parties du tombeau, il a tant
d’analogies avec le style du xive siècle, que je
crois encore que nous avons là un fragment
de la tombe que Vasari dit avoir été faite du
v’vant de Pepoli, en 1347. Et, comme arguments,
on peut invoquer les analogies qu’il y a entre ce
bas-relief et de nombreuses œuvres du xive siècle,
soit pour le style, soit pour la forme des costumes,
par exemple la châsse de S. Agostino à Pavie (1362),
la tombe de l’évêque Saltarello à Pise (1342), et
surtout la tombe Gellino di Nese à Pistoia (1337)
et la tombe de l’évêque Tartagni à Arezzo (1330).
Quant à la partie supérieure du monument sous
laquelle le sarcophage est placé, ces rampants
garnis de crochets, ces pinacles, il est évident
qu’elle date du xiv“ siècle. Si elle n’est pas un reste
de la tombe primitive, il faut la considérer comme
un fragment ancien réutilisé au xvie siècle; et on
aurait quelque peine à s’expliquer qu’un artiste du
xvle siècle se fût servi de fragments du xiv° siècle,
s’il n’avait pas estimé que ces fragments étaient un
reste de la tombe primitive.
Mais je ne critique l’opinion de M. Supino
qu’avec une certaine réserve ; il faut toujours tenir
grand compte de ses arguments. Et je ne puis ou-
blier qu’avec bien d’autres j'ai pris pour une œuvre
du xive siècle le prétendu Couronnement d'empe-
reur du Bargello que M. Supino a si justement dé-
montré être un Couronnement d’Alphonsed'Aragon
fait par Benedetto da Majano. Il est vrai que cette
œuvre ne nous est parvenue que maquillée et défi-
gurée par les conservateurs du Bargello.
Nous avons reçu en même temps de M. Supino les
Ricordi di Alessandro A llori, et nous faisons des
vœux pour que la critique italienne s’intéresse à
nouveau à ces maîtres de la fin du xvi° siècle et
du xvue siècle dont elle a si complètement aban-
donné l’étude pour se consacrer trop exclusivement
aux maîtres du Moyen âge.
Marcel Reymond,
(1) Y. Gazette des Reaux-Arts 1906, t. II, p. 351.
LA CHRONIQUE DES ARTS
d’après une plaquette de Moderno : La Chute de
Phaéton (2 fig.).
V Dans le Cicerone, article de M. E. Zimmer-
mann sur les gi’ès rhénans (10 fig.); — de M. B.
Patzak sur un nouveau Tiepolo : Rebecca prenant
congé des siens, dans la collection Geiger à Neu-
Ulm, dont une réplique est en possession de
l’abbé du couvent de Sittich en Garnioie, le P. Ga-
briel Rüttimann (reprod.).
-K • X-
BIBLIOGRAPHIE
G. Ludwig et Pompeo Molmenti. — Vittore Car-
paccio, sa vie, son œuvre, son temps. Ouvrage
traduit par II.-L. de Perera. Paris, Hachette
et Cie. Un vol. in-4, xii-319 p. av. 26 planches
et 229 ill.
La Gazette des Beaux-Arts, par la plume de M.
L. Rosenthal, a signalé et loué en son temps (1),
comme il convenait, l’ouvrage magistral qu’est
le Vittore Carpaccio de MM. Ludwig et P. Mol-
menti. G’est une des oeuvres capitales de la critique
historique étrangère ayant Irait à la Renaissance
italienne, qui se classe à côté du Mantegna de
M. P. Kristeller et des Delta Robbia de miss
Maud Gruttwell. La maison Hachette a donc été
bien inspirée en nous offrant, pour nos étrennes,
une édition française — présentée avec le goût
parfait qui rehausse toutes ses publications — de
ce livre remarquable.
Parmi les peintres du quattrocento, Carpaccio
est celui qui, par la féerie de ses ensembles et la
richesse de ses détails, charme les yeux au plus
haut point. Et, eD même temps par l’exactitude du
décor, palais et édifices religieux, intérieurs nobles
ou bourgeois, il nous documente de la façon la
plus précise sur la Venise de son temps ; ayant,
comme dit Zanetti,«fn cuore la veriia », il repro-
duit avec ingénuité la réalité qui l’environne ;
c’était, au reste, un Vénitien de vieille souche. II
s’est plu de même à peupler ses compositions de
portraits dont l’identification a enrichi singulière-
ment l’iconographie vénitienue. Nous ne revien-
drons pas ici sur la question des attributions
nouvelles proposées par MM. Ludwig et Molmenti
pour quelques tableaux : M. Rosenthal les a men-
tionnées dans la Gazette, en étudiant la partie
critique de l’ouvrage. II suffira ici de louer de
nouveau la méthode qui y a présidé et de rappeler
l’aide précieuse qu’apporte à l’historien la copieuse
illustration de ce livre : 229 similigravures (dont
cette fois la liste figure dans une table qui facilite
les recherches) et 26 planches en phototypie
viennent à l’appui du commentaire écrit, et l’on a
plaisir à revoir, reproduits avec toute la finesse
désiraMe, dans ces gravures hors texte les chefs-
d’œüvre que sont la Présentation au Temple, les
Scènes de la légende de sainte Ursule et le Miracle
de ta vraie Croix, de l’Académie de Venise, la
Présentation de la Vierge, de la Galerie Brera,
le Cortège des sept diacres, de Berlin, les Scènes
de la vie de saint Etienne, de la Galerie Brera et
de Stuttgart, les Saint Georges de l’église des
Esclavons et de Saint-Georges-le-Majeur.
A. M.
La tomba di Taddeo Pepoli nella chiesa di S.
Domenico a Bologna, par I. B. Supino. Bolo-
gne, Nicola Zanichelli, 1908. In-8, 26 p. av.
3 grav. ; — I ricordi di Alessandro Allori, par
I. B. Supino. Florence, Alfani e Venturi, 1908.
In-8, 33 p.
G’est un curieux problème que la tombe de Tad-
deo Pepoli, à l’église San Domenico de Bologne.
Tous les historiens qui se sont occupés de cette
tombe y ont vu l’œuvre de deux maîtres, dont l’un,
contemporain de Taddeo Pepoli, aurait vécu au
milieu du xive siècle, et dont l’autre apparlien-
drait à une époque très postérieure. M. Supino,
par une argumentation irréfutable, a précisé la
date de cette seconde partie et démontré qu’elle
a été faite postérieurement à 1505. Mais ce
qu’il y a de plus curieux dans la thèse de M. Su-
pino, c’est l’affirmation que toutes les parties du
tombeau seraient de cette époque. Le bas-relief
que nous considérions tous comme datant de 1347
ne serait qu’une œuvre du début du xvie siècle.
Nous aurions ainsi là, si la thèse de M. Supino
est exacte, un des phénomènes les plus curieux
d’archaïsme que nous connaissions. Maisvraiment,
malgré les nombreux et intéressants arguments de
M. Supino, je n’ose me laisser convaincre. Le bas-
relief représentant Pepoli parlant au peuple est si
différent des autres parties du tombeau, il a tant
d’analogies avec le style du xive siècle, que je
crois encore que nous avons là un fragment
de la tombe que Vasari dit avoir été faite du
v’vant de Pepoli, en 1347. Et, comme arguments,
on peut invoquer les analogies qu’il y a entre ce
bas-relief et de nombreuses œuvres du xive siècle,
soit pour le style, soit pour la forme des costumes,
par exemple la châsse de S. Agostino à Pavie (1362),
la tombe de l’évêque Saltarello à Pise (1342), et
surtout la tombe Gellino di Nese à Pistoia (1337)
et la tombe de l’évêque Tartagni à Arezzo (1330).
Quant à la partie supérieure du monument sous
laquelle le sarcophage est placé, ces rampants
garnis de crochets, ces pinacles, il est évident
qu’elle date du xiv“ siècle. Si elle n’est pas un reste
de la tombe primitive, il faut la considérer comme
un fragment ancien réutilisé au xvie siècle; et on
aurait quelque peine à s’expliquer qu’un artiste du
xvle siècle se fût servi de fragments du xiv° siècle,
s’il n’avait pas estimé que ces fragments étaient un
reste de la tombe primitive.
Mais je ne critique l’opinion de M. Supino
qu’avec une certaine réserve ; il faut toujours tenir
grand compte de ses arguments. Et je ne puis ou-
blier qu’avec bien d’autres j'ai pris pour une œuvre
du xive siècle le prétendu Couronnement d'empe-
reur du Bargello que M. Supino a si justement dé-
montré être un Couronnement d’Alphonsed'Aragon
fait par Benedetto da Majano. Il est vrai que cette
œuvre ne nous est parvenue que maquillée et défi-
gurée par les conservateurs du Bargello.
Nous avons reçu en même temps de M. Supino les
Ricordi di Alessandro A llori, et nous faisons des
vœux pour que la critique italienne s’intéresse à
nouveau à ces maîtres de la fin du xvi° siècle et
du xvue siècle dont elle a si complètement aban-
donné l’étude pour se consacrer trop exclusivement
aux maîtres du Moyen âge.
Marcel Reymond,
(1) Y. Gazette des Reaux-Arts 1906, t. II, p. 351.