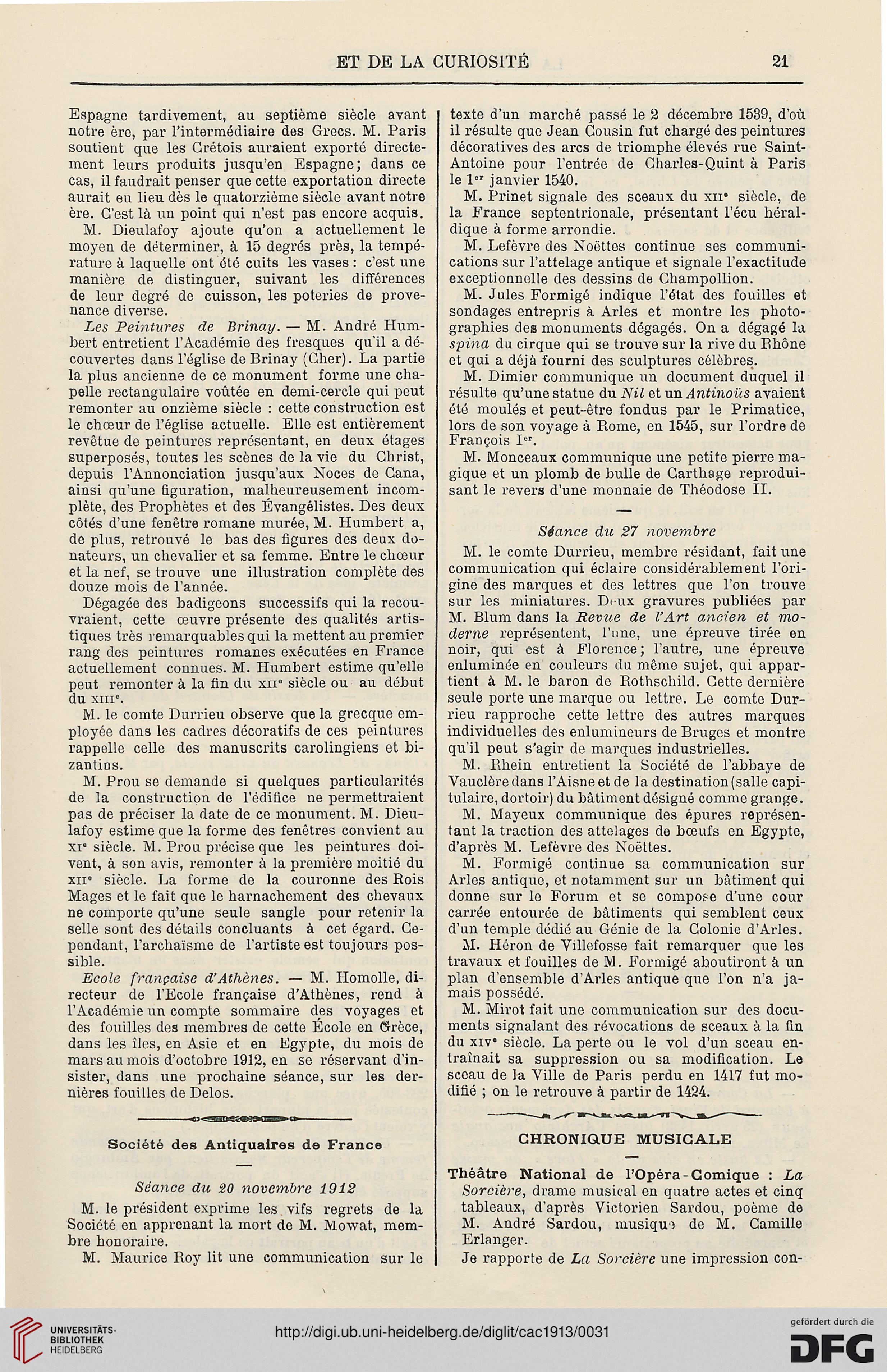ET DE LA CURIOSITÉ
21
Espagne tardivement, au septième siècle avant
notre ère, par l'intermédiaire des Grecs. M. Paris
soutient que les Grétois auraient exporté directe-
ment leurs produits jusqu'en Espagne; dans ce
cas, il faudrait penser que cette exportation directe
aurait eu lieu dès le quatorzième siècle avant notre
ère. C'est là un point qui n'est pas encore acquis.
M. Dieulafoy ajoute qu'on a actuellement le
moyen de déterminer, à 15 degrés près, la tempé-
rature à laquelle ont été cuits les vases : c'est une
manière de distinguer, suivant les différences
de leur degré de cuisson, les poteries de prove-
nance divei'se.
Les Peintures de Brinay. — M. André Hum-
bert entretient l'Académie des fresques qu'il a dé-
couvertes dans l'église de Brinay (Cher). La partie
la plus ancienne de ce monument forme une cha-
pelle rectangulaire voûtée en demi-cercle qui peut
remonter au onzième siècle : cette construction est
le chœur de l'église actuelle. Elle est entièrement
revêtue de peintures représentant, en deux étages
superposés, toutes les scènes de la vie du Christ,
depuis l'Annonciation jusqu'aux Noces de Cana,
ainsi qu'une figuration, malheureusement incom-
plète, des Prophètes et des Évangélistes. Des deux
côtés d'une fenêtre romane murée, M. Humbert a,
de plus, retrouvé le bas des figures des deux do-
nateurs, un chevalier et sa femme. Entre le chœur
et la nef, se trouve une illustration complète des
douze mois de l'année.
Dégagée des badigeons successifs qui la recou-
vraient, cette œuvre présente des qualités artis-
tiques très remarquables qui la mettent au premier
rang des peintures romanes exécutées en France
actuellement connues. M. Humbert estime qu'elle
peut remonter à la fin du xn° siècle ou au début
du xin*.
M. le comte Durrieu observe que la grecque em-
ployée dans les cadres décoratifs de ces peintures
rappelle celle des manuscrits carolingiens et bi-
zantios.
M. Prou se demande si quelques particularités
de la construction de l'édifice ne permettraient
pas de préciser la date de ce monument. M. Dieu-
lafoy estime que la forme des fenêtres convient au
xi* siècle. M. Prou précise que les peintures doi-
vent, à son avis, remonter à la première moitié du
xii" siècle. La forme de la couronne des Rois
Mages et le fait que le harnachement des chevaux
ne comporte qu'une seule sangle pour retenir la
selle sont des détails concluants à cet égard. Ce-
pendant, l'archaïsme de l'artiste est toujours pos-
sible.
Ecole française d'Athènes. — M. Homolle, di-
recteur de l'Ecole française d'Athènes, rend à
l'Académie un compte sommaire des voyages et
des fouilles des membres de cette École en Grèce,
dans les îles, en Asie et en Kgypte, du mois de
mars au mois d'octobre 1912, en se réservant d'in-
sister, dans une prochaine séance, sur les der-
nières fouilles de Delos.
-o<SK»aMjia»>w-
Société des Antiquaires de France
Séance du 20 novembre 1912
M. le président exprime les . vifs regrets de la
Société en apprenant la mort de M. Mowat, mem-
bre honoraire.
M. Maurice Roy lit une communication sur le
texte d'un marché passé le 2 décembre 1539, d'où
il résulte que Jean Cousin fut chargé des peintures
décoratives des arcs de triomphe élevés rue Saint-
Antoine pour l'entrée de Charles-Quint à Paris
le 1" janvier 1540.
M. Prinet signale des sceaux du xn* siècle, de
la France septentrionale, présentant l'écu héral-
dique à forme arrondie.
M. Lefèvre des Noëttes continue ses communi-
cations sur l'attelage antique et signale l'exactitude
exceptionnelle des dessins de Champollion.
M. Jules Formigé indique l'état des fouilles et
sondages entrepris à Arles et montre les photo-
graphies des monuments dégagés. On a dégagé la
spina du cirque qui se trouve sur la rive du Rhône
et qui a déjà fourni des sculptures célèbres.
M. Dimier communique un document duquel il
résulte qu'une statue du Nil et un Antinous avaient
été moulés et peut-être fondus par le Primatice,
lors de son voyage à Rome, on 1545, sur l'ordre de
François I".
M. Monceaux communique une petite pierre ma-
gique et un plomb de bulle de Carthage reprodui-
sant le revers d'une monnaie de Théodose II.
Séance du 27 novembre
M. le comte Durrieu, membre résidant, fait une
communication qui éclaire considérablement l'ori-
gine des marques et des lettres que l'on trouve
sur les miniatures. Deux gravures publiées par
M. Blum dans la Revue de l'Art ancien et mo-
derne représentent, l'une, une épreuve tirée en
noir, qui est à Florence ; l'autre, une épreuve
enluminée en couleurs du même sujet, qui appar-
tient à M. le baron de Rothschild. Cette dernière
seule porte une marque ou lettre. Le comte Dur-
rieu rapproche cette lettre des autres marques
individuelles des enlumineurs de Bruges et montre
qu'il peut s'agir do marques industrielles.
M. Rhein entretient la Société de l'abbaye de
Vauclère dans l'Aisne et de la destination (salle capi-
tulaire, dortoir) du bâtiment désigné comme grange.
M. Mayeux communique des épures représen-
tant la traction des attelages de bœufs en Egypte,
d'après M. Lefèvre des Noëttes.
M. Formigé continue sa communication sur
Arles antique, et notamment sur un bâtiment qui
donne sur le Forum et se compote d'une cour
carrée entourée de bâtiments qui semblent ceux
d'un temple dédié au Génie de la Colonie d'Arles.
M. Héron de Villefosse fait remarquer que les
travaux et fouilles de M. Formigé aboutiront à un
plan d'ensemble d'Arles antique que l'on n'a ja-
mais possédé.
M. Mirot fait uno communication sur des docu-
ments signalant des révocations de sceaux à la fin
du xiv* siècle. La perte ou le vol d'un sceau en-
traînait sa suppression ou sa modification. Le
sceau de la Ville de Paris perdu en 1417 fut mo-
difié ; on le retrouve à partir de 1424.
CHRONIQUE MUSICALE
Théâtre National de l'Opéra-Comique : La
Sorcière, drame musical en quatre actes et cinq
tableaux, d'après Victorien Sardou, poème de
M. André Sardou, musiquî de M. Camille
Erlanger.
Je rapporte de La Sorcière une impression con-
21
Espagne tardivement, au septième siècle avant
notre ère, par l'intermédiaire des Grecs. M. Paris
soutient que les Grétois auraient exporté directe-
ment leurs produits jusqu'en Espagne; dans ce
cas, il faudrait penser que cette exportation directe
aurait eu lieu dès le quatorzième siècle avant notre
ère. C'est là un point qui n'est pas encore acquis.
M. Dieulafoy ajoute qu'on a actuellement le
moyen de déterminer, à 15 degrés près, la tempé-
rature à laquelle ont été cuits les vases : c'est une
manière de distinguer, suivant les différences
de leur degré de cuisson, les poteries de prove-
nance divei'se.
Les Peintures de Brinay. — M. André Hum-
bert entretient l'Académie des fresques qu'il a dé-
couvertes dans l'église de Brinay (Cher). La partie
la plus ancienne de ce monument forme une cha-
pelle rectangulaire voûtée en demi-cercle qui peut
remonter au onzième siècle : cette construction est
le chœur de l'église actuelle. Elle est entièrement
revêtue de peintures représentant, en deux étages
superposés, toutes les scènes de la vie du Christ,
depuis l'Annonciation jusqu'aux Noces de Cana,
ainsi qu'une figuration, malheureusement incom-
plète, des Prophètes et des Évangélistes. Des deux
côtés d'une fenêtre romane murée, M. Humbert a,
de plus, retrouvé le bas des figures des deux do-
nateurs, un chevalier et sa femme. Entre le chœur
et la nef, se trouve une illustration complète des
douze mois de l'année.
Dégagée des badigeons successifs qui la recou-
vraient, cette œuvre présente des qualités artis-
tiques très remarquables qui la mettent au premier
rang des peintures romanes exécutées en France
actuellement connues. M. Humbert estime qu'elle
peut remonter à la fin du xn° siècle ou au début
du xin*.
M. le comte Durrieu observe que la grecque em-
ployée dans les cadres décoratifs de ces peintures
rappelle celle des manuscrits carolingiens et bi-
zantios.
M. Prou se demande si quelques particularités
de la construction de l'édifice ne permettraient
pas de préciser la date de ce monument. M. Dieu-
lafoy estime que la forme des fenêtres convient au
xi* siècle. M. Prou précise que les peintures doi-
vent, à son avis, remonter à la première moitié du
xii" siècle. La forme de la couronne des Rois
Mages et le fait que le harnachement des chevaux
ne comporte qu'une seule sangle pour retenir la
selle sont des détails concluants à cet égard. Ce-
pendant, l'archaïsme de l'artiste est toujours pos-
sible.
Ecole française d'Athènes. — M. Homolle, di-
recteur de l'Ecole française d'Athènes, rend à
l'Académie un compte sommaire des voyages et
des fouilles des membres de cette École en Grèce,
dans les îles, en Asie et en Kgypte, du mois de
mars au mois d'octobre 1912, en se réservant d'in-
sister, dans une prochaine séance, sur les der-
nières fouilles de Delos.
-o<SK»aMjia»>w-
Société des Antiquaires de France
Séance du 20 novembre 1912
M. le président exprime les . vifs regrets de la
Société en apprenant la mort de M. Mowat, mem-
bre honoraire.
M. Maurice Roy lit une communication sur le
texte d'un marché passé le 2 décembre 1539, d'où
il résulte que Jean Cousin fut chargé des peintures
décoratives des arcs de triomphe élevés rue Saint-
Antoine pour l'entrée de Charles-Quint à Paris
le 1" janvier 1540.
M. Prinet signale des sceaux du xn* siècle, de
la France septentrionale, présentant l'écu héral-
dique à forme arrondie.
M. Lefèvre des Noëttes continue ses communi-
cations sur l'attelage antique et signale l'exactitude
exceptionnelle des dessins de Champollion.
M. Jules Formigé indique l'état des fouilles et
sondages entrepris à Arles et montre les photo-
graphies des monuments dégagés. On a dégagé la
spina du cirque qui se trouve sur la rive du Rhône
et qui a déjà fourni des sculptures célèbres.
M. Dimier communique un document duquel il
résulte qu'une statue du Nil et un Antinous avaient
été moulés et peut-être fondus par le Primatice,
lors de son voyage à Rome, on 1545, sur l'ordre de
François I".
M. Monceaux communique une petite pierre ma-
gique et un plomb de bulle de Carthage reprodui-
sant le revers d'une monnaie de Théodose II.
Séance du 27 novembre
M. le comte Durrieu, membre résidant, fait une
communication qui éclaire considérablement l'ori-
gine des marques et des lettres que l'on trouve
sur les miniatures. Deux gravures publiées par
M. Blum dans la Revue de l'Art ancien et mo-
derne représentent, l'une, une épreuve tirée en
noir, qui est à Florence ; l'autre, une épreuve
enluminée en couleurs du même sujet, qui appar-
tient à M. le baron de Rothschild. Cette dernière
seule porte une marque ou lettre. Le comte Dur-
rieu rapproche cette lettre des autres marques
individuelles des enlumineurs de Bruges et montre
qu'il peut s'agir do marques industrielles.
M. Rhein entretient la Société de l'abbaye de
Vauclère dans l'Aisne et de la destination (salle capi-
tulaire, dortoir) du bâtiment désigné comme grange.
M. Mayeux communique des épures représen-
tant la traction des attelages de bœufs en Egypte,
d'après M. Lefèvre des Noëttes.
M. Formigé continue sa communication sur
Arles antique, et notamment sur un bâtiment qui
donne sur le Forum et se compote d'une cour
carrée entourée de bâtiments qui semblent ceux
d'un temple dédié au Génie de la Colonie d'Arles.
M. Héron de Villefosse fait remarquer que les
travaux et fouilles de M. Formigé aboutiront à un
plan d'ensemble d'Arles antique que l'on n'a ja-
mais possédé.
M. Mirot fait uno communication sur des docu-
ments signalant des révocations de sceaux à la fin
du xiv* siècle. La perte ou le vol d'un sceau en-
traînait sa suppression ou sa modification. Le
sceau de la Ville de Paris perdu en 1417 fut mo-
difié ; on le retrouve à partir de 1424.
CHRONIQUE MUSICALE
Théâtre National de l'Opéra-Comique : La
Sorcière, drame musical en quatre actes et cinq
tableaux, d'après Victorien Sardou, poème de
M. André Sardou, musiquî de M. Camille
Erlanger.
Je rapporte de La Sorcière une impression con-