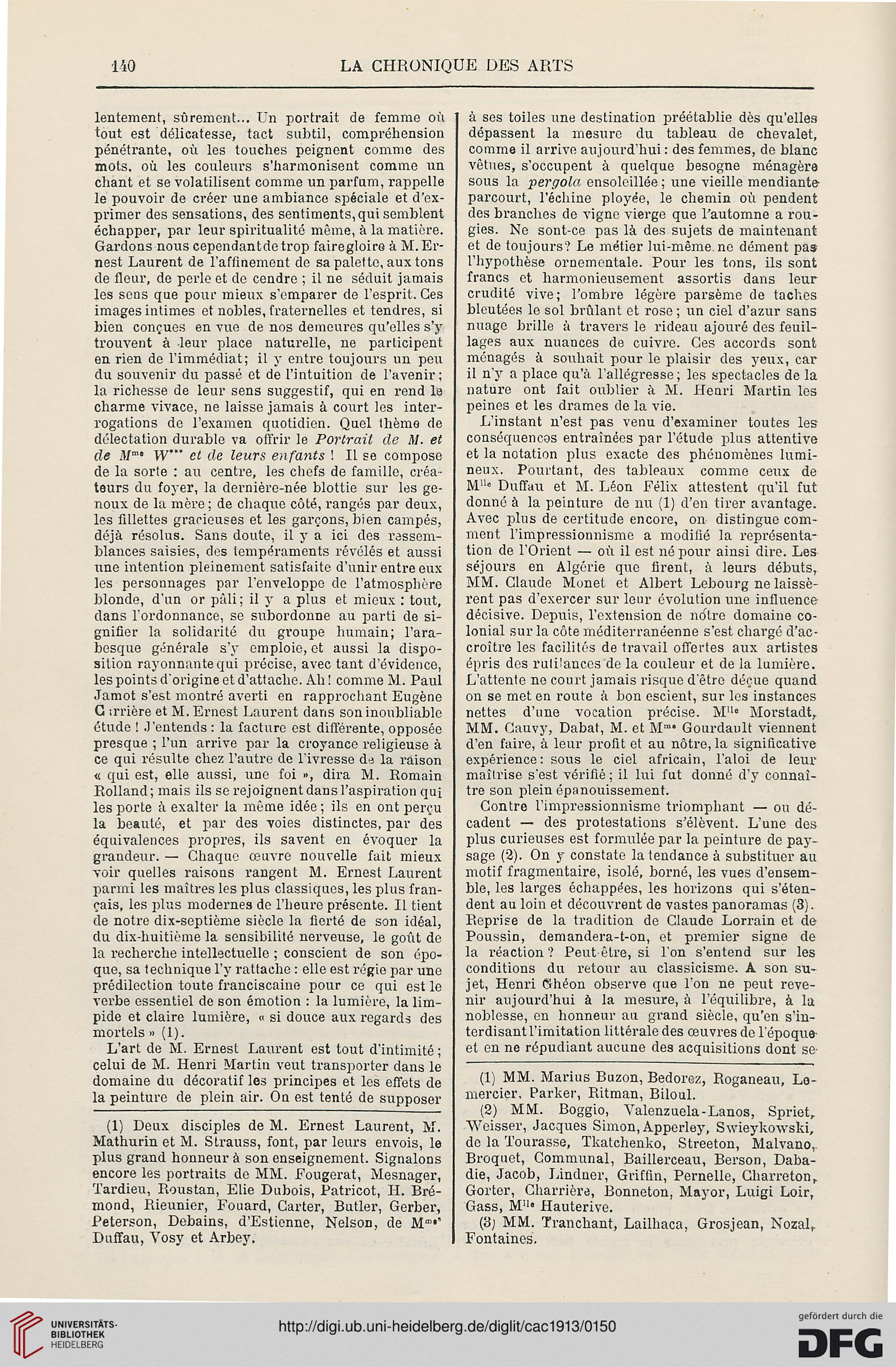110
LA CHRONIQUE DES ARTS
lentement, sûrement... Un portrait de femme où
tout est délicatesse, tact subtil, compréhension
pénétrante, où les touches peignent comme des
mots, où les couleurs s'harmonisent comme un
chant et se volatilisent comme un parfum, rappelle
le pouvoir de créer une ambiance spéciale et d'ex-
primer des sensations, des sentiments,qui semblent
échapper, par leur spiritualité même, à la matière.
Gardons nous cependantdetrop fairegloire à M.Er-
nest Laurent de raffinement de sa palette, aux tons
de fleur, de perle et de cendre ; il ne séduit jamais
les sons que pour mieux s'emparer de l'esprit. Ces
images intimes et nobles, fraternelles et tendres, si
bien conçues en vue de nos demeures qu'elles s'y
trouvent à leur place naturelle, ne participent
en rien de l'immédiat; il y entre toujours un peu
du souvenir du passé et de l'intuition de l'avenir;
la richesse de leur sens suggestif, qui en rend le
charme vivace, ne laisse jamais à court les inter-
rogations do l'examen quotidien. Quel thème de
délectation durable va offrir le Portrait de M. et
de il/"" W" et de leurs enfants ! Il se compose
de la sorte : au centre, les chefs de famille, créa-
teurs du foyer, la dernière-née blottie sur les ge-
noux de la mère; de chaque côté, rangés par deux,
les fillettes gracieuses et les garçons, bien campés,
déjà résolus. Sans doute, il y a ici des ressem-
blances saisies, des tempéraments révélés et aussi
une intention pleinement satisfaite d'unir entre eux
les personnages par l'enveloppe de l'atmosphère
blonde, d'un or pâli; il y a plus et mieux : tout,
dans l'ordonnance, se subordonne au parti de si-
gnifier la solidarité du groupe humain; l'ara-
besque générale s'y emploie, et aussi la dispo-
sition rayonnante qui précise, avec tant d'évidence,
les points d'origine et d'attache. Ah ! comme M. Paul
Jamot s'est montré averti en rapprochant Eugène
G irrière et M. Ernest Laurent dans son inoubliable
étude ! .l'entends : la facture est différente, opposée
presque ; l'un arrive par la croyance religieuse à
ce qui résulte chez l'autre de l'ivresse d< la raison
« qui est, elle aussi, une foi », dira M. Romain
Rolland ; mais ils se rejoignent dans l'aspiration qui
les porte à exalter la même idée ; ils en ont perçu
la beauté, et par des voies distinctes, par des
équivalences propres, ils savent en évoquer la
grandeur. — Chaque œuvre nouvelle fait mieux
voir quelles raisons rangent M. Ernest Laurent
parmi les maîtres les plus classiques, les plus fran-
çais, les plus modernes de l'heure présente. Il tient
de notre dix-septième siècle la fierté de son idéal,
du dix-huitième la sensibilité nerveuse, le goût de
la recherche intellectuelle ; conscient de son épo-
que, sa technique l'y rattache : elle est régie par une
prédilection toute franciscaine pour ce qui est le
verbe essentiel de son émotion : la lumière, la lim-
pide et claire lumière, « si douce aux regards des
mortels » (1).
L'art de M. Ernest Laurent est tout d'intimité ;
celui de M. Henri Martin veut transporter dans le
domaine du décoratif les principes et les effets de
la peinture de plein air. On est tenté de supposer
(1) Deux disciples de M. Ernest Laurent, M.
Mathurin et M. Strauss, font, par leurs envois, le
plus grand honneur à son enseignement. Signalons
encore les portraits de MM. Fougerat, Mesnager,
ïardieu, Roustan, Elie Dubois, Patricot, H. Bré-
mond, Rieunier, Fouard, Carter, Butler, Gerber,
Peterson, Debains, d'Estienne, Nelson, de M""'
Duffau, Vosy et Arbey.
à ses toiles une destination préétablie dès qu'elles
dépassent la mesure du tableau de chevalet,
comme il arrive aujourd'hui : des femmes, do blanc
vêtues, s'occupent à quelque besogne ménagère
sous la pergola ensoleillée ; une vieille mendiante
parcourt, l'échiné ployéo, le chemin où pendent
dos branches do vigne vierge que l'automne a rou-
gies. Ne sont-ce pas là des sujets de maintenant
et de toujours? Le métier lui-même.no dément pas
l'hypothèse ornementale. Pour les tons, ils sont
francs et harmonieusement assortis dans leur
crudité vive ; l'ombre légère parsème de taches
bleutées le sol brûlant et rose; un ciel d'azur sans
nuage brille à travers le rideau ajouré des feuil-
lages aux nuances de cuivre. Ces accords sont
ménagés à souhait pour le plaisir des yeux, car
il n'y a place qu'à l'allégresse; les spectacles de la
nature ont fait oublier à M. Henri Martin les
peines et les drames de la vie.
L'instant n'est pas venu d'examiner toutes les
conséquences entraînées par l'étude plus attentive
et la notation plus exacte des phénomènes lumi-
neux. Pourtant, des tableaux comme ceux de
M11" Duffau et M. Léon Félix attestent qu'il fut
donné à la peinture de nu (1) d'en tirer avantage.
Avec plus de certitude encore, on distinguo com-
ment l'impressionnisme a modifié la représenta-
tion de l'Orient — où il est né pour ainsi dire. Les
séjours en Algérie que firent, à leurs débuts,
MM. Claude Monet et Albert Lebourg ne laissè-
rent pas d'exercer sur leur évolution une influence
décisive. Depuis, l'extension de notre domaine co-
lonial sur la côte méditerranéenne s'est chargé d'ac-
croître les facilités de travail offertes aux artistes
épris dos rulilances'de la couleur et de la lumière.
L'attente no court jamais risque d'être déçue quand
on se met en route à bon escient, sur les instances
nettes d'une vocation précise. M"» Morstadt,
MM. Cauvy, Dabat, M. et M™* Gourdault viennent
d'en faire, à leur profit et au nôtre, la significative
expérience: sous le ciel africain, l'aloi de leur
maîtrise s'est vérifié ; il lui fut donné d'y connaî-
tre son plein épanouissement.
Contre l'impressionnisme triomphant — ou dé-
cadent — des protestations s'élèvent. L'une des
plus curieuses est formulée par la peinture de pay-
sage (2). On y constate la tendance à substituer au
motif fragmentaire, isolé, borné, les vues d'ensem-
ble, les larges échappées, les horizons qui s'éten-
dent au loin et découvrent de vastes panoramas (3).
Reprise de la tradition de Claude Lorrain et de
Poussin, demandera-t-on, et premier signe de
la réaction? Peut être, si l'on s'entend sur les
conditions du retour au classicisme. A son su-
jet, Henri (Shéon observe que l'on ne peut reve-
nir aujourd'hui à la mesure, à l'équilibre, à la
noblesse, on honneur au grand siècle, qu'en s'in-
tordisant l'imitation littérale des œuvres de l'époque
et en ne répudiant aucune des acquisitions dont se
(1) MM. Marius Buzon, Bedorez, Roganeau, Le-
mercier. Parker, Ritman, Biloul.
(2) MM. Boggio, Valenzuela-Lanos, Spriet,
Weisser, Jacques Simon, Apperley, Swieykowski,
do la Tourasse, Tkatchenko, Streeton, Malvano,.
Broquet, Communal, Baillerceau, Berson, Daba-
die, Jacob, Lindner, Griffin, Pernelle, Charreton,
Gorter, Charrière, Bonneton, Mayor, Luigi Loir,
Gass, M"' Hauterive.
(3j MM. Tranchant, Lailhaca, Grosjean, Nozal,
Fontaines.
LA CHRONIQUE DES ARTS
lentement, sûrement... Un portrait de femme où
tout est délicatesse, tact subtil, compréhension
pénétrante, où les touches peignent comme des
mots, où les couleurs s'harmonisent comme un
chant et se volatilisent comme un parfum, rappelle
le pouvoir de créer une ambiance spéciale et d'ex-
primer des sensations, des sentiments,qui semblent
échapper, par leur spiritualité même, à la matière.
Gardons nous cependantdetrop fairegloire à M.Er-
nest Laurent de raffinement de sa palette, aux tons
de fleur, de perle et de cendre ; il ne séduit jamais
les sons que pour mieux s'emparer de l'esprit. Ces
images intimes et nobles, fraternelles et tendres, si
bien conçues en vue de nos demeures qu'elles s'y
trouvent à leur place naturelle, ne participent
en rien de l'immédiat; il y entre toujours un peu
du souvenir du passé et de l'intuition de l'avenir;
la richesse de leur sens suggestif, qui en rend le
charme vivace, ne laisse jamais à court les inter-
rogations do l'examen quotidien. Quel thème de
délectation durable va offrir le Portrait de M. et
de il/"" W" et de leurs enfants ! Il se compose
de la sorte : au centre, les chefs de famille, créa-
teurs du foyer, la dernière-née blottie sur les ge-
noux de la mère; de chaque côté, rangés par deux,
les fillettes gracieuses et les garçons, bien campés,
déjà résolus. Sans doute, il y a ici des ressem-
blances saisies, des tempéraments révélés et aussi
une intention pleinement satisfaite d'unir entre eux
les personnages par l'enveloppe de l'atmosphère
blonde, d'un or pâli; il y a plus et mieux : tout,
dans l'ordonnance, se subordonne au parti de si-
gnifier la solidarité du groupe humain; l'ara-
besque générale s'y emploie, et aussi la dispo-
sition rayonnante qui précise, avec tant d'évidence,
les points d'origine et d'attache. Ah ! comme M. Paul
Jamot s'est montré averti en rapprochant Eugène
G irrière et M. Ernest Laurent dans son inoubliable
étude ! .l'entends : la facture est différente, opposée
presque ; l'un arrive par la croyance religieuse à
ce qui résulte chez l'autre de l'ivresse d< la raison
« qui est, elle aussi, une foi », dira M. Romain
Rolland ; mais ils se rejoignent dans l'aspiration qui
les porte à exalter la même idée ; ils en ont perçu
la beauté, et par des voies distinctes, par des
équivalences propres, ils savent en évoquer la
grandeur. — Chaque œuvre nouvelle fait mieux
voir quelles raisons rangent M. Ernest Laurent
parmi les maîtres les plus classiques, les plus fran-
çais, les plus modernes de l'heure présente. Il tient
de notre dix-septième siècle la fierté de son idéal,
du dix-huitième la sensibilité nerveuse, le goût de
la recherche intellectuelle ; conscient de son épo-
que, sa technique l'y rattache : elle est régie par une
prédilection toute franciscaine pour ce qui est le
verbe essentiel de son émotion : la lumière, la lim-
pide et claire lumière, « si douce aux regards des
mortels » (1).
L'art de M. Ernest Laurent est tout d'intimité ;
celui de M. Henri Martin veut transporter dans le
domaine du décoratif les principes et les effets de
la peinture de plein air. On est tenté de supposer
(1) Deux disciples de M. Ernest Laurent, M.
Mathurin et M. Strauss, font, par leurs envois, le
plus grand honneur à son enseignement. Signalons
encore les portraits de MM. Fougerat, Mesnager,
ïardieu, Roustan, Elie Dubois, Patricot, H. Bré-
mond, Rieunier, Fouard, Carter, Butler, Gerber,
Peterson, Debains, d'Estienne, Nelson, de M""'
Duffau, Vosy et Arbey.
à ses toiles une destination préétablie dès qu'elles
dépassent la mesure du tableau de chevalet,
comme il arrive aujourd'hui : des femmes, do blanc
vêtues, s'occupent à quelque besogne ménagère
sous la pergola ensoleillée ; une vieille mendiante
parcourt, l'échiné ployéo, le chemin où pendent
dos branches do vigne vierge que l'automne a rou-
gies. Ne sont-ce pas là des sujets de maintenant
et de toujours? Le métier lui-même.no dément pas
l'hypothèse ornementale. Pour les tons, ils sont
francs et harmonieusement assortis dans leur
crudité vive ; l'ombre légère parsème de taches
bleutées le sol brûlant et rose; un ciel d'azur sans
nuage brille à travers le rideau ajouré des feuil-
lages aux nuances de cuivre. Ces accords sont
ménagés à souhait pour le plaisir des yeux, car
il n'y a place qu'à l'allégresse; les spectacles de la
nature ont fait oublier à M. Henri Martin les
peines et les drames de la vie.
L'instant n'est pas venu d'examiner toutes les
conséquences entraînées par l'étude plus attentive
et la notation plus exacte des phénomènes lumi-
neux. Pourtant, des tableaux comme ceux de
M11" Duffau et M. Léon Félix attestent qu'il fut
donné à la peinture de nu (1) d'en tirer avantage.
Avec plus de certitude encore, on distinguo com-
ment l'impressionnisme a modifié la représenta-
tion de l'Orient — où il est né pour ainsi dire. Les
séjours en Algérie que firent, à leurs débuts,
MM. Claude Monet et Albert Lebourg ne laissè-
rent pas d'exercer sur leur évolution une influence
décisive. Depuis, l'extension de notre domaine co-
lonial sur la côte méditerranéenne s'est chargé d'ac-
croître les facilités de travail offertes aux artistes
épris dos rulilances'de la couleur et de la lumière.
L'attente no court jamais risque d'être déçue quand
on se met en route à bon escient, sur les instances
nettes d'une vocation précise. M"» Morstadt,
MM. Cauvy, Dabat, M. et M™* Gourdault viennent
d'en faire, à leur profit et au nôtre, la significative
expérience: sous le ciel africain, l'aloi de leur
maîtrise s'est vérifié ; il lui fut donné d'y connaî-
tre son plein épanouissement.
Contre l'impressionnisme triomphant — ou dé-
cadent — des protestations s'élèvent. L'une des
plus curieuses est formulée par la peinture de pay-
sage (2). On y constate la tendance à substituer au
motif fragmentaire, isolé, borné, les vues d'ensem-
ble, les larges échappées, les horizons qui s'éten-
dent au loin et découvrent de vastes panoramas (3).
Reprise de la tradition de Claude Lorrain et de
Poussin, demandera-t-on, et premier signe de
la réaction? Peut être, si l'on s'entend sur les
conditions du retour au classicisme. A son su-
jet, Henri (Shéon observe que l'on ne peut reve-
nir aujourd'hui à la mesure, à l'équilibre, à la
noblesse, on honneur au grand siècle, qu'en s'in-
tordisant l'imitation littérale des œuvres de l'époque
et en ne répudiant aucune des acquisitions dont se
(1) MM. Marius Buzon, Bedorez, Roganeau, Le-
mercier. Parker, Ritman, Biloul.
(2) MM. Boggio, Valenzuela-Lanos, Spriet,
Weisser, Jacques Simon, Apperley, Swieykowski,
do la Tourasse, Tkatchenko, Streeton, Malvano,.
Broquet, Communal, Baillerceau, Berson, Daba-
die, Jacob, Lindner, Griffin, Pernelle, Charreton,
Gorter, Charrière, Bonneton, Mayor, Luigi Loir,
Gass, M"' Hauterive.
(3j MM. Tranchant, Lailhaca, Grosjean, Nozal,
Fontaines.