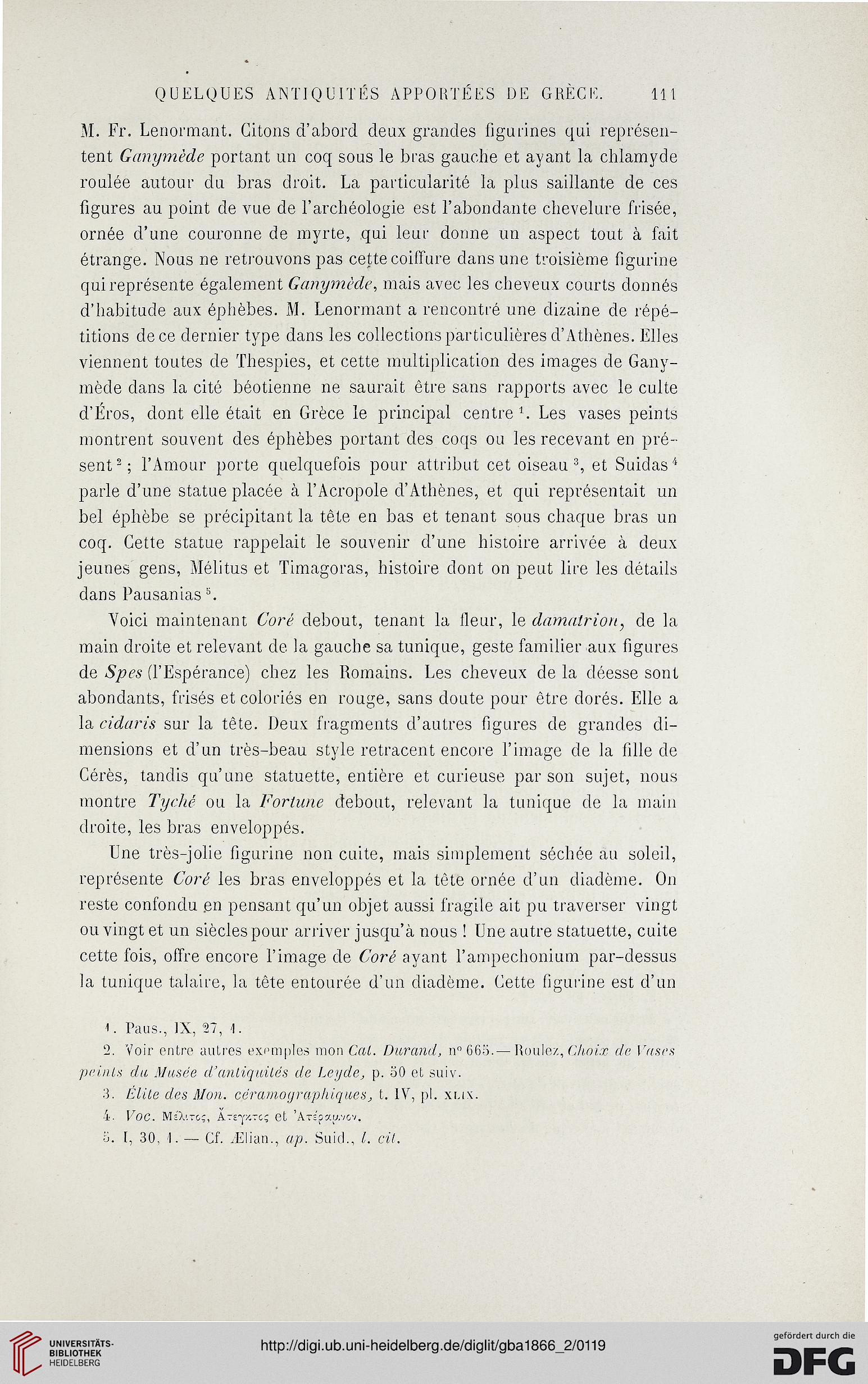QUELQUES ANTIQUITÉS APPORTÉES DE GRÈCE.
111
M. Fr. Lenormant. Citons cl’abord deux grandes figurines qui représen-
tent Ganymède portant un coq sous le bras gauche et ayant la chlamyde
roulée autour du bras droit. La particularité la plus saillante de ces
figures au point de vue de l’archéologie est l’abondante chevelure frisée,
ornée d’une couronne de myrte, qui leur donne un aspect tout à fait
étrange. Nous ne retrouvons pas cette coiffure dans une troisième figurine
qui représente également Ganymède, mais avec les cheveux courts donnés
d’habitude aux éphèbes. M. Lenormant a rencontré une dizaine de répé-
titions de ce dernier type dans les collections particulières d’Athènes. Elles
viennent toutes de Thespies, et cette multiplication des images de Gany-
mède dans la cité béotienne ne saurait être sans rapports avec le culte
d’Éros, dont elle était en Grèce le principal centre b Les vases peints
montrent souvent des éphèbes portant des coqs ou les recevant en pré-
sent1 2; l’Amour porte quelquefois pour attribut cet oiseau3, et Suidas4
parle d’une statue placée à l’Acropole d’Athènes, et qui représentait un
bel éphèbe se précipitant la tête en bas et tenant sous chaque bras un
coq. Cette statue rappelait le souvenir d’une histoire arrivée à deux
jeunes gens, Mélitus et Timagoras, histoire dont on peut lire les détails
dans Pausanias5.
Voici maintenant Corè debout, tenant la fleur, le damatrion, de la
main droite et relevant de la gauche sa tunique, geste familier aux figures
de Spes (l’Espérance) chez les Romains. Les cheveux de la déesse sont
abondants, frisés et coloriés en rouge, sans doute pour être dorés. Elle a
la cidaris sur la tête. Deux fragments d’autres figures de grandes di-
mensions et d’un très-beau style retracent encore l’image de la fille de
Cérès, tandis qu’une statuette, entière et curieuse par son sujet, nous
montre Tyché ou la Fortune debout, relevant la tunique de la main
droite, les bras enveloppés.
Une très-jolie figurine non cuite, mais simplement séchée au soleil,
représente Corè les bras enveloppés et la tête ornée d’un diadème. On
reste confondu .en pensant qu’un objet aussi fragile ait pu traverser vingt
ou vingt et un siècles pour arriver jusqu’à nous ! Une autre statuette, cuite
cette fois, offre encore l’image de Corè ayant l’ampechonium par-dessus
la tunique talaire, la tête entourée d’un diadème. Cette figurine est d’un
1. Paus., IX, 27, 1.
2. Voir entre autres exemples mon Cal. Durand, n° 665.— Roulez, Choix de Vases
peints du DIasëe d’antiquités de Leyde, p. 50 et suiv.
3. Élite des Mon. cérarnographi.ques, t. IV, pi. xu\.
4. Voc. MsÀ'.t&ç, ÂT£-poTc; et ’Arspaij.'/cv.
5. fi 30. \. — Cf. Ælian., ap. Suid., I. cil.
111
M. Fr. Lenormant. Citons cl’abord deux grandes figurines qui représen-
tent Ganymède portant un coq sous le bras gauche et ayant la chlamyde
roulée autour du bras droit. La particularité la plus saillante de ces
figures au point de vue de l’archéologie est l’abondante chevelure frisée,
ornée d’une couronne de myrte, qui leur donne un aspect tout à fait
étrange. Nous ne retrouvons pas cette coiffure dans une troisième figurine
qui représente également Ganymède, mais avec les cheveux courts donnés
d’habitude aux éphèbes. M. Lenormant a rencontré une dizaine de répé-
titions de ce dernier type dans les collections particulières d’Athènes. Elles
viennent toutes de Thespies, et cette multiplication des images de Gany-
mède dans la cité béotienne ne saurait être sans rapports avec le culte
d’Éros, dont elle était en Grèce le principal centre b Les vases peints
montrent souvent des éphèbes portant des coqs ou les recevant en pré-
sent1 2; l’Amour porte quelquefois pour attribut cet oiseau3, et Suidas4
parle d’une statue placée à l’Acropole d’Athènes, et qui représentait un
bel éphèbe se précipitant la tête en bas et tenant sous chaque bras un
coq. Cette statue rappelait le souvenir d’une histoire arrivée à deux
jeunes gens, Mélitus et Timagoras, histoire dont on peut lire les détails
dans Pausanias5.
Voici maintenant Corè debout, tenant la fleur, le damatrion, de la
main droite et relevant de la gauche sa tunique, geste familier aux figures
de Spes (l’Espérance) chez les Romains. Les cheveux de la déesse sont
abondants, frisés et coloriés en rouge, sans doute pour être dorés. Elle a
la cidaris sur la tête. Deux fragments d’autres figures de grandes di-
mensions et d’un très-beau style retracent encore l’image de la fille de
Cérès, tandis qu’une statuette, entière et curieuse par son sujet, nous
montre Tyché ou la Fortune debout, relevant la tunique de la main
droite, les bras enveloppés.
Une très-jolie figurine non cuite, mais simplement séchée au soleil,
représente Corè les bras enveloppés et la tête ornée d’un diadème. On
reste confondu .en pensant qu’un objet aussi fragile ait pu traverser vingt
ou vingt et un siècles pour arriver jusqu’à nous ! Une autre statuette, cuite
cette fois, offre encore l’image de Corè ayant l’ampechonium par-dessus
la tunique talaire, la tête entourée d’un diadème. Cette figurine est d’un
1. Paus., IX, 27, 1.
2. Voir entre autres exemples mon Cal. Durand, n° 665.— Roulez, Choix de Vases
peints du DIasëe d’antiquités de Leyde, p. 50 et suiv.
3. Élite des Mon. cérarnographi.ques, t. IV, pi. xu\.
4. Voc. MsÀ'.t&ç, ÂT£-poTc; et ’Arspaij.'/cv.
5. fi 30. \. — Cf. Ælian., ap. Suid., I. cil.