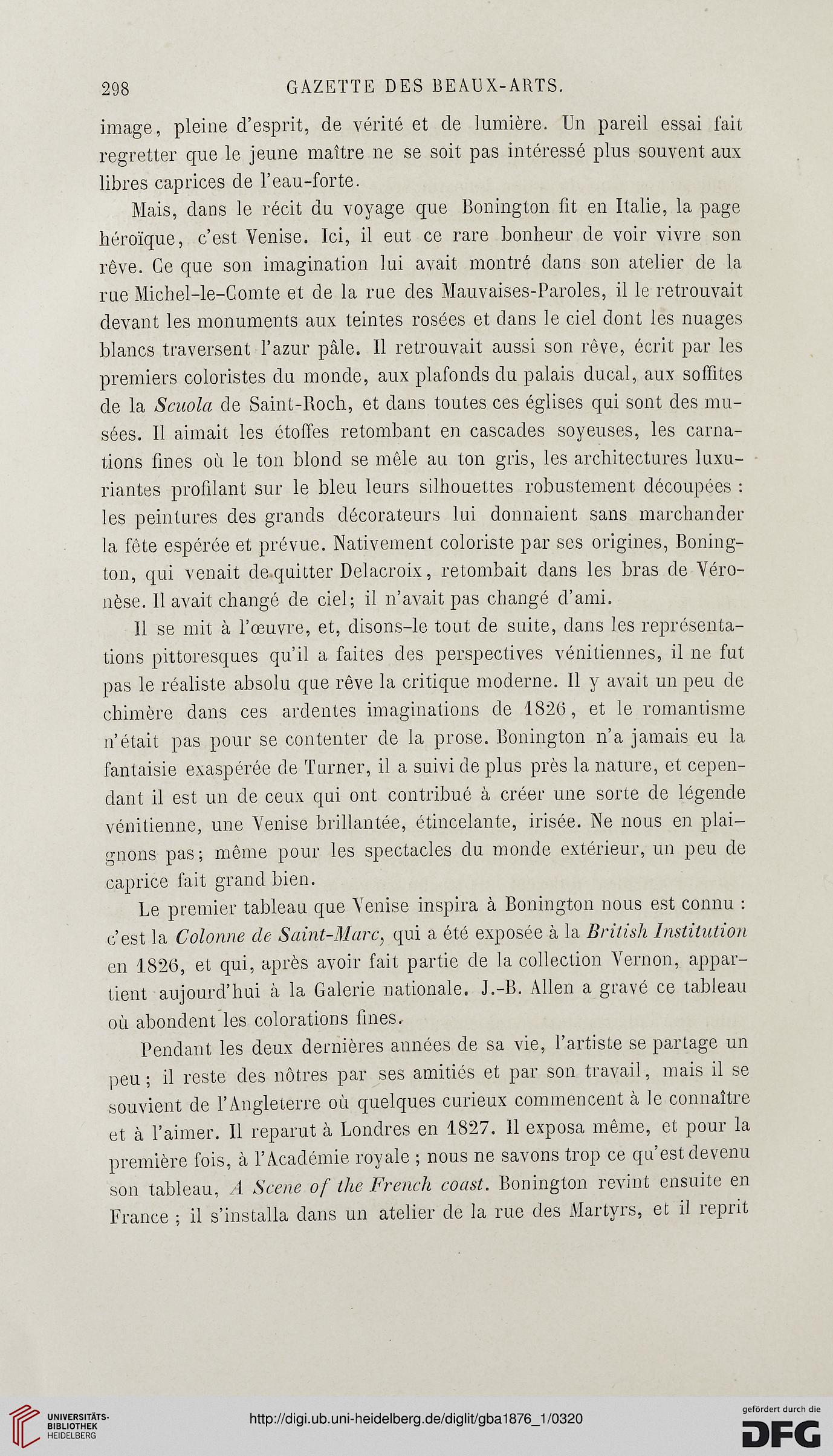298
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
image, pleine d’esprit, de vérité et de lumière. Un pareil essai fait
regretter que le jeune maître ne se soit pas intéressé plus souvent aux
libres caprices de l’eau-forte.
Mais, dans le récit du voyage que Bonington fit en Italie, la page
héroïque, c’est Venise. Ici, il eut ce rare bonheur de voir vivre son
rêve. Ce que son imagination lui avait montré dans son atelier de la
rue Michel-le-Comte et de la rue des Mauvaises-Paroles, il le retrouvait
devant les monuments aux teintes rosées et dans le ciel dont les nuages
blancs traversent l’azur pâle. 11 retrouvait aussi son rêve, écrit par les
premiers coloristes du monde, aux plafonds du palais ducal, aux soffites
de la Scuola de Saint-Roch, et dans toutes ces églises qui sont des mu-
sées. Il aimait les étoffes retombant en cascades soyeuses, les carna-
tions fines où le ton blond se mêle au ton gris, les architectures luxu-
riantes profilant sur le bleu leurs silhouettes robustement découpées :
les peintures des grands décorateurs lui donnaient sans marchander
la fête espérée et prévue. Nativement coloriste par ses origines, Boning-
ton, qui venait de.quitter Delacroix, retombait dans les bras de Véro-
nèse. 11 avait changé de ciel; il n’avait pas changé d’ami.
11 se mit à l’œuvre, et, disons-le tout de suite, dans les représenta-
tions pittoresques qu’il a faites des perspectives vénitiennes, il ne fut
pas le réaliste absolu que rêve la critique moderne. Il y avait un peu de
chimère dans ces ardentes imaginations de 1826, et le romantisme
n’était pas pour se contenter de la prose. Bonington n’a jamais eu la
fantaisie exaspérée de Turner, il a suivi de plus près la nature, et cepen-
dant il est un de ceux qui ont contribué à créer une sorte de légende
vénitienne, une Venise brillantée, étincelante, irisée. Ne nous en plai-
gnons pas; même pour les spectacles du monde extérieur, un peu de
caprice fait grand bien.
Le premier tableau que Venise inspira à Bonington nous est connu :
c’est la Colonne de Saint-Marc, qui a été exposée à la British Institution
en 1826, et qui, après avoir fait partie de la collection Vernon, appar-
tient aujourd’hui à la Galerie nationale. J.-B. Allen a gravé ce tableau
où abondent les colorations fines.
Rendant les deux dernières années de sa vie, l’artiste se partage un
peu ; il reste des nôtres par ses amitiés et par son travail, mais il se
souvient de l’Angleterre où quelques curieux commencent à le connaître
et à l’aimer. 11 reparut à Londres en 1827. 11 exposa même, et pour la
première fois, à l’Académie royale ; nous ne savons trop ce qu’est devenu
son tableau, A Scene of tlie French coast. Bonington revint ensuite en
France ; il s’installa dans un atelier de la rue des Martyrs, et il reprit
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
image, pleine d’esprit, de vérité et de lumière. Un pareil essai fait
regretter que le jeune maître ne se soit pas intéressé plus souvent aux
libres caprices de l’eau-forte.
Mais, dans le récit du voyage que Bonington fit en Italie, la page
héroïque, c’est Venise. Ici, il eut ce rare bonheur de voir vivre son
rêve. Ce que son imagination lui avait montré dans son atelier de la
rue Michel-le-Comte et de la rue des Mauvaises-Paroles, il le retrouvait
devant les monuments aux teintes rosées et dans le ciel dont les nuages
blancs traversent l’azur pâle. 11 retrouvait aussi son rêve, écrit par les
premiers coloristes du monde, aux plafonds du palais ducal, aux soffites
de la Scuola de Saint-Roch, et dans toutes ces églises qui sont des mu-
sées. Il aimait les étoffes retombant en cascades soyeuses, les carna-
tions fines où le ton blond se mêle au ton gris, les architectures luxu-
riantes profilant sur le bleu leurs silhouettes robustement découpées :
les peintures des grands décorateurs lui donnaient sans marchander
la fête espérée et prévue. Nativement coloriste par ses origines, Boning-
ton, qui venait de.quitter Delacroix, retombait dans les bras de Véro-
nèse. 11 avait changé de ciel; il n’avait pas changé d’ami.
11 se mit à l’œuvre, et, disons-le tout de suite, dans les représenta-
tions pittoresques qu’il a faites des perspectives vénitiennes, il ne fut
pas le réaliste absolu que rêve la critique moderne. Il y avait un peu de
chimère dans ces ardentes imaginations de 1826, et le romantisme
n’était pas pour se contenter de la prose. Bonington n’a jamais eu la
fantaisie exaspérée de Turner, il a suivi de plus près la nature, et cepen-
dant il est un de ceux qui ont contribué à créer une sorte de légende
vénitienne, une Venise brillantée, étincelante, irisée. Ne nous en plai-
gnons pas; même pour les spectacles du monde extérieur, un peu de
caprice fait grand bien.
Le premier tableau que Venise inspira à Bonington nous est connu :
c’est la Colonne de Saint-Marc, qui a été exposée à la British Institution
en 1826, et qui, après avoir fait partie de la collection Vernon, appar-
tient aujourd’hui à la Galerie nationale. J.-B. Allen a gravé ce tableau
où abondent les colorations fines.
Rendant les deux dernières années de sa vie, l’artiste se partage un
peu ; il reste des nôtres par ses amitiés et par son travail, mais il se
souvient de l’Angleterre où quelques curieux commencent à le connaître
et à l’aimer. 11 reparut à Londres en 1827. 11 exposa même, et pour la
première fois, à l’Académie royale ; nous ne savons trop ce qu’est devenu
son tableau, A Scene of tlie French coast. Bonington revint ensuite en
France ; il s’installa dans un atelier de la rue des Martyrs, et il reprit