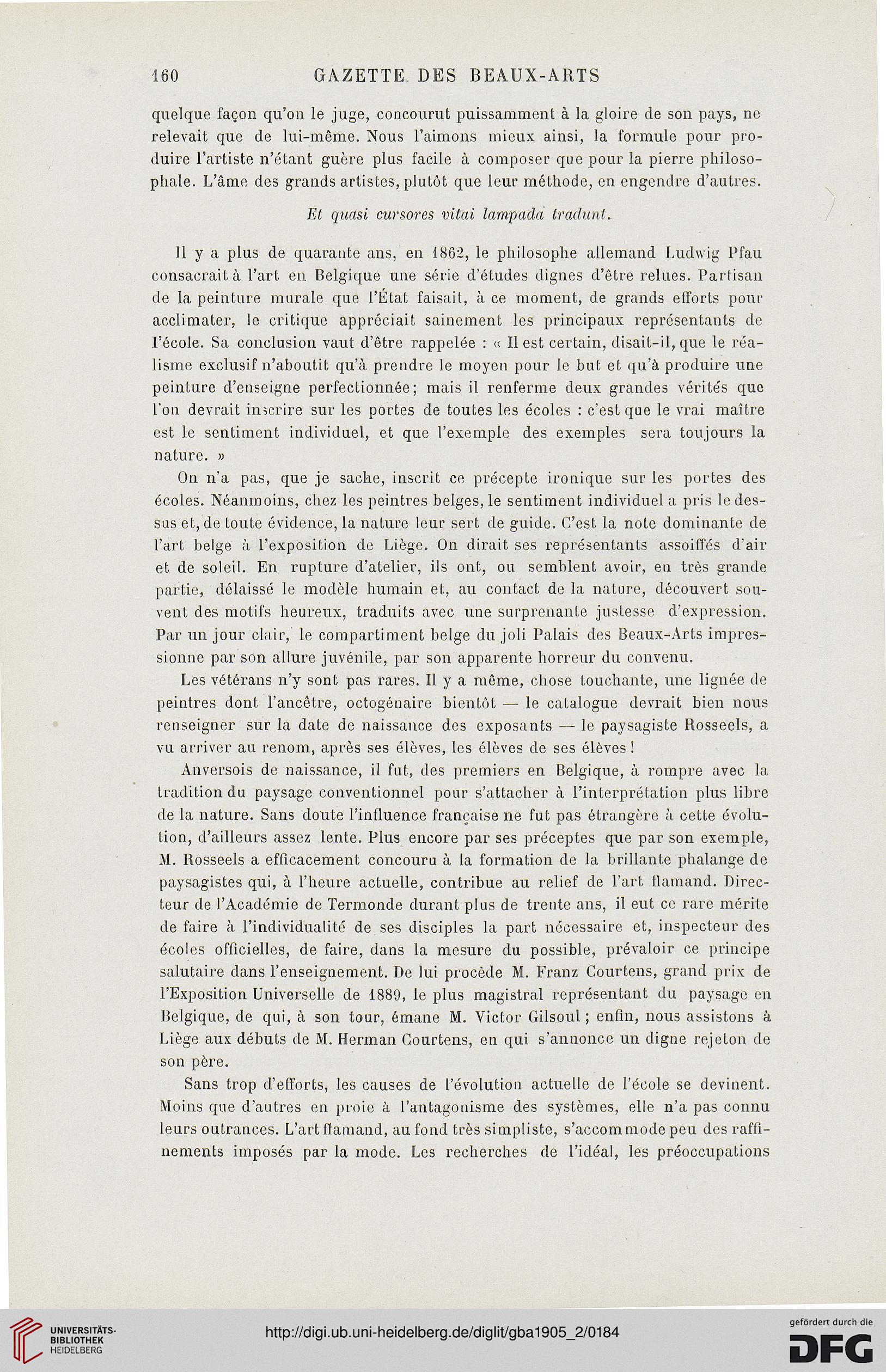160
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
quelque façon qu’on le juge, concourut puissamment à la gloire de son pays, ne
relevait que de lui-même. Nous l’aimons mieux ainsi, la formule pour pro-
duire l’artiste n’étant guère plus facile à composer que pour la pierre philoso-
phale. L’âme des grands artistes, plutôt que leur méthode, en engendre d’autres.
Et quasi cursores vitai lampadd tradmit.
Il y a plus de quarante ans, en 1862, le philosophe allemand Ludwig Pfau
consacrait à l’art en Belgique une série d'études dignes d’être relues. Partisan
de la peinture murale que l’Etat faisait, à ce moment, de grands efforts pour
acclimater, le critique appréciait sainement les principaux représentants de
l’école. Sa conclusion vaut d’être rappelée : « Il est certain, disait-il, que le réa-
lisme exclusif n’aboutit qu’à prendre le moyen pour le but et qu’à produire une
peinture d’enseigne perfectionnée; mais il renferme deux grandes vérités que
l’on devrait inscrire sur les portes de toutes les écoles : c’est que le vrai maître
est le sentiment individuel, et que l’exemple des exemples sera toujours la
nature. »
On n'a pas, que je sache, inscrit ce précepte ironique sur les portes des
écoles. Néanmoins, chez les peintres belges, le sentiment individuel a pris le des-
sus et, de toute évidence, la nature leur sert de guide. C’est la note dominante de
l’art belge à l’exposition de Liège. On dirait ses représentants assoiffés d'air
et de soleil. En rupture d’atelier, ils ont, ou semblent avoir, en très grande
partie, délaissé le modèle humain et, au contact de la nature, découvert sou-
vent des motifs heureux, traduits avec une surprenante justesse d'expression.
Par un jour clair, le compartiment belge du joli Palais des Beaux-Arts impres-
sionne par son allure juvénile, par son apparente horreur du convenu.
Les vétérans n’y sont pas rares. Il y a même, chose louchante, une lignée de
peintres dont l’ancêtre, octogénaire bientôt — le catalogue devrait bien nous
renseigner sur la date de naissance des exposants — le paysagiste Rosseels, a
vu arriver au renom, après ses élèves, les élèves de ses élèves !
Anversois de naissance, il fut, des premiers en Belgique, à rompre avec la
tradition du paysage conventionnel pour s’attacher à l’interprétation plus libre
de la nature. Sans doute l’influence française ne fut pas étrangère à cette évolu-
tion, d’ailleurs assez lente. Plus encore par ses préceptes que par son exemple,
M. Rosseels a efficacement concouru à la formation de la brillante phalange de
paysagistes qui, à l’heure actuelle, contribue au relief de l’art flamand. Direc-
teur de l’Académie de Termonde durant plus de trente ans, il eut ce rare mérite
de faire à l’individualité de ses disciples la part nécessaire et, inspecteur des
écoles officielles, de faire, dans la mesure du possible, prévaloir ce principe
salutaire dans l’enseignement. De lui procède M. Franz Courtens, grand prix de
l’Exposition Universelle de 1889, le plus magistral représentant du paysage en
Belgique, de qui, à son tour, émane M. Victor Gilsoul ; enfin, nous assistons à
Liège aux débuts de M. Herman Courtens, eu qui s’annonce un digne rejeton de
son père.
Sans trop d’efforts, les causes de l’évolution actuelle de l’école se devinent.
Moins que d’autres en proie à l’antagonisme des systèmes, elle n’a pas connu
leurs outrances. L’art flamand, au fond très simpliste, s’accom mode peu des raffi-
nements imposés par la mode. Les recherches de l’idéal, les préoccupations
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
quelque façon qu’on le juge, concourut puissamment à la gloire de son pays, ne
relevait que de lui-même. Nous l’aimons mieux ainsi, la formule pour pro-
duire l’artiste n’étant guère plus facile à composer que pour la pierre philoso-
phale. L’âme des grands artistes, plutôt que leur méthode, en engendre d’autres.
Et quasi cursores vitai lampadd tradmit.
Il y a plus de quarante ans, en 1862, le philosophe allemand Ludwig Pfau
consacrait à l’art en Belgique une série d'études dignes d’être relues. Partisan
de la peinture murale que l’Etat faisait, à ce moment, de grands efforts pour
acclimater, le critique appréciait sainement les principaux représentants de
l’école. Sa conclusion vaut d’être rappelée : « Il est certain, disait-il, que le réa-
lisme exclusif n’aboutit qu’à prendre le moyen pour le but et qu’à produire une
peinture d’enseigne perfectionnée; mais il renferme deux grandes vérités que
l’on devrait inscrire sur les portes de toutes les écoles : c’est que le vrai maître
est le sentiment individuel, et que l’exemple des exemples sera toujours la
nature. »
On n'a pas, que je sache, inscrit ce précepte ironique sur les portes des
écoles. Néanmoins, chez les peintres belges, le sentiment individuel a pris le des-
sus et, de toute évidence, la nature leur sert de guide. C’est la note dominante de
l’art belge à l’exposition de Liège. On dirait ses représentants assoiffés d'air
et de soleil. En rupture d’atelier, ils ont, ou semblent avoir, en très grande
partie, délaissé le modèle humain et, au contact de la nature, découvert sou-
vent des motifs heureux, traduits avec une surprenante justesse d'expression.
Par un jour clair, le compartiment belge du joli Palais des Beaux-Arts impres-
sionne par son allure juvénile, par son apparente horreur du convenu.
Les vétérans n’y sont pas rares. Il y a même, chose louchante, une lignée de
peintres dont l’ancêtre, octogénaire bientôt — le catalogue devrait bien nous
renseigner sur la date de naissance des exposants — le paysagiste Rosseels, a
vu arriver au renom, après ses élèves, les élèves de ses élèves !
Anversois de naissance, il fut, des premiers en Belgique, à rompre avec la
tradition du paysage conventionnel pour s’attacher à l’interprétation plus libre
de la nature. Sans doute l’influence française ne fut pas étrangère à cette évolu-
tion, d’ailleurs assez lente. Plus encore par ses préceptes que par son exemple,
M. Rosseels a efficacement concouru à la formation de la brillante phalange de
paysagistes qui, à l’heure actuelle, contribue au relief de l’art flamand. Direc-
teur de l’Académie de Termonde durant plus de trente ans, il eut ce rare mérite
de faire à l’individualité de ses disciples la part nécessaire et, inspecteur des
écoles officielles, de faire, dans la mesure du possible, prévaloir ce principe
salutaire dans l’enseignement. De lui procède M. Franz Courtens, grand prix de
l’Exposition Universelle de 1889, le plus magistral représentant du paysage en
Belgique, de qui, à son tour, émane M. Victor Gilsoul ; enfin, nous assistons à
Liège aux débuts de M. Herman Courtens, eu qui s’annonce un digne rejeton de
son père.
Sans trop d’efforts, les causes de l’évolution actuelle de l’école se devinent.
Moins que d’autres en proie à l’antagonisme des systèmes, elle n’a pas connu
leurs outrances. L’art flamand, au fond très simpliste, s’accom mode peu des raffi-
nements imposés par la mode. Les recherches de l’idéal, les préoccupations