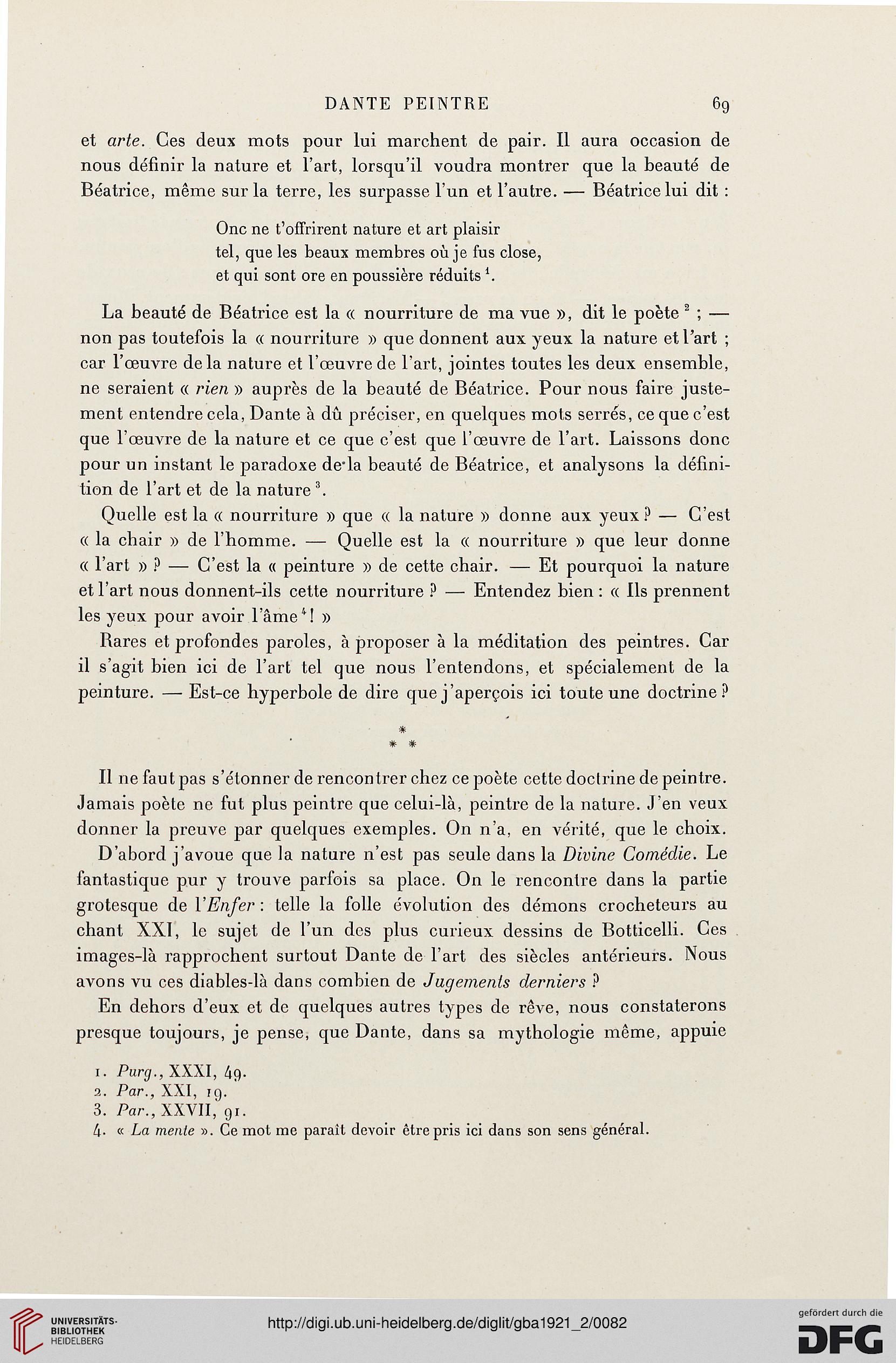DANTE PEINTRE
69
et arte. Ces deux mots pour lui marchent de pair. Il aura occasion de
nous définir la nature et l’art, lorsqu’il voudra montrer que la beauté de
Béatrice, même sur la terre, les surpasse l’un et l’autre. — Béatrice lui dit :
One ne t’offrirent nature et art plaisir
tel, que les beaux membres où je fus close,
et qui sont ore en poussière réduits *.
La beauté de Béatrice est la « nourriture de ma vue », dit le poète 2 ; —
non pas toutefois la « nourriture » que donnent aux yeux la nature et l’art ;
car l’œuvre delà nature et l’œuvre de l'art, jointes toutes les deux ensemble,
ne seraient « rien » auprès de la beauté de Béatrice. Pour nous faire juste-
ment entendre cela, Dante à dû préciser, en quelques mots serrés, ce que c’est
que l'œuvre de la nature et ce que c’est que l’œuvre de l’art. Laissons donc
pour un instant le paradoxe de1 la beauté de Béatrice, et analysons la défini-
tion de l’art et de la nature 3.
Quelle est la « nourriture » que « la nature » donne aux yeux ? — C’est
« la chair » de l’homme. — Quelle est la « nourriture » que leur donne
« l’art » ? — C’est la « peinture » de cette chair. — Et pourquoi la nature
et l’art nous donnent-ils cette nourriture ? — Entendez bien : « Ils prennent
les yeux pour avoir l’âme4 ! »
Rares et profondes paroles, à proposer à la méditation des peintres. Car
il s’agit bien ici de l’art tel que nous l’entendons, et spécialement de la
peinture. — Est-ce hyperbole de dire que j’aperçois ici toute une doctrine?
*
* *
Il ne faut pas s’étonner de rencontrer chez ce poète cette doctrine de peintre.
Jamais poète ne fut plus peintre que celui-là, peintre de la nature. J en veux
donner la preuve par quelques exemples. On n’a, en vérité, que le choix.
D’abord j'avoue que la nature n’est pas seule dans la Divine Comédie. Le
fantastique pur y trouve parfois sa place. On le rencontre dans la partie
grotesque de Y Enfer : telle la folle évolution des démons crocheteurs au
chant XXI, le sujet de l’un des plus curieux dessins de Botticelli. Ces
images-là rapprochent surtout Dante de l’art des siècles antérieurs. Nous
avons vu ces diables-là dans combien de Jugemenls derniers ?
En dehors d’eux et de quelques autres types de rêve, nous constaterons
presque toujours, je pense, que Dante, dans sa mythologie même, appuie
1. Purg., XXXI, 4<t-
2. Par., XXI, 1 g.
3. Par., XXVII,' 91.
4- « La mente ». Ce mot me parait devoir être pris ici dans son sens général.
69
et arte. Ces deux mots pour lui marchent de pair. Il aura occasion de
nous définir la nature et l’art, lorsqu’il voudra montrer que la beauté de
Béatrice, même sur la terre, les surpasse l’un et l’autre. — Béatrice lui dit :
One ne t’offrirent nature et art plaisir
tel, que les beaux membres où je fus close,
et qui sont ore en poussière réduits *.
La beauté de Béatrice est la « nourriture de ma vue », dit le poète 2 ; —
non pas toutefois la « nourriture » que donnent aux yeux la nature et l’art ;
car l’œuvre delà nature et l’œuvre de l'art, jointes toutes les deux ensemble,
ne seraient « rien » auprès de la beauté de Béatrice. Pour nous faire juste-
ment entendre cela, Dante à dû préciser, en quelques mots serrés, ce que c’est
que l'œuvre de la nature et ce que c’est que l’œuvre de l’art. Laissons donc
pour un instant le paradoxe de1 la beauté de Béatrice, et analysons la défini-
tion de l’art et de la nature 3.
Quelle est la « nourriture » que « la nature » donne aux yeux ? — C’est
« la chair » de l’homme. — Quelle est la « nourriture » que leur donne
« l’art » ? — C’est la « peinture » de cette chair. — Et pourquoi la nature
et l’art nous donnent-ils cette nourriture ? — Entendez bien : « Ils prennent
les yeux pour avoir l’âme4 ! »
Rares et profondes paroles, à proposer à la méditation des peintres. Car
il s’agit bien ici de l’art tel que nous l’entendons, et spécialement de la
peinture. — Est-ce hyperbole de dire que j’aperçois ici toute une doctrine?
*
* *
Il ne faut pas s’étonner de rencontrer chez ce poète cette doctrine de peintre.
Jamais poète ne fut plus peintre que celui-là, peintre de la nature. J en veux
donner la preuve par quelques exemples. On n’a, en vérité, que le choix.
D’abord j'avoue que la nature n’est pas seule dans la Divine Comédie. Le
fantastique pur y trouve parfois sa place. On le rencontre dans la partie
grotesque de Y Enfer : telle la folle évolution des démons crocheteurs au
chant XXI, le sujet de l’un des plus curieux dessins de Botticelli. Ces
images-là rapprochent surtout Dante de l’art des siècles antérieurs. Nous
avons vu ces diables-là dans combien de Jugemenls derniers ?
En dehors d’eux et de quelques autres types de rêve, nous constaterons
presque toujours, je pense, que Dante, dans sa mythologie même, appuie
1. Purg., XXXI, 4<t-
2. Par., XXI, 1 g.
3. Par., XXVII,' 91.
4- « La mente ». Ce mot me parait devoir être pris ici dans son sens général.