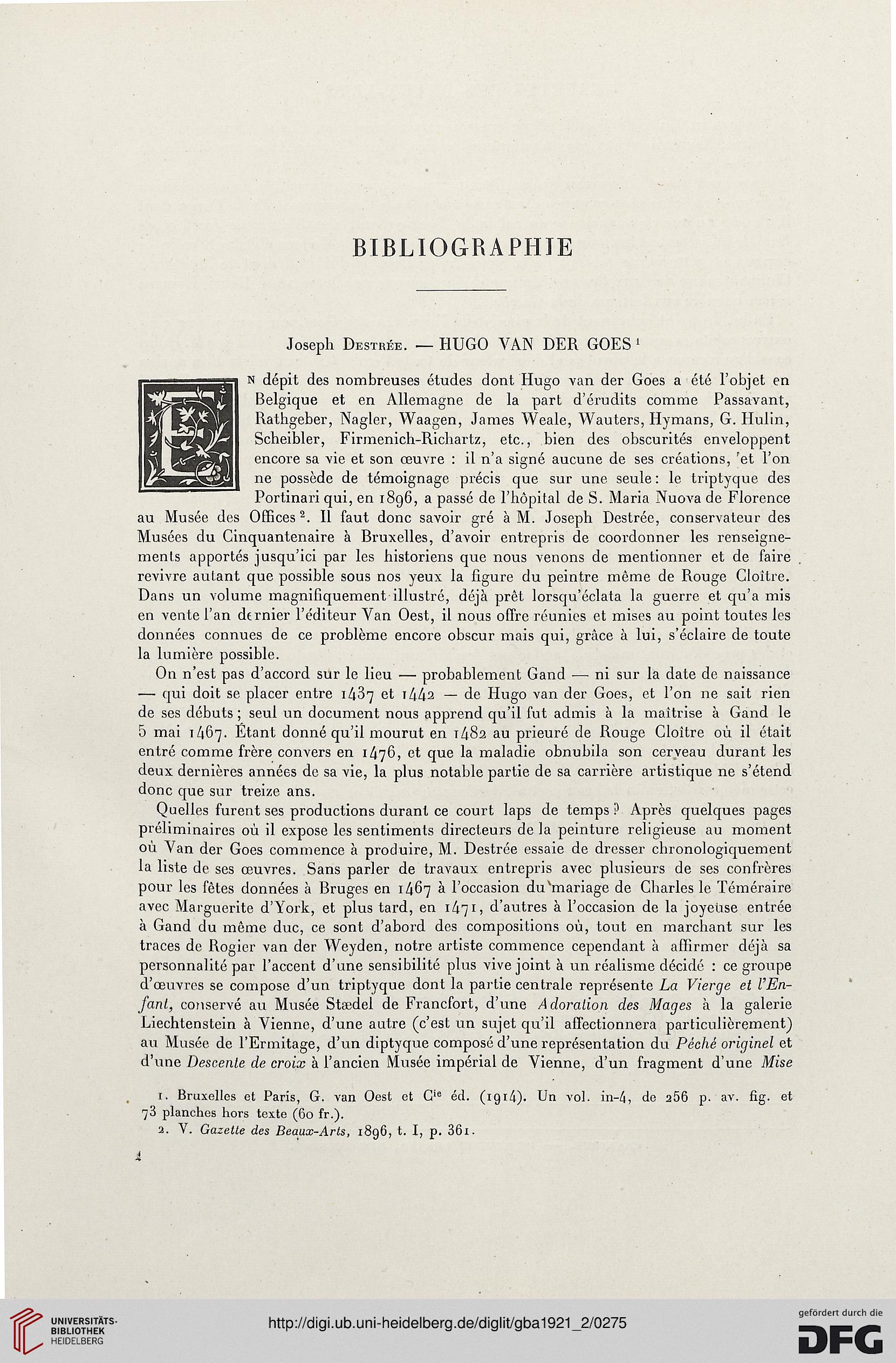BIBLIOGRAPHIE
Joseph Destrée. — HUGO VAN DER GOES 1
n dépit des nombreuses études dont Hugo van der Goes a été l’objet en
Belgique et en Allemagne de la part d’érudits comme Passavant,
Rathgeber, Nagler, Waagen, James Weale, Wauters, Hyrnans, G. Hulin,
Scbeibler, Firmenich-Richartz, etc., bien des obscurités enveloppent
encore sa vie et son œuvre : il n’a signé aucune de ses créations, ’et l’on
ne possède de témoignage précis que sur une seule : le triptyque des
Portinari qui, en 1896, a passé de l’bôpital de S. Maria Nuova de Florence
Offices2. Il faut donc savoir gré à M. Joseph Destrée, conservateur des
Musées du Cinquantenaire à Bruxelles, d’avoir entrepris de coordonner les renseigne-
ments apportés jusqu’ici par les historiens que nous venons de mentionner et de faire
revivre autant que possible sous nos yeux la figure du peintre même de Rouge Cloître.
Dans un volume magnifiquement illustré, déjà prêt lorsqu’éclata la guerre et qu’a mis
en vente l’an dernier l’éditeur Van Oest, il nous offre réunies et mises au point toutes les
données connues de ce problème encore obscur mais qui, grâce à lui, s’éclaire de toute
la lumière possible.
On n’est pas d’accord sur le lieu — probablement Gand — ni sur la date de naissance
— qui doit se placer entre 1437 et 144a — de Hugo van der Goes, et l’on ne sait rien
de ses débuts ; seul un document nous apprend qu’il fut admis à la maîtrise à Gand le
5 mai 1467- Étant donné qu’il mourut en 7482 au prieuré de Rouge Cloître où il était
entré comme frère convers en 7476, et que la inaladie obnubila son cerveau durant les
deux dernières années de sa vie, la plus notable partie de sa carrière artistique ne s’étend
donc que sur treize ans.
Quelles furent ses productions durant ce court laps de temps ? Après quelques pages
préliminaires où il expose les sentiments directeurs de la peinture religieuse au moment
où Van der Goes coimnence à produire, M. Destrée essaie de dresser chronologiquement
la liste de ses œuvres. Sans parler de travaux entrepris avec plusieurs de ses confrères
pour les fêtes données à Bruges en 7467 à l’occasion du'mariage de Charles le Té7néraire
avec Marguerite d’York, et plus tard, en 7471, d’autres à l’occasion de la joyeuse entrée
à Gand du 7nême duc, ce sont d’abord des composilio7is où, tout en marchant sur les
traces de Rogier van der Weyden, notre artiste commence cependant à affirmer déjà sa
personnalité par l’accent d’une sensibilité plus vive joint à un réalisme décidé : ce groupe
d’œuvi-es se compose d’un triptyque dont la partie centrale repi’ésente La Vierge et l’En-
fant, conservé au Musée Stædel de Francfort, d’une Adoration des Mages à la galerie
Liechtenstein à Vienne, d’une autre (c’est un sujet qu’il affectionnera particulièrement)
au Musée de l’Ermitage, d’un diptyque composé d’une représentation du Péché originel et
d’une Descente de croix à l’ancien Mi7sée impérial de Vienne, d’un fi-agment d’une Mise
1. Bruxelles et Paris, G. van Oest et Cie éd. (ig14). Un vol. in-4, de a56 p. av. fig. et
73 planches hors texte (60 fr.).
2. V. Gazette des Beaux-Arts, 1896, t. I, p. 361 -
au Musée des
Joseph Destrée. — HUGO VAN DER GOES 1
n dépit des nombreuses études dont Hugo van der Goes a été l’objet en
Belgique et en Allemagne de la part d’érudits comme Passavant,
Rathgeber, Nagler, Waagen, James Weale, Wauters, Hyrnans, G. Hulin,
Scbeibler, Firmenich-Richartz, etc., bien des obscurités enveloppent
encore sa vie et son œuvre : il n’a signé aucune de ses créations, ’et l’on
ne possède de témoignage précis que sur une seule : le triptyque des
Portinari qui, en 1896, a passé de l’bôpital de S. Maria Nuova de Florence
Offices2. Il faut donc savoir gré à M. Joseph Destrée, conservateur des
Musées du Cinquantenaire à Bruxelles, d’avoir entrepris de coordonner les renseigne-
ments apportés jusqu’ici par les historiens que nous venons de mentionner et de faire
revivre autant que possible sous nos yeux la figure du peintre même de Rouge Cloître.
Dans un volume magnifiquement illustré, déjà prêt lorsqu’éclata la guerre et qu’a mis
en vente l’an dernier l’éditeur Van Oest, il nous offre réunies et mises au point toutes les
données connues de ce problème encore obscur mais qui, grâce à lui, s’éclaire de toute
la lumière possible.
On n’est pas d’accord sur le lieu — probablement Gand — ni sur la date de naissance
— qui doit se placer entre 1437 et 144a — de Hugo van der Goes, et l’on ne sait rien
de ses débuts ; seul un document nous apprend qu’il fut admis à la maîtrise à Gand le
5 mai 1467- Étant donné qu’il mourut en 7482 au prieuré de Rouge Cloître où il était
entré comme frère convers en 7476, et que la inaladie obnubila son cerveau durant les
deux dernières années de sa vie, la plus notable partie de sa carrière artistique ne s’étend
donc que sur treize ans.
Quelles furent ses productions durant ce court laps de temps ? Après quelques pages
préliminaires où il expose les sentiments directeurs de la peinture religieuse au moment
où Van der Goes coimnence à produire, M. Destrée essaie de dresser chronologiquement
la liste de ses œuvres. Sans parler de travaux entrepris avec plusieurs de ses confrères
pour les fêtes données à Bruges en 7467 à l’occasion du'mariage de Charles le Té7néraire
avec Marguerite d’York, et plus tard, en 7471, d’autres à l’occasion de la joyeuse entrée
à Gand du 7nême duc, ce sont d’abord des composilio7is où, tout en marchant sur les
traces de Rogier van der Weyden, notre artiste commence cependant à affirmer déjà sa
personnalité par l’accent d’une sensibilité plus vive joint à un réalisme décidé : ce groupe
d’œuvi-es se compose d’un triptyque dont la partie centrale repi’ésente La Vierge et l’En-
fant, conservé au Musée Stædel de Francfort, d’une Adoration des Mages à la galerie
Liechtenstein à Vienne, d’une autre (c’est un sujet qu’il affectionnera particulièrement)
au Musée de l’Ermitage, d’un diptyque composé d’une représentation du Péché originel et
d’une Descente de croix à l’ancien Mi7sée impérial de Vienne, d’un fi-agment d’une Mise
1. Bruxelles et Paris, G. van Oest et Cie éd. (ig14). Un vol. in-4, de a56 p. av. fig. et
73 planches hors texte (60 fr.).
2. V. Gazette des Beaux-Arts, 1896, t. I, p. 361 -
au Musée des