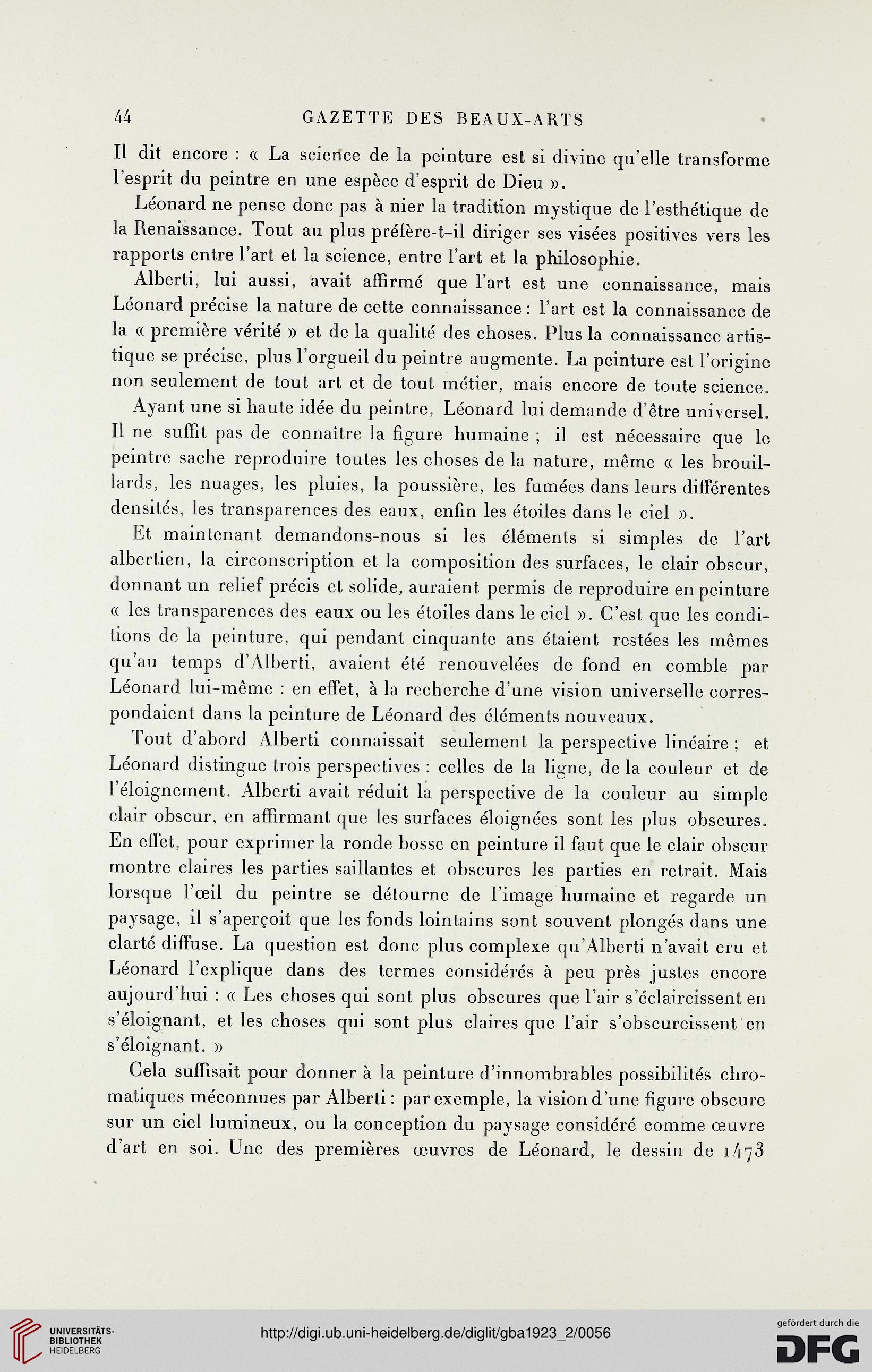44
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Il dit encore : « La science de la peinture est si divine qu’elle transforme
l'esprit du peintre en une espèce d’esprit de Dieu ».
Léonard ne pense donc pas à nier la tradition mystique de l’esthétique de
la Renaissance. Tout au plus préfère-t-il diriger ses visées positives vers les
rapports entre l’art et la science, entre l’art et la philosophie.
Alberti, lui aussi, avait affirmé que l’art est une connaissance, mais
Léonard précise la nature de cette connaissance : l’art est la connaissance de
la « première vérité » et de la qualité des choses. Plus la connaissance artis-
tique se précise, plus l’orgueil du peintre augmente. La peinture est l’origine
non seulement de tout art et de tout métier, mais encore de toute science.
Ayant une si haute idée du peintre, Léonard lui demande d’être universel.
Il ne suffit pas de connaître la figure humaine ; il est nécessaire que le
peintre sache reproduire toutes les choses de la nature, même (( les brouil-
lards, les nuages, les pluies, la poussière, les fumées dans leurs différentes
densités, les transparences des eaux, enfin les étoiles dans le ciel ».
Et maintenant demandons-nous si les éléments si simples de l’art
albertien, la circonscription et la composition des surfaces, le clair obscur,
donnant un relief précis et solide, auraient permis de reproduire en peinture
« les transparences des eaux ou les étoiles dans le ciel ». C’est que les condi-
tions de la peinture, qui pendant cinquante ans étaient restées les mêmes
qu’au temps d’Alberti, avaient été renouvelées de fond en comble par
Léonard lui-même : en effet, à la recherche d’une vision universelle corres-
pondaient dans la peinture de Léonard des éléments nouveaux.
Tout d’abord Alberti connaissait seulement la perspective linéaire ; et
Léonard distingue trois perspectives : celles de la ligne, de la couleur et de
l’éloignement. Alberti avait réduit la perspective de la couleur au simple
clair obscur, en affirmant que les surfaces éloignées sont les plus obscures.
En effet, pour exprimer la ronde bosse en peinture il faut que le clair obscur
montre claires les parties saillantes et obscures les parties en retrait. Mais
lorsque l’œil du peintre se détourne de l’image humaine et regarde un
paysage, il s’aperçoit que les fonds lointains sont souvent plongés dans une
clarté diffuse. La question est donc plus complexe cju’Alberti n’avait cru et
Léonard l’explique dans des termes considérés à peu près justes encore
aujourd’hui : « Les choses qui sont plus obscures que l’air s’éclaircissent en
s’éloignant, et les choses qui sont plus claires que l’air s’obscurcissent en
s’éloignant. »
Gela suffisait pour donner à la peinture d’innombrables possibilités chro-
matiques méconnues par Alberti : par exemple, la vision d’une figure obscure
sur un ciel lumineux, ou la conception du paysage considéré comme œuvre
d’art en soi. Une des premières œuvres de Léonard, le dessin de 147^
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Il dit encore : « La science de la peinture est si divine qu’elle transforme
l'esprit du peintre en une espèce d’esprit de Dieu ».
Léonard ne pense donc pas à nier la tradition mystique de l’esthétique de
la Renaissance. Tout au plus préfère-t-il diriger ses visées positives vers les
rapports entre l’art et la science, entre l’art et la philosophie.
Alberti, lui aussi, avait affirmé que l’art est une connaissance, mais
Léonard précise la nature de cette connaissance : l’art est la connaissance de
la « première vérité » et de la qualité des choses. Plus la connaissance artis-
tique se précise, plus l’orgueil du peintre augmente. La peinture est l’origine
non seulement de tout art et de tout métier, mais encore de toute science.
Ayant une si haute idée du peintre, Léonard lui demande d’être universel.
Il ne suffit pas de connaître la figure humaine ; il est nécessaire que le
peintre sache reproduire toutes les choses de la nature, même (( les brouil-
lards, les nuages, les pluies, la poussière, les fumées dans leurs différentes
densités, les transparences des eaux, enfin les étoiles dans le ciel ».
Et maintenant demandons-nous si les éléments si simples de l’art
albertien, la circonscription et la composition des surfaces, le clair obscur,
donnant un relief précis et solide, auraient permis de reproduire en peinture
« les transparences des eaux ou les étoiles dans le ciel ». C’est que les condi-
tions de la peinture, qui pendant cinquante ans étaient restées les mêmes
qu’au temps d’Alberti, avaient été renouvelées de fond en comble par
Léonard lui-même : en effet, à la recherche d’une vision universelle corres-
pondaient dans la peinture de Léonard des éléments nouveaux.
Tout d’abord Alberti connaissait seulement la perspective linéaire ; et
Léonard distingue trois perspectives : celles de la ligne, de la couleur et de
l’éloignement. Alberti avait réduit la perspective de la couleur au simple
clair obscur, en affirmant que les surfaces éloignées sont les plus obscures.
En effet, pour exprimer la ronde bosse en peinture il faut que le clair obscur
montre claires les parties saillantes et obscures les parties en retrait. Mais
lorsque l’œil du peintre se détourne de l’image humaine et regarde un
paysage, il s’aperçoit que les fonds lointains sont souvent plongés dans une
clarté diffuse. La question est donc plus complexe cju’Alberti n’avait cru et
Léonard l’explique dans des termes considérés à peu près justes encore
aujourd’hui : « Les choses qui sont plus obscures que l’air s’éclaircissent en
s’éloignant, et les choses qui sont plus claires que l’air s’obscurcissent en
s’éloignant. »
Gela suffisait pour donner à la peinture d’innombrables possibilités chro-
matiques méconnues par Alberti : par exemple, la vision d’une figure obscure
sur un ciel lumineux, ou la conception du paysage considéré comme œuvre
d’art en soi. Une des premières œuvres de Léonard, le dessin de 147^