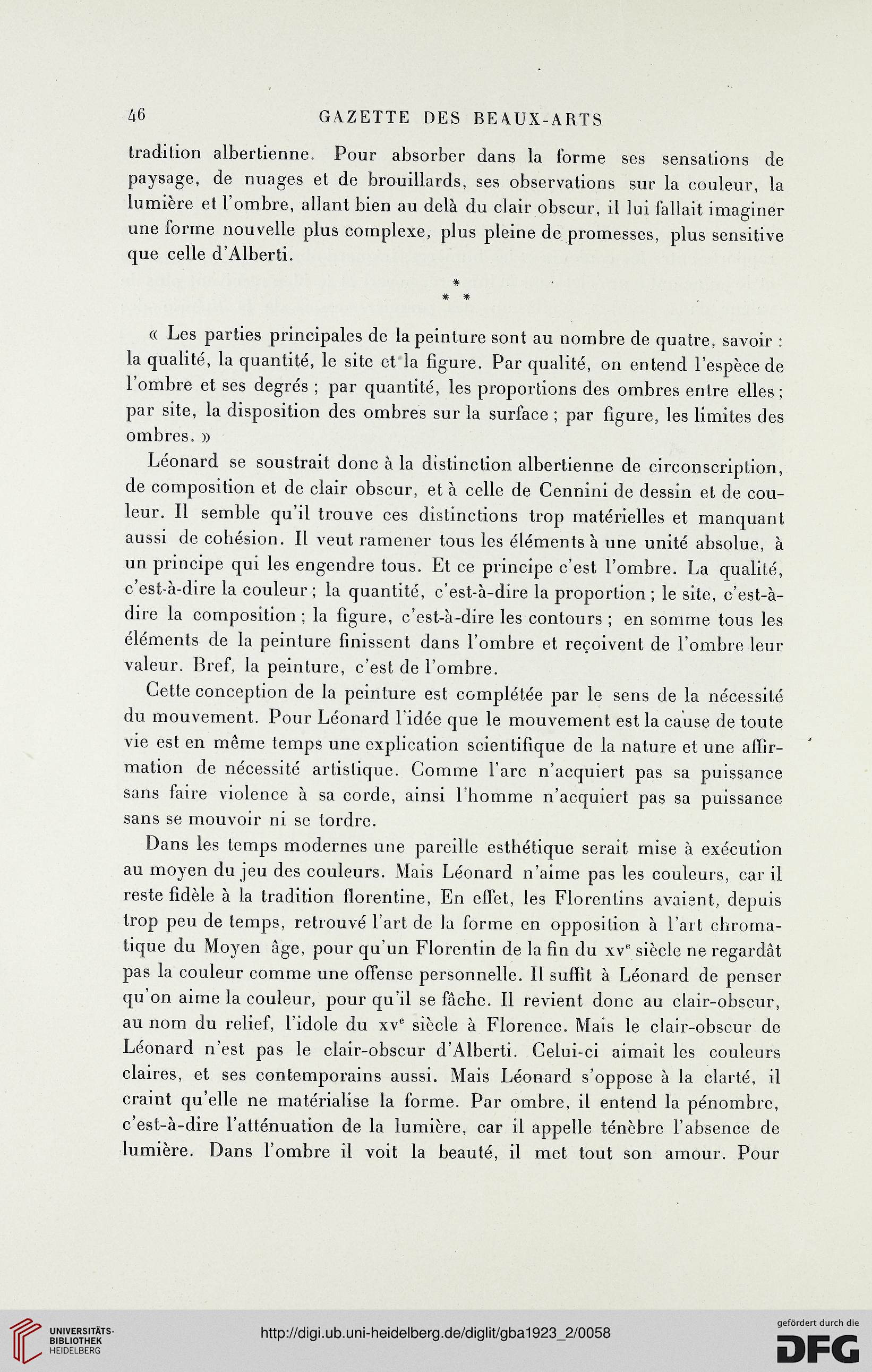46
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
tradition albertienne. Pour absorber dans la forme ses sensations de
paysage, de nuages et de brouillards, ses observations sur la couleur, la
lumière et l'ombre, allant bien au delà du clair obscur, il lui fallait imaginer
une forme nouvelle plus complexe, plus pleine de promesses, plus sensitive
que celle d’Alberti.
*
* *
« Les parties principales de la peinture sont au nombre de quatre, savoir :
la qualité, la quantité, le site et la figure. Par qualité, on entend l’espèce de
l’ombre et ses degrés ; par quantité, les proportions des ombres entre elles ;
par site, la disposition des ombres sur la surface ; par figure, les limites des
ombres. »
Léonard se soustrait donc à la distinction albertienne de circonscription,
de composition et de clair obscur, et à celle de Cennini de dessin et de cou-
leur. Il semble qu’il trouve ces distinctions trop matérielles et manquant
aussi de cohésion. Il veut ramener tous les éléments à une unité absolue, à
un principe qui les engendre tous. Et ce principe c'est l’ombre. La qualité,
c’est-à-dire la couleur ; la quantité, c’est-à-dire la proportion ; le site, c’est-à-
dire la composition ; la figure, c’est-à-dire les contours ; en somme tous les
éléments de la peinture finissent dans l’ombre et reçoivent de l’ombre leur
valeur. Bref, la peinture, c’est de l’ombre.
Cette conception de la peinture est complétée par le sens de la nécessité
du mouvement. Pour Léonard l'idée que le mouvement est la cause de toute
vie est en même temps une explication scientifique de la nature et une affir-
mation de nécessité artistique. Comme l’arc n’acquiert pas sa puissance
sans faire violence à sa corde, ainsi l'homme n’acquiert pas sa puissance
sans se mouvoir ni se tordre.
Dans les temps modernes nue pareille esthétique serait mise à exécution
au moyen du jeu des couleurs. Mais Léonard n’aime pas les couleurs, car il
reste fidèle à la tradition florentine, En effet, les Florentins avaient, depuis
trop peu de temps, retrouvé 1 art de la forme en opposition à l’art chroma-
tique du Moyen âge, pour qu'un Florentin de la fin du xve siècle ne regardât
pas la couleur comme une offense personnelle. Il suffit à Léonard de penser
qu’on aime la couleur, pour qu’il se fâche. Il revient donc au clair-obscur,
au nom du relief, 1 idole du xve siècle à Florence. Mais le clair-obscur de
Léonard n’est pas le clair-obscur d’Alberti. Celui-ci aimait les couleurs
claires, et ses contemporains aussi. Mais Léonard s’oppose à la clarté, il
craint qu’elle ne matérialise la forme. Par ombre, il entend la pénombre,
c’est-à-dire l’atténuation de la lumière, car il appelle ténèbre l’absence de
lumière. Dans l’ombre il voit la beauté, il met tout son amour. Pour
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
tradition albertienne. Pour absorber dans la forme ses sensations de
paysage, de nuages et de brouillards, ses observations sur la couleur, la
lumière et l'ombre, allant bien au delà du clair obscur, il lui fallait imaginer
une forme nouvelle plus complexe, plus pleine de promesses, plus sensitive
que celle d’Alberti.
*
* *
« Les parties principales de la peinture sont au nombre de quatre, savoir :
la qualité, la quantité, le site et la figure. Par qualité, on entend l’espèce de
l’ombre et ses degrés ; par quantité, les proportions des ombres entre elles ;
par site, la disposition des ombres sur la surface ; par figure, les limites des
ombres. »
Léonard se soustrait donc à la distinction albertienne de circonscription,
de composition et de clair obscur, et à celle de Cennini de dessin et de cou-
leur. Il semble qu’il trouve ces distinctions trop matérielles et manquant
aussi de cohésion. Il veut ramener tous les éléments à une unité absolue, à
un principe qui les engendre tous. Et ce principe c'est l’ombre. La qualité,
c’est-à-dire la couleur ; la quantité, c’est-à-dire la proportion ; le site, c’est-à-
dire la composition ; la figure, c’est-à-dire les contours ; en somme tous les
éléments de la peinture finissent dans l’ombre et reçoivent de l’ombre leur
valeur. Bref, la peinture, c’est de l’ombre.
Cette conception de la peinture est complétée par le sens de la nécessité
du mouvement. Pour Léonard l'idée que le mouvement est la cause de toute
vie est en même temps une explication scientifique de la nature et une affir-
mation de nécessité artistique. Comme l’arc n’acquiert pas sa puissance
sans faire violence à sa corde, ainsi l'homme n’acquiert pas sa puissance
sans se mouvoir ni se tordre.
Dans les temps modernes nue pareille esthétique serait mise à exécution
au moyen du jeu des couleurs. Mais Léonard n’aime pas les couleurs, car il
reste fidèle à la tradition florentine, En effet, les Florentins avaient, depuis
trop peu de temps, retrouvé 1 art de la forme en opposition à l’art chroma-
tique du Moyen âge, pour qu'un Florentin de la fin du xve siècle ne regardât
pas la couleur comme une offense personnelle. Il suffit à Léonard de penser
qu’on aime la couleur, pour qu’il se fâche. Il revient donc au clair-obscur,
au nom du relief, 1 idole du xve siècle à Florence. Mais le clair-obscur de
Léonard n’est pas le clair-obscur d’Alberti. Celui-ci aimait les couleurs
claires, et ses contemporains aussi. Mais Léonard s’oppose à la clarté, il
craint qu’elle ne matérialise la forme. Par ombre, il entend la pénombre,
c’est-à-dire l’atténuation de la lumière, car il appelle ténèbre l’absence de
lumière. Dans l’ombre il voit la beauté, il met tout son amour. Pour