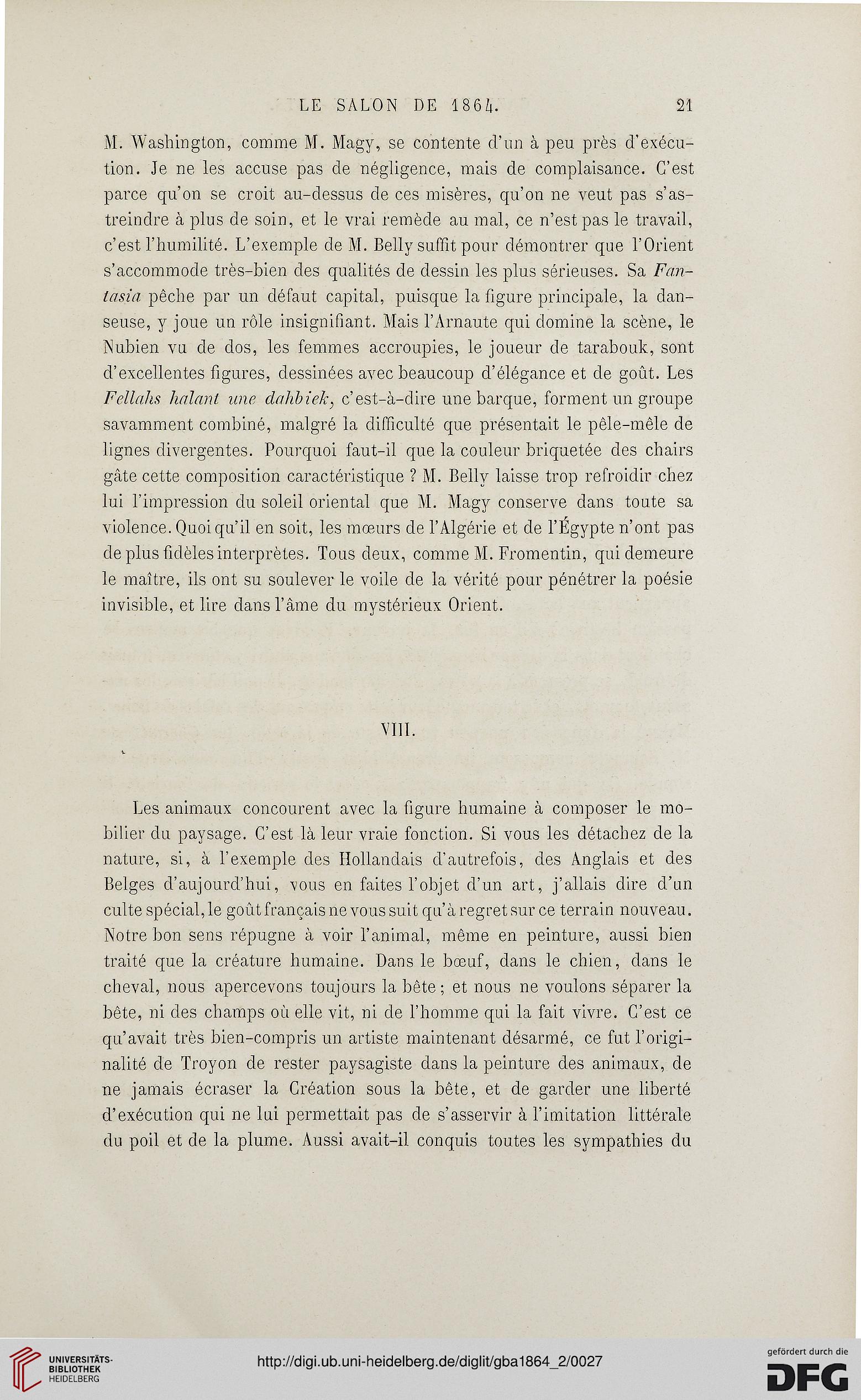LE SALON DE 186Z;.
21
M. Washington, comme M. Magy, se contente d’un à peu près d’exécu-
tion. Je ne les accuse pas de négligence, mais de complaisance. C’est
parce qu’on se croit au-dessus de ces misères, qu’on ne veut pas s’as-
treindre à plus de soin, et le vrai remède au mal, ce n’est pas le travail,
c’est l’humilité. L’exemple de M. Belly suffit pour démontrer que l’Orient
s’accommode très-bien des qualités de dessin les plus sérieuses. Sa Fan-
tasia pêche par un défaut capital, puisque la figure principale, la dan-
seuse, y joue un rôle insignifiant. Mais l’Arnaute qui domine la scène, le
Nubien vu de dos, les femmes accroupies, le joueur de tarabouk, sont
d’excellentes figures, dessinées avec beaucoup d’élégance et de goût. Les
Fellahs halanl une dahhiek, c’est-à-dire une barque, forment un groupe
savamment combiné, malgré la difficulté que présentait le pêle-mêle de
lignes divergentes. Pourquoi faut-il que la couleur briquetée des chairs
gâte cette composition caractéristique ? M. Belly laisse trop refroidir chez
lui l’impression du soleil oriental que M. Magy conserve dans toute sa
violence. Quoiqu’il en soit, les mœurs de l’Algérie et de l’Égypte n’ont pas
de plus fidèles interprètes. Tous deux, comme M. Fromentin, qui demeure
le maître, ils ont su soulever le voile de la vérité pour pénétrer la poésie
invisible, et lire dans l’âme du mystérieux Orient.
VIII.
Les animaux concourent avec la figure humaine à composer le mo-
bilier du paysage. C’est là leur vraie fonction. Si vous les détachez de la
nature, si, à l'exemple des Hollandais d’autrefois, des Anglais et des
Belges d’aujourd’hui, vous en faites l’objet d’un art, j’allais dire d’un
culte spécial, le goutfrançais ne vous suit qu’à regret sur ce terrain nouveau.
Notre bon sens répugne à voir l’animal, même en peinture, aussi bien
traité que la créature humaine. Dans le bœuf, dans le chien, dans le
cheval, nous apercevons toujours la bête; et nous ne voulons séparer la
bête, ni des champs où elle vit, ni de l’homme qui la fait vivre. C’est ce
qu’avait très bien-compris un artiste maintenant désarmé, ce fut l’origi-
nalité de Troyon de rester paysagiste dans la peinture des animaux, de
ne jamais écraser la Création sous la bête, et de garder une liberté
d’exécution qui ne lui permettait pas de s’asservir à l’imitation littérale
du poil et de la plume. Aussi avait-il conquis toutes les sympathies du
21
M. Washington, comme M. Magy, se contente d’un à peu près d’exécu-
tion. Je ne les accuse pas de négligence, mais de complaisance. C’est
parce qu’on se croit au-dessus de ces misères, qu’on ne veut pas s’as-
treindre à plus de soin, et le vrai remède au mal, ce n’est pas le travail,
c’est l’humilité. L’exemple de M. Belly suffit pour démontrer que l’Orient
s’accommode très-bien des qualités de dessin les plus sérieuses. Sa Fan-
tasia pêche par un défaut capital, puisque la figure principale, la dan-
seuse, y joue un rôle insignifiant. Mais l’Arnaute qui domine la scène, le
Nubien vu de dos, les femmes accroupies, le joueur de tarabouk, sont
d’excellentes figures, dessinées avec beaucoup d’élégance et de goût. Les
Fellahs halanl une dahhiek, c’est-à-dire une barque, forment un groupe
savamment combiné, malgré la difficulté que présentait le pêle-mêle de
lignes divergentes. Pourquoi faut-il que la couleur briquetée des chairs
gâte cette composition caractéristique ? M. Belly laisse trop refroidir chez
lui l’impression du soleil oriental que M. Magy conserve dans toute sa
violence. Quoiqu’il en soit, les mœurs de l’Algérie et de l’Égypte n’ont pas
de plus fidèles interprètes. Tous deux, comme M. Fromentin, qui demeure
le maître, ils ont su soulever le voile de la vérité pour pénétrer la poésie
invisible, et lire dans l’âme du mystérieux Orient.
VIII.
Les animaux concourent avec la figure humaine à composer le mo-
bilier du paysage. C’est là leur vraie fonction. Si vous les détachez de la
nature, si, à l'exemple des Hollandais d’autrefois, des Anglais et des
Belges d’aujourd’hui, vous en faites l’objet d’un art, j’allais dire d’un
culte spécial, le goutfrançais ne vous suit qu’à regret sur ce terrain nouveau.
Notre bon sens répugne à voir l’animal, même en peinture, aussi bien
traité que la créature humaine. Dans le bœuf, dans le chien, dans le
cheval, nous apercevons toujours la bête; et nous ne voulons séparer la
bête, ni des champs où elle vit, ni de l’homme qui la fait vivre. C’est ce
qu’avait très bien-compris un artiste maintenant désarmé, ce fut l’origi-
nalité de Troyon de rester paysagiste dans la peinture des animaux, de
ne jamais écraser la Création sous la bête, et de garder une liberté
d’exécution qui ne lui permettait pas de s’asservir à l’imitation littérale
du poil et de la plume. Aussi avait-il conquis toutes les sympathies du