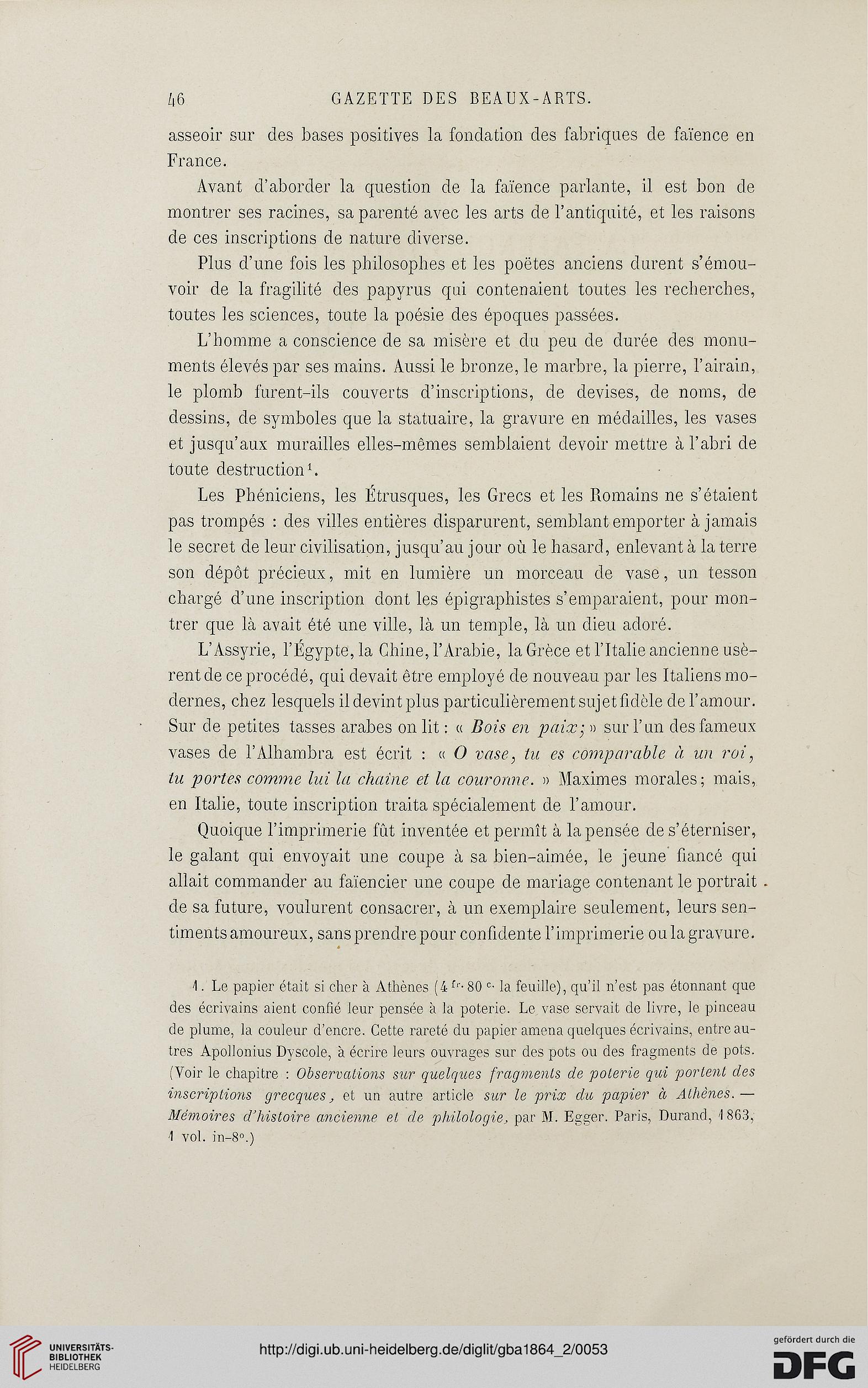GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
A 6
asseoir sur des bases positives la fondation des fabriques de faïence en
France.
Avant d’aborder la question de la faïence parlante, il est bon de
montrer ses racines, sa parenté avec les arts de l’antiquité, et les raisons
de ces inscriptions de nature diverse.
Plus d’une fois les philosophes et les poètes anciens durent s’émou-
voir de la fragilité des papyrus qui contenaient toutes les recherches,
toutes les sciences, toute la poésie des époques passées.
L’homme a conscience de sa misère et du peu de durée des monu-
ments élevés par ses mains. Aussi le bronze, le marbre, la pierre, l’airain,
le plomb furent-ils couverts d’inscriptions, de devises, de noms, de
dessins, de symboles que la statuaire, la gravure en médailles, les vases
et jusqu’aux murailles elles-mêmes semblaient devoir mettre à l’abri de
toute destruction1.
Les Phéniciens, les Étrusques, les Grecs et les Romains ne s’étaient
pas trompés : des villes entières disparurent, semblant emporter à jamais
le secret de leur civilisation, jusqu’au jour où le hasard, enlevant à la terre
son dépôt précieux, mit en lumière un morceau de vase, un tesson
chargé d’une inscription dont les épigraphistes s’emparaient, pour mon-
trer que là avait été une ville, là un temple, là un dieu adoré.
L’Assyrie, l’Égypte, la Chine, l’Arabie, la Grèce et l’Italie ancienne usè-
rent de ce procédé, qui devait être employé de nouveau par les Italiens mo-
dernes, chez lesquels il devint plus particulièrement sujet fidèle de l’amour.
Sur de petites tasses arabes on lit : « Bois en paix] » sur l’un des fameux
vases de l’Alhambra est écrit : « O vase, tu es comparable à un roi,
tu portes comme lui la chaîne et la couronne. » Maximes morales; mais,
en Italie, toute inscription traita spécialement de l’amour.
Quoique l’imprimerie fût inventée et permît à la pensée de s’éterniser,
le galant qui envoyait une coupe à sa bien-aimée, le jeune fiancé qui
allait commander au faïencier une coupe de mariage contenant le portrait
de sa future, voulurent consacrer, à un exemplaire seulement, leurs sen-
timents amoureux, sans prendre pour confidente l’imprimerie ou la gravure.
'1. Le papier était si cher à Athènes (4 u- 80 c- la feuille), qu’il n’est pas étonnant que
des écrivains aient confié leur pensée à la poterie. Le vase servait de livre, le pinceau
de plume, la couleur d’encre. Cette rareté du papier amena quelques écrivains, entre au-
tres Apollonius Dyscole, à écrire leurs ouvrages sur des pots ou des fragments de pots.
(Voir le chapitre : Observations sur quelques fragments de poterie qui portent des
inscriptions grecques, et un autre article sur le prix du papier à Athènes. —
Mémoires d’histoire ancienne et de philologie, par M. Egger. Paris, Durand, '1 863,
-1 vol. in-8°.)
A 6
asseoir sur des bases positives la fondation des fabriques de faïence en
France.
Avant d’aborder la question de la faïence parlante, il est bon de
montrer ses racines, sa parenté avec les arts de l’antiquité, et les raisons
de ces inscriptions de nature diverse.
Plus d’une fois les philosophes et les poètes anciens durent s’émou-
voir de la fragilité des papyrus qui contenaient toutes les recherches,
toutes les sciences, toute la poésie des époques passées.
L’homme a conscience de sa misère et du peu de durée des monu-
ments élevés par ses mains. Aussi le bronze, le marbre, la pierre, l’airain,
le plomb furent-ils couverts d’inscriptions, de devises, de noms, de
dessins, de symboles que la statuaire, la gravure en médailles, les vases
et jusqu’aux murailles elles-mêmes semblaient devoir mettre à l’abri de
toute destruction1.
Les Phéniciens, les Étrusques, les Grecs et les Romains ne s’étaient
pas trompés : des villes entières disparurent, semblant emporter à jamais
le secret de leur civilisation, jusqu’au jour où le hasard, enlevant à la terre
son dépôt précieux, mit en lumière un morceau de vase, un tesson
chargé d’une inscription dont les épigraphistes s’emparaient, pour mon-
trer que là avait été une ville, là un temple, là un dieu adoré.
L’Assyrie, l’Égypte, la Chine, l’Arabie, la Grèce et l’Italie ancienne usè-
rent de ce procédé, qui devait être employé de nouveau par les Italiens mo-
dernes, chez lesquels il devint plus particulièrement sujet fidèle de l’amour.
Sur de petites tasses arabes on lit : « Bois en paix] » sur l’un des fameux
vases de l’Alhambra est écrit : « O vase, tu es comparable à un roi,
tu portes comme lui la chaîne et la couronne. » Maximes morales; mais,
en Italie, toute inscription traita spécialement de l’amour.
Quoique l’imprimerie fût inventée et permît à la pensée de s’éterniser,
le galant qui envoyait une coupe à sa bien-aimée, le jeune fiancé qui
allait commander au faïencier une coupe de mariage contenant le portrait
de sa future, voulurent consacrer, à un exemplaire seulement, leurs sen-
timents amoureux, sans prendre pour confidente l’imprimerie ou la gravure.
'1. Le papier était si cher à Athènes (4 u- 80 c- la feuille), qu’il n’est pas étonnant que
des écrivains aient confié leur pensée à la poterie. Le vase servait de livre, le pinceau
de plume, la couleur d’encre. Cette rareté du papier amena quelques écrivains, entre au-
tres Apollonius Dyscole, à écrire leurs ouvrages sur des pots ou des fragments de pots.
(Voir le chapitre : Observations sur quelques fragments de poterie qui portent des
inscriptions grecques, et un autre article sur le prix du papier à Athènes. —
Mémoires d’histoire ancienne et de philologie, par M. Egger. Paris, Durand, '1 863,
-1 vol. in-8°.)