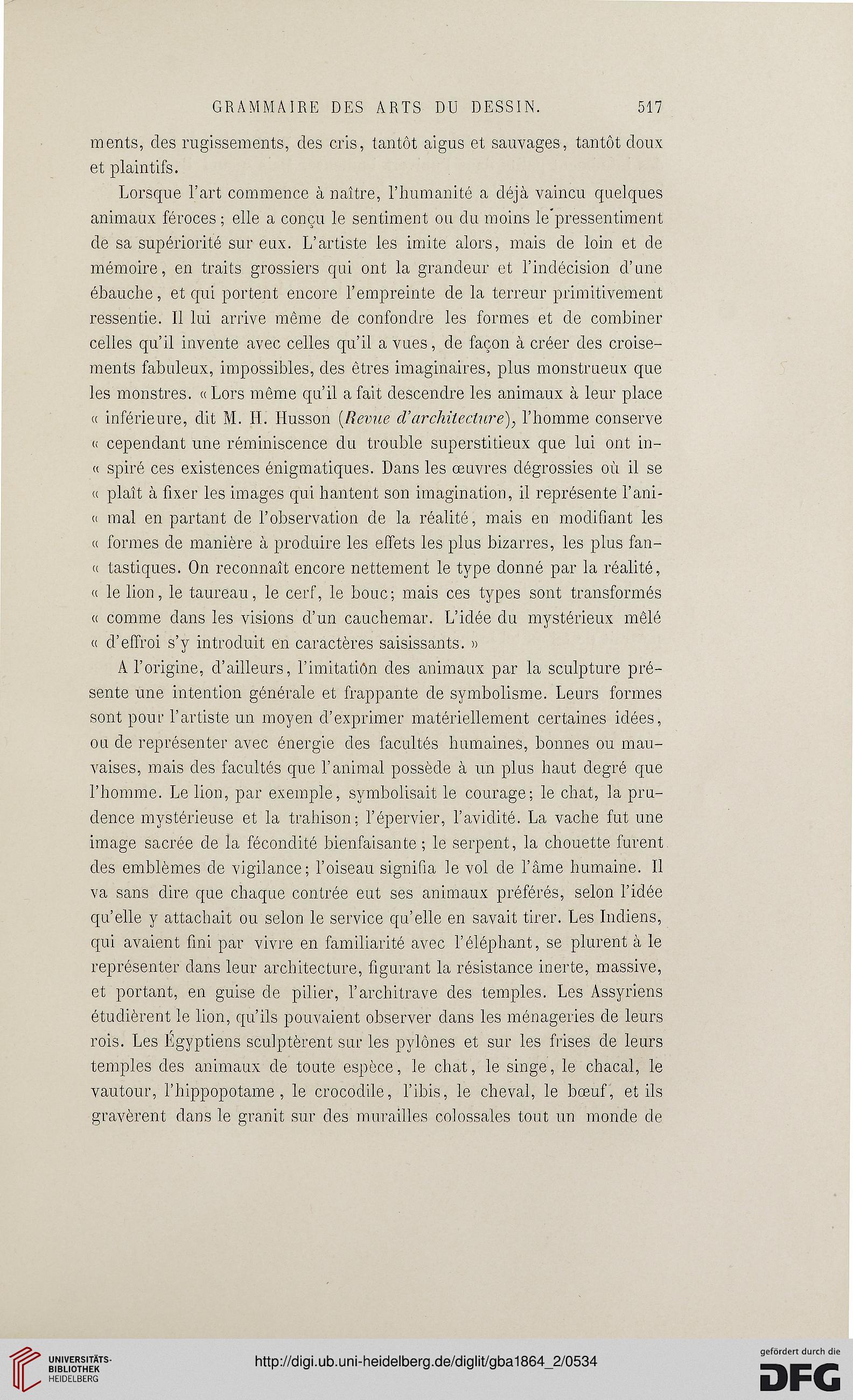GRAMMAIRE DES ARTS DU DESSIN.
517
ments, des rugissements, des cris, tantôt aigus et sauvages, tantôt doux
et plaintifs.
Lorsque l’art commence à naître, l’humanité a déjà vaincu quelques
animaux féroces ; elle a conçu le sentiment ou du moins le pressentiment
de sa supériorité sur eux. L’artiste les imite alors, mais de loin et de
mémoire, en traits grossiers qui ont la grandeur et l’indécision d’une
ébauche, et qui portent encore l’empreinte de la terreur primitivement
ressentie. Il lui arrive même de confondre les formes et de combiner
celles qu’il invente avec celles qu’il a vues, de façon à créer des croise-
ments fabuleux, impossibles, des êtres imaginaires, plus monstrueux que
les monstres. « Lors même qu’il a fait descendre les animaux à leur place
« inférieure, dit M. H. Husson (Revue d’architecture), l’homme conserve
« cependant une réminiscence du trouble superstitieux que lui ont in-
« spiré ces existences énigmatiques. Dans les œuvres dégrossies où il se
« plaît à fixer les images qui hantent son imagination, il représente l’ani-
» mal en partant de l’observation de la réalité, mais en modifiant les
« formes de manière à produire les effets les plus bizarres, les plus fan-
ci tastiques. On reconnaît encore nettement le type donné par la réalité,
« le lion, le taureau, le cerf, le bouc; mais ces types sont transformés
« comme dans les visions d’un cauchemar. L’idée du mystérieux mêlé
« d’effroi s’y introduit en caractères saisissants. »
A l’origine, d’ailleurs, l’imitatiôn des animaux par la sculpture pré-
sente une intention générale et frappante de symbolisme. Leurs formes
sont pour l’artiste un moyen d’exprimer matériellement certaines idées,
ou de représenter avec énergie des facultés humaines, bonnes ou mau-
vaises, mais des facultés que l’animal possède à un plus haut degré que
l’homme. Le lion, par exemple, symbolisait le courage; le chat, la pru-
dence mystérieuse et la trahison; l’épervier, l’avidité. La vache fut une
image sacrée de la fécondité bienfaisante; le serpent, la chouette furent
des emblèmes de vigilance; l’oiseau signifia le vol de l’âme humaine. Il
va sans dire que chaque contrée eut ses animaux préférés, selon l’idée
qu’elle y attachait ou selon le service qu’elle en savait tirer. Les Indiens,
qui avaient fini par vivre en familiarité avec l’éléphant, se plurent à le
représenter dans leur architecture, figurant la résistance inerte, massive,
et portant, en guise de pilier, l’architrave des temples. Les Assyriens
étudièrent le lion, qu’ils pouvaient observer dans les ménageries de leurs
rois. Les Égyptiens sculptèrent sur les pylônes et sur les frises de leurs
temples des animaux de toute espèce, le chat, le singe, le chacal, le
vautour, l’hippopotame , le crocodile, l’ibis, le cheval, le bœuf, et ils
gravèrent dans le granit sur des murailles colossales tout un monde de
517
ments, des rugissements, des cris, tantôt aigus et sauvages, tantôt doux
et plaintifs.
Lorsque l’art commence à naître, l’humanité a déjà vaincu quelques
animaux féroces ; elle a conçu le sentiment ou du moins le pressentiment
de sa supériorité sur eux. L’artiste les imite alors, mais de loin et de
mémoire, en traits grossiers qui ont la grandeur et l’indécision d’une
ébauche, et qui portent encore l’empreinte de la terreur primitivement
ressentie. Il lui arrive même de confondre les formes et de combiner
celles qu’il invente avec celles qu’il a vues, de façon à créer des croise-
ments fabuleux, impossibles, des êtres imaginaires, plus monstrueux que
les monstres. « Lors même qu’il a fait descendre les animaux à leur place
« inférieure, dit M. H. Husson (Revue d’architecture), l’homme conserve
« cependant une réminiscence du trouble superstitieux que lui ont in-
« spiré ces existences énigmatiques. Dans les œuvres dégrossies où il se
« plaît à fixer les images qui hantent son imagination, il représente l’ani-
» mal en partant de l’observation de la réalité, mais en modifiant les
« formes de manière à produire les effets les plus bizarres, les plus fan-
ci tastiques. On reconnaît encore nettement le type donné par la réalité,
« le lion, le taureau, le cerf, le bouc; mais ces types sont transformés
« comme dans les visions d’un cauchemar. L’idée du mystérieux mêlé
« d’effroi s’y introduit en caractères saisissants. »
A l’origine, d’ailleurs, l’imitatiôn des animaux par la sculpture pré-
sente une intention générale et frappante de symbolisme. Leurs formes
sont pour l’artiste un moyen d’exprimer matériellement certaines idées,
ou de représenter avec énergie des facultés humaines, bonnes ou mau-
vaises, mais des facultés que l’animal possède à un plus haut degré que
l’homme. Le lion, par exemple, symbolisait le courage; le chat, la pru-
dence mystérieuse et la trahison; l’épervier, l’avidité. La vache fut une
image sacrée de la fécondité bienfaisante; le serpent, la chouette furent
des emblèmes de vigilance; l’oiseau signifia le vol de l’âme humaine. Il
va sans dire que chaque contrée eut ses animaux préférés, selon l’idée
qu’elle y attachait ou selon le service qu’elle en savait tirer. Les Indiens,
qui avaient fini par vivre en familiarité avec l’éléphant, se plurent à le
représenter dans leur architecture, figurant la résistance inerte, massive,
et portant, en guise de pilier, l’architrave des temples. Les Assyriens
étudièrent le lion, qu’ils pouvaient observer dans les ménageries de leurs
rois. Les Égyptiens sculptèrent sur les pylônes et sur les frises de leurs
temples des animaux de toute espèce, le chat, le singe, le chacal, le
vautour, l’hippopotame , le crocodile, l’ibis, le cheval, le bœuf, et ils
gravèrent dans le granit sur des murailles colossales tout un monde de