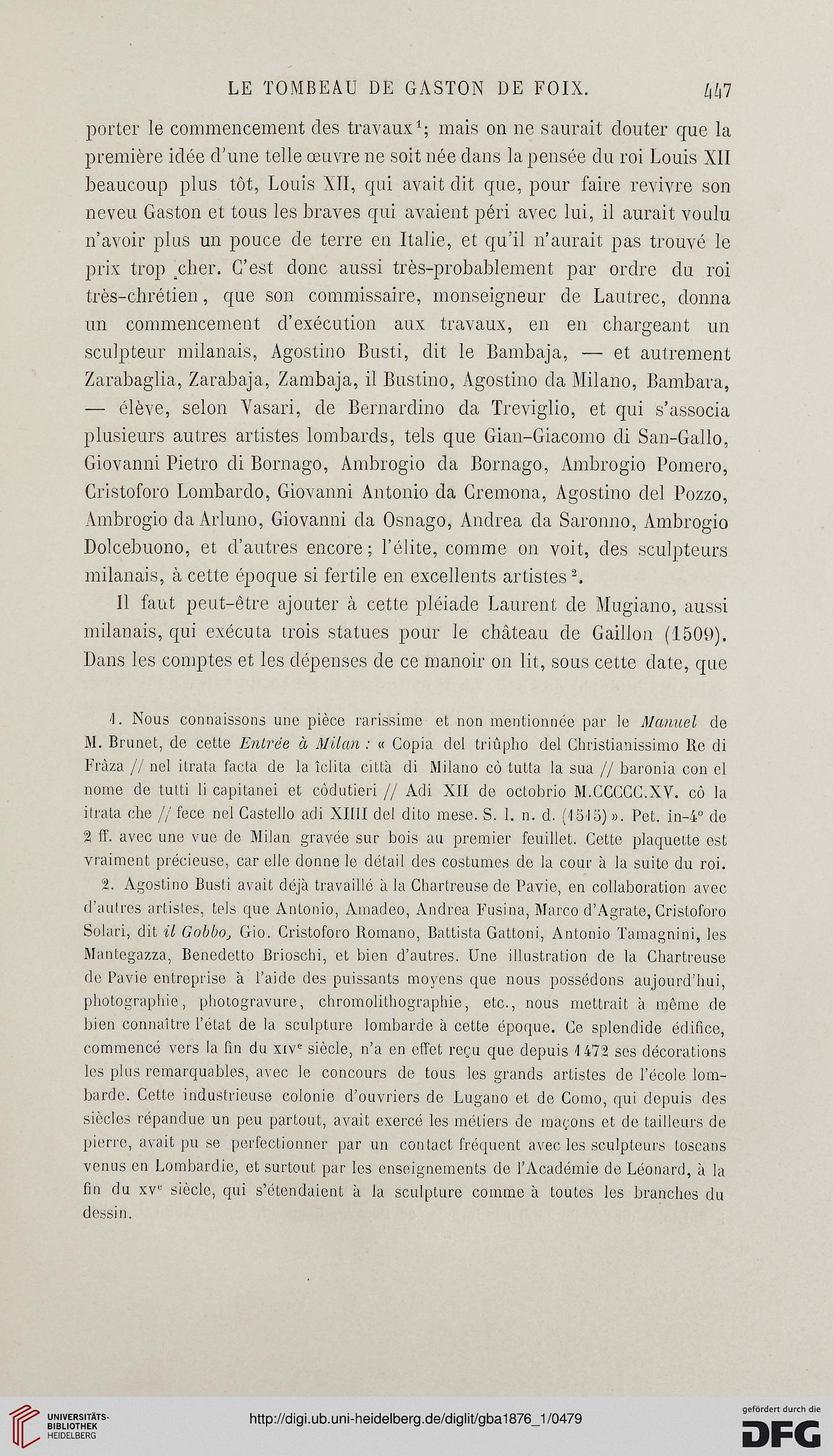LE TOMBEAU DE GASTON DE FOIX.
hhl
porter le commencement des travaux1; mais on ne saurait douter que la
première idée d'une telle œuvre ne soit née dans la pensée du roi Louis XII
beaucoup plus tôt, Louis XII, qui avait dit que, pour faire revivre son
neveu Gaston et tous les braves qui avaient péri avec lui, il aurait voulu
n’avoir plus un pouce de terre en Italie, et qu’il n’aurait pas trouvé le
prix trop /hier. C’est donc aussi très-probablement par ordre du roi
très-chrétien, que son commissaire, monseigneur de Lautrec, donna
un commencement d’exécution aux travaux, en en chargeant un
sculpteur milanais, Agostino Busti, dit le Bambaja, — et autrement
Zarabaglia, Zarabaja, Zambaja, il Bustino, Agostino da Milano, Bambara,
— élève, selon Vasari, de Bernardino da Treviglio, et qui s’associa
plusieurs autres artistes lombards, tels que Gian-Giacomo di San-Gallo,
Giovanni Pietro di Bornago, Ambrogio da Bornago, Ambrogio Pomero,
Cristoforo Lombardo, Giovanni Antonio da Cremona, Agostino del Pozzo,
Ambrogio da Arluno, Giovanni da Osnago, Andrea da Saronno, Ambrogio
Dolcebuono, et d’autres encore; l’élite, comme on voit, des sculpteurs
milanais, à cette époque si fertile en excellents artistes2.
Il faut peut-être ajouter à cette pléiade Laurent de Mugiano, aussi
milanais, qui exécuta trois statues pour le château de Gaillon (1509).
Dans les comptes et les dépenses de ce manoir on lit, sous cette date, que
1. Nous connaissons une pièce rarissime et non mentionnée par le Manuel de
M. Brunet, de cette Entrée à Milan : « Copia del triûpho del Christianissimo Re di
Fràza // nel itrata facta de la îclita città di Milano cô tutta la sua // baronia con cl
nome de tutti li capitanei et côdutieri // Adi XII de octobrio M.CCCCC.XV. cô la
itrata che // fece nel Castello adi XIIII del dito mese. S. 1. n. d. (1515) ». Pet. in-4° de
2 ff. avec une vue de Milan gravée sur bois au premier feuillet. Cette plaquette est
vraiment précieuse, car elle donne le détail des costumes de la cour à la suite du roi.
2. Agostino Busti avait déjà travaillé à la Chartreuse de Pavie, en collaboration avec
d’autres artistes, tels que Antonio, Amadeo, Andrea Fusina, Marco d’Agrate, Cristoforo
Solari, dit il Gobboj Gio. Cristoforo llomano, Battista Gattoni, Antonio Tamagnini, les
Mantegazza, Benedetto Brioschi, et bien d’autres. Une illustration de la Chartreuse
de Pavie entreprise à l’aide des puissants moyens que nous possédons aujourd’hui,
photographie, photogravure, chromolithographie, etc., nous mettrait à même de
bien connaître l’état de la sculpture lombarde à cette époque. Ce splendide édifice,
commencé vers la fin du xive siècle, n’a en effet reçu que depuis 1 472 ses décorations
les plus remarquables, avec le concours de tous les grands artistes de l’école lom-
barde. Cette industrieuse colonie d’ouvriers de Lugano et de Como, qui depuis des
siècles répandue un peu partout, avait exercé les métiers de maçons et de tailleurs de
pierre, avait pu se perfectionner par un contact fréquent avec les sculpteurs toscans
venus en Lombardie, et surtout par les enseignements de l’Académie de Léonard, à la
fin du xvu siècle, qui s’étendaient à la sculpture comme à toutes les branches du
dessin.
hhl
porter le commencement des travaux1; mais on ne saurait douter que la
première idée d'une telle œuvre ne soit née dans la pensée du roi Louis XII
beaucoup plus tôt, Louis XII, qui avait dit que, pour faire revivre son
neveu Gaston et tous les braves qui avaient péri avec lui, il aurait voulu
n’avoir plus un pouce de terre en Italie, et qu’il n’aurait pas trouvé le
prix trop /hier. C’est donc aussi très-probablement par ordre du roi
très-chrétien, que son commissaire, monseigneur de Lautrec, donna
un commencement d’exécution aux travaux, en en chargeant un
sculpteur milanais, Agostino Busti, dit le Bambaja, — et autrement
Zarabaglia, Zarabaja, Zambaja, il Bustino, Agostino da Milano, Bambara,
— élève, selon Vasari, de Bernardino da Treviglio, et qui s’associa
plusieurs autres artistes lombards, tels que Gian-Giacomo di San-Gallo,
Giovanni Pietro di Bornago, Ambrogio da Bornago, Ambrogio Pomero,
Cristoforo Lombardo, Giovanni Antonio da Cremona, Agostino del Pozzo,
Ambrogio da Arluno, Giovanni da Osnago, Andrea da Saronno, Ambrogio
Dolcebuono, et d’autres encore; l’élite, comme on voit, des sculpteurs
milanais, à cette époque si fertile en excellents artistes2.
Il faut peut-être ajouter à cette pléiade Laurent de Mugiano, aussi
milanais, qui exécuta trois statues pour le château de Gaillon (1509).
Dans les comptes et les dépenses de ce manoir on lit, sous cette date, que
1. Nous connaissons une pièce rarissime et non mentionnée par le Manuel de
M. Brunet, de cette Entrée à Milan : « Copia del triûpho del Christianissimo Re di
Fràza // nel itrata facta de la îclita città di Milano cô tutta la sua // baronia con cl
nome de tutti li capitanei et côdutieri // Adi XII de octobrio M.CCCCC.XV. cô la
itrata che // fece nel Castello adi XIIII del dito mese. S. 1. n. d. (1515) ». Pet. in-4° de
2 ff. avec une vue de Milan gravée sur bois au premier feuillet. Cette plaquette est
vraiment précieuse, car elle donne le détail des costumes de la cour à la suite du roi.
2. Agostino Busti avait déjà travaillé à la Chartreuse de Pavie, en collaboration avec
d’autres artistes, tels que Antonio, Amadeo, Andrea Fusina, Marco d’Agrate, Cristoforo
Solari, dit il Gobboj Gio. Cristoforo llomano, Battista Gattoni, Antonio Tamagnini, les
Mantegazza, Benedetto Brioschi, et bien d’autres. Une illustration de la Chartreuse
de Pavie entreprise à l’aide des puissants moyens que nous possédons aujourd’hui,
photographie, photogravure, chromolithographie, etc., nous mettrait à même de
bien connaître l’état de la sculpture lombarde à cette époque. Ce splendide édifice,
commencé vers la fin du xive siècle, n’a en effet reçu que depuis 1 472 ses décorations
les plus remarquables, avec le concours de tous les grands artistes de l’école lom-
barde. Cette industrieuse colonie d’ouvriers de Lugano et de Como, qui depuis des
siècles répandue un peu partout, avait exercé les métiers de maçons et de tailleurs de
pierre, avait pu se perfectionner par un contact fréquent avec les sculpteurs toscans
venus en Lombardie, et surtout par les enseignements de l’Académie de Léonard, à la
fin du xvu siècle, qui s’étendaient à la sculpture comme à toutes les branches du
dessin.