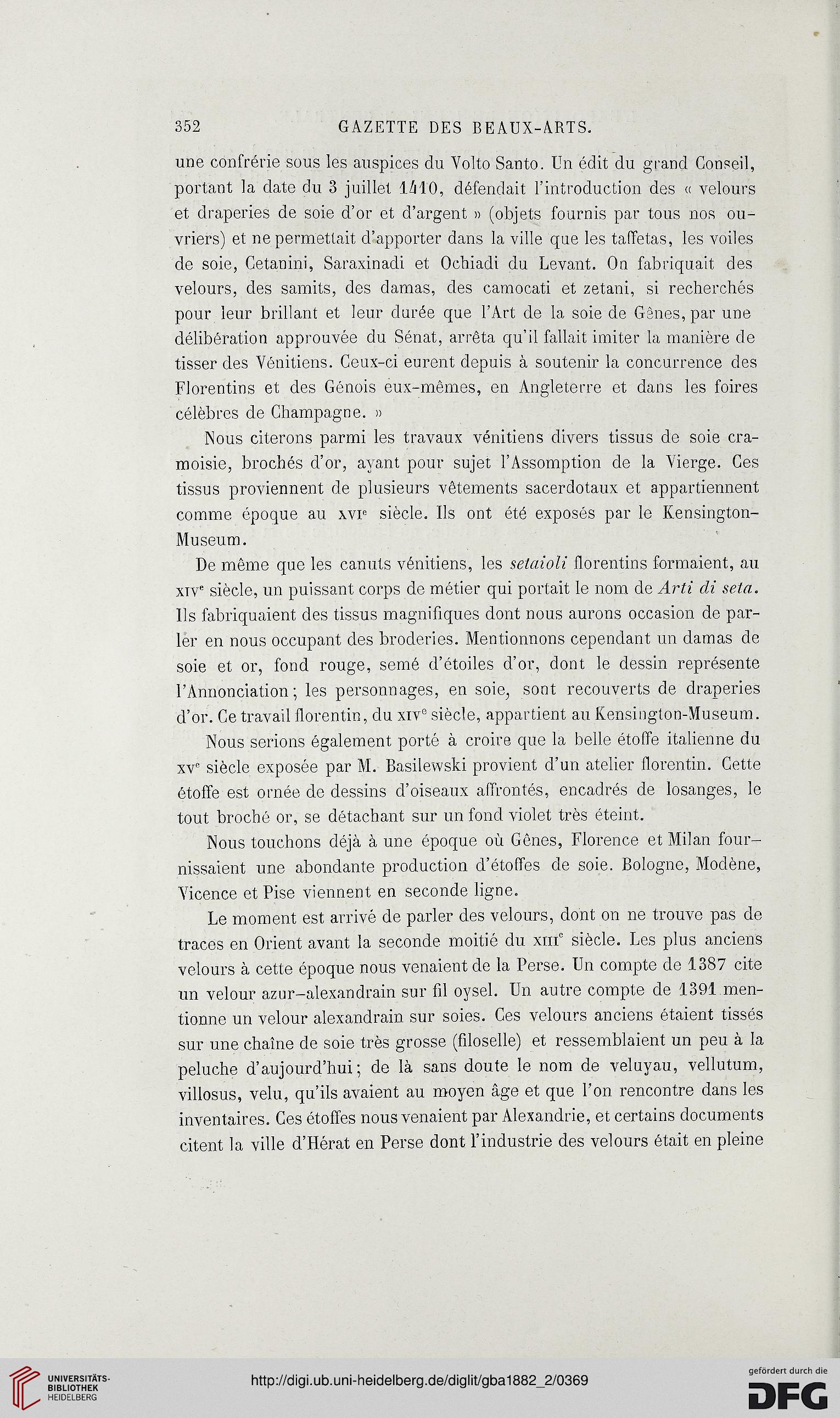352
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
une confrérie sous les auspices du Volto Santo. Un édit du grand Conseil,
portant la date du 3 juillet 1/rlO, défendait l’introduction des « velours
et draperies de soie d’or et d’argent » (objets fournis par tous nos ou-
vriers) et ne permettait d’apporter dans la ville que les taffetas, les voiles
de soie, Cetanini, Saraxinadi et Ochiadi du Levant. On fabriquait des
velours, des samits, des damas, des camocati et zetani, si recherchés
pour leur brillant et leur durée que l'Art de la soie de Gênes, par une
délibération approuvée du Sénat, arrêta qu’il fallait imiter la manière de
tisser des Vénitiens. Ceux-ci eurent depuis à soutenir la concurrence des
Florentins et des Génois eux-mêmes, en Angleterre et dans les foires
célèbres de Champagne. »
Nous citerons parmi les travaux vénitiens divers tissus de soie cra-
moisie, brochés d’or, ayant pour sujet l’Assomption de la Vierge. Ces
tissus proviennent de plusieurs vêtements sacerdotaux et appartiennent
comme époque au xvie siècle. Ils ont été exposés par le Kensington-
Museum.
De même que les canuts vénitiens, les setaioli florentins formaient, au
xtv6 siècle, un puissant corps de métier qui portait le nom de Arti di sein.
Ils fabriquaient des tissus magnifiques dont nous aurons occasion de par-
ler en nous occupant des broderies. Mentionnons cependant un damas de
soie et or, fond rouge, semé d’étoiles d’or, dont le dessin représente
l’Annonciation; les personnages, en soie, sont recouverts de draperies
d’or. Ce travail florentin, du xive siècle, appartient au Kensington-Museum.
Nous serions également porté à croire que la belle étoffe italienne du
xve siècle exposée par M. Basilewski provient d’un atelier florentin. Cette
étoffe est ornée de dessins d’oiseaux affrontés, encadrés de losanges, le
tout broché or, se détachant sur un fond violet très éteint.
Nous touchons déjà à une époque où Gênes, Florence et Milan four-
nissaient une abondante production d’étoffes de soie. Bologne, Modène,
Vicence et Pise viennent en seconde ligne.
Le moment est arrivé de parler des velours, dont on ne trouve pas de
traces en Orient avant la seconde moitié du xme siècle. Les plus anciens
velours à cette époque nous venaient de la Perse. Un compte de 1387 cite
un velour azur-alexandrain sur fil oysel. Un autre compte de 1391 men-
tionne un velour alexandrain sur soies. Ces velours anciens étaient tissés
sur une chaîne de soie très grosse (filoselle) et ressemblaient un peu à la
peluche d’aujourd’hui; de là sans doute le nom de veluyau, vellutum,
villosus, velu, qu’ils avaient au moyen âge et que l’on rencontre dans les
inventaires. Ces étoffes nous venaient par Alexandrie, et certains documents
citent la ville d’Hérat en Perse dont l’industrie des velours était en pleine
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
une confrérie sous les auspices du Volto Santo. Un édit du grand Conseil,
portant la date du 3 juillet 1/rlO, défendait l’introduction des « velours
et draperies de soie d’or et d’argent » (objets fournis par tous nos ou-
vriers) et ne permettait d’apporter dans la ville que les taffetas, les voiles
de soie, Cetanini, Saraxinadi et Ochiadi du Levant. On fabriquait des
velours, des samits, des damas, des camocati et zetani, si recherchés
pour leur brillant et leur durée que l'Art de la soie de Gênes, par une
délibération approuvée du Sénat, arrêta qu’il fallait imiter la manière de
tisser des Vénitiens. Ceux-ci eurent depuis à soutenir la concurrence des
Florentins et des Génois eux-mêmes, en Angleterre et dans les foires
célèbres de Champagne. »
Nous citerons parmi les travaux vénitiens divers tissus de soie cra-
moisie, brochés d’or, ayant pour sujet l’Assomption de la Vierge. Ces
tissus proviennent de plusieurs vêtements sacerdotaux et appartiennent
comme époque au xvie siècle. Ils ont été exposés par le Kensington-
Museum.
De même que les canuts vénitiens, les setaioli florentins formaient, au
xtv6 siècle, un puissant corps de métier qui portait le nom de Arti di sein.
Ils fabriquaient des tissus magnifiques dont nous aurons occasion de par-
ler en nous occupant des broderies. Mentionnons cependant un damas de
soie et or, fond rouge, semé d’étoiles d’or, dont le dessin représente
l’Annonciation; les personnages, en soie, sont recouverts de draperies
d’or. Ce travail florentin, du xive siècle, appartient au Kensington-Museum.
Nous serions également porté à croire que la belle étoffe italienne du
xve siècle exposée par M. Basilewski provient d’un atelier florentin. Cette
étoffe est ornée de dessins d’oiseaux affrontés, encadrés de losanges, le
tout broché or, se détachant sur un fond violet très éteint.
Nous touchons déjà à une époque où Gênes, Florence et Milan four-
nissaient une abondante production d’étoffes de soie. Bologne, Modène,
Vicence et Pise viennent en seconde ligne.
Le moment est arrivé de parler des velours, dont on ne trouve pas de
traces en Orient avant la seconde moitié du xme siècle. Les plus anciens
velours à cette époque nous venaient de la Perse. Un compte de 1387 cite
un velour azur-alexandrain sur fil oysel. Un autre compte de 1391 men-
tionne un velour alexandrain sur soies. Ces velours anciens étaient tissés
sur une chaîne de soie très grosse (filoselle) et ressemblaient un peu à la
peluche d’aujourd’hui; de là sans doute le nom de veluyau, vellutum,
villosus, velu, qu’ils avaient au moyen âge et que l’on rencontre dans les
inventaires. Ces étoffes nous venaient par Alexandrie, et certains documents
citent la ville d’Hérat en Perse dont l’industrie des velours était en pleine