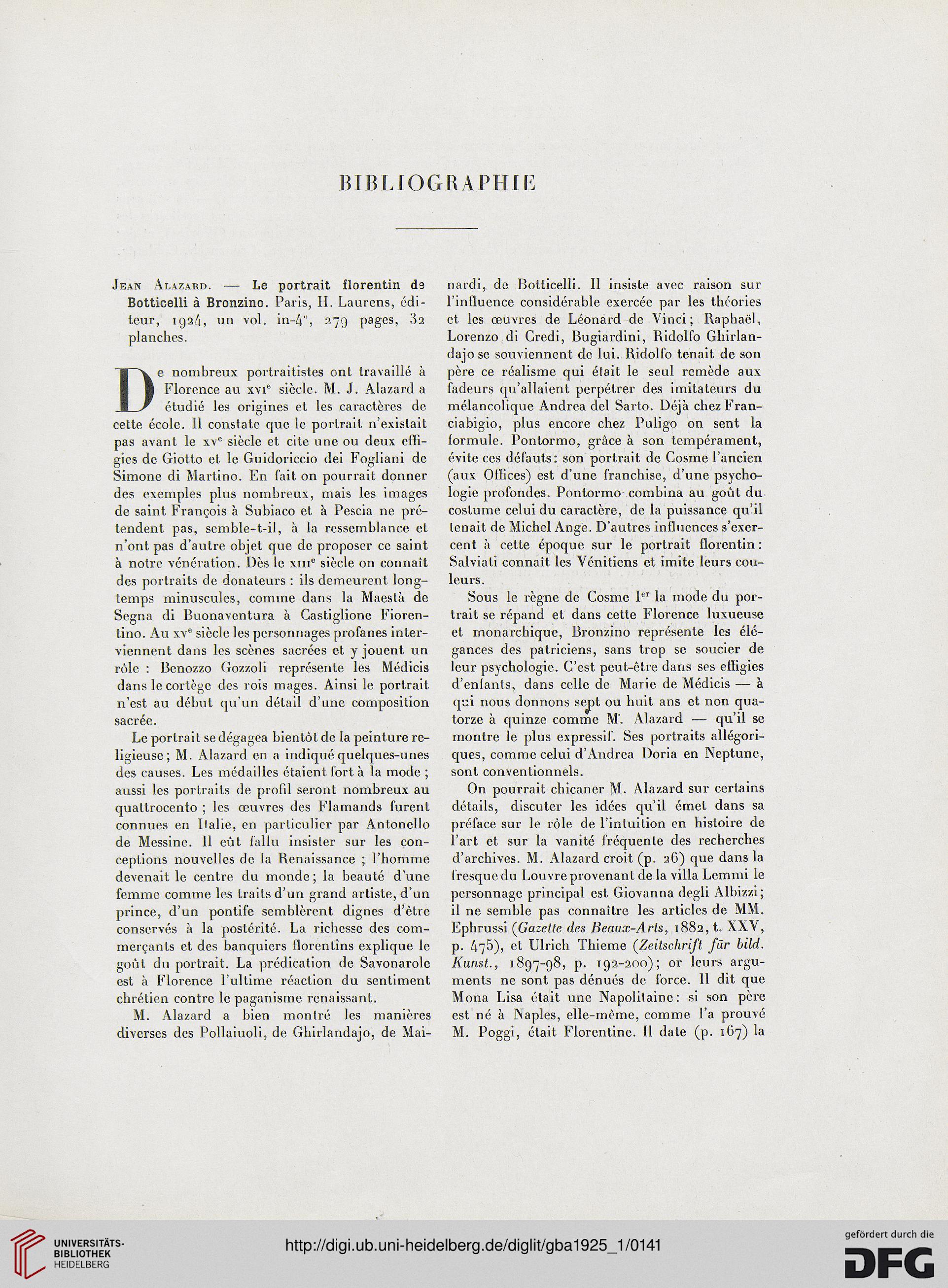BIBLIOGRAPHIE
Jean Alazard. — Le portrait florentin ds
Botticelli à Bronzino. Paris, H. Laurens, édi-
teur, 192/4, un vol. in-4", 279 pages, 32
planches.
De nombreux portraitistes ont travaillé à
Florence au xvi® siècle. M. J. Alazard a
étudié les origines et les caractères de
cette école. Il constate que le portrait n’existait
pas avant le xve siècle et cite une ou deux effi-
gies de Giotto et le Guidoriccio dei Fogliani de
Simone di Martino. En fait on pourrait donner
des exemples plus nombreux, mais les images
de saint François à Subiaco et à Pescia ne pré-
tendent pas, semble-t-il, à la ressemblance et
n’ont pas d’autre objet que de proposer ce saint
à notre vénération. Dès le xiii® siècle on connaît
des portraits de donateurs : ils demeurent long-
temps minuscules, comme dans la Maeslà de
Segna di Buonaventura à Gastiglione Fioren-
tino. Au xve siècle les personnages profanes inter-
viennent dans les scènes sacrées et y jouent un
rôle : Benozzo Gozzoli représente les Médicis
dans le cortège des rois mages. Ainsi le portrait
n’est au début qu’un détail d’une composition
sacrée.
Le portrait se dégagea bientôt de la peinture re-
ligieuse; M. Alazard en a indiqué quelques-unes
des causes. Les médailles étaient fort à la mode ;
aussi les portraits de profil seront nombreux au
quattrocento ; les œuvres des Flamands furent
connues en Italie, en particulier par Antonello
de Messine. 11 eût fallu insister sur les con-
ceptions nouvelles de la Renaissance ; l’homme
devenait le centre du monde ; la beauté d'une
femme comme les traits d’un grand artiste, d’un
prince, d’un pontife semblèrent dignes d’ètre
conservés à la postérité. La richesse des com-
merçants et des banquiers florentins explique le
goût du portrait. La prédication de Savonarole
est à Florence l’ultime réaction du sentiment
chrétien contre le paganisme renaissant.
M. Alazard a bien montré les manières
diverses des Pollaiuoli, de Ghirlandajo, de Mai-
nardi, de Botticelli. Il insiste avec raison sur
l’influence considérable exercée par les théories
et les œuvres de Léonard de Vinci; Raphaël,
Lorenzo di Credi, Bugiardini, Ridolfo Ghirlan-
dajo se souviennent de lui. Ridolfo tenait de son
père ce réalisme qui était le seul remède aux
fadeurs qu’allaient perpétrer des imitateurs du
mélancolique Andrea del Sarto. Déjà chezFran-
ciabigio, plus encore chez Puligo on sent la
formule. Pontormo, grâce à son tempérament,
évite ces défauts: son portrait de Cosme 1 ancien
(aux Offices) est d’une franchise, d’une psycho-
logie profondes. Pontormo combina au goût du
costume celui du caractère, de la puissance qu’il
tenait de Michel Ange. D’autres influences s’exer-
cent à cette époque sur le portrait florentin:
Salviali connaît les Vénitiens et imite leurs cou-
leurs.
Sous le règne de Cosme Ier la mode du por-
trait se répand et dans cette Florence luxueuse
et monarchique, Bronzino représente les élé-
gances des patriciens, sans trop se soucier de
leur psychologie. C’est peut-être dans ses effigies
d’enfants, dans celle de Marie de Médicis — à
qui nous donnons sejat ou huit ans et non qua-
torze à quinze comme M'. Alazard — qu’il se
montre le plus expressif. Ses portraits allégori-
ques, comme celui d’Andrea Doria en Neptune,
sont conventionnels.
On pourrait chicaner M. Alazard sur certains
détails, discuter les idées qu’il émet dans sa
préface sur le rôle de l’intuition en histoire de
l’art et sur la vanité fréquente des recherches
d’archives. M. Alazard croit (p. 26) que dans la
f resque du Louvre provenant de la villa Lcmmi le
personnage principal est Giovanna degli Albizzi;
il ne semble pas connaître les articles de MM.
Ephrussi (Gazelle des Beaux-Arts, 1882, t. XXV,
p. 475), et Ulrich Thieme (Zeitschrift für bild.
Kunst., 1897-98, p. 192-200); or leurs argu-
ments ne sont pas dénués de force. 11 dit que
Mona Lisa était une Napolitaine: si son père
est né à Naples, elle-même, comme l’a prouvé
M. Poggi, était Florentine. Il date (p. 167) la
Jean Alazard. — Le portrait florentin ds
Botticelli à Bronzino. Paris, H. Laurens, édi-
teur, 192/4, un vol. in-4", 279 pages, 32
planches.
De nombreux portraitistes ont travaillé à
Florence au xvi® siècle. M. J. Alazard a
étudié les origines et les caractères de
cette école. Il constate que le portrait n’existait
pas avant le xve siècle et cite une ou deux effi-
gies de Giotto et le Guidoriccio dei Fogliani de
Simone di Martino. En fait on pourrait donner
des exemples plus nombreux, mais les images
de saint François à Subiaco et à Pescia ne pré-
tendent pas, semble-t-il, à la ressemblance et
n’ont pas d’autre objet que de proposer ce saint
à notre vénération. Dès le xiii® siècle on connaît
des portraits de donateurs : ils demeurent long-
temps minuscules, comme dans la Maeslà de
Segna di Buonaventura à Gastiglione Fioren-
tino. Au xve siècle les personnages profanes inter-
viennent dans les scènes sacrées et y jouent un
rôle : Benozzo Gozzoli représente les Médicis
dans le cortège des rois mages. Ainsi le portrait
n’est au début qu’un détail d’une composition
sacrée.
Le portrait se dégagea bientôt de la peinture re-
ligieuse; M. Alazard en a indiqué quelques-unes
des causes. Les médailles étaient fort à la mode ;
aussi les portraits de profil seront nombreux au
quattrocento ; les œuvres des Flamands furent
connues en Italie, en particulier par Antonello
de Messine. 11 eût fallu insister sur les con-
ceptions nouvelles de la Renaissance ; l’homme
devenait le centre du monde ; la beauté d'une
femme comme les traits d’un grand artiste, d’un
prince, d’un pontife semblèrent dignes d’ètre
conservés à la postérité. La richesse des com-
merçants et des banquiers florentins explique le
goût du portrait. La prédication de Savonarole
est à Florence l’ultime réaction du sentiment
chrétien contre le paganisme renaissant.
M. Alazard a bien montré les manières
diverses des Pollaiuoli, de Ghirlandajo, de Mai-
nardi, de Botticelli. Il insiste avec raison sur
l’influence considérable exercée par les théories
et les œuvres de Léonard de Vinci; Raphaël,
Lorenzo di Credi, Bugiardini, Ridolfo Ghirlan-
dajo se souviennent de lui. Ridolfo tenait de son
père ce réalisme qui était le seul remède aux
fadeurs qu’allaient perpétrer des imitateurs du
mélancolique Andrea del Sarto. Déjà chezFran-
ciabigio, plus encore chez Puligo on sent la
formule. Pontormo, grâce à son tempérament,
évite ces défauts: son portrait de Cosme 1 ancien
(aux Offices) est d’une franchise, d’une psycho-
logie profondes. Pontormo combina au goût du
costume celui du caractère, de la puissance qu’il
tenait de Michel Ange. D’autres influences s’exer-
cent à cette époque sur le portrait florentin:
Salviali connaît les Vénitiens et imite leurs cou-
leurs.
Sous le règne de Cosme Ier la mode du por-
trait se répand et dans cette Florence luxueuse
et monarchique, Bronzino représente les élé-
gances des patriciens, sans trop se soucier de
leur psychologie. C’est peut-être dans ses effigies
d’enfants, dans celle de Marie de Médicis — à
qui nous donnons sejat ou huit ans et non qua-
torze à quinze comme M'. Alazard — qu’il se
montre le plus expressif. Ses portraits allégori-
ques, comme celui d’Andrea Doria en Neptune,
sont conventionnels.
On pourrait chicaner M. Alazard sur certains
détails, discuter les idées qu’il émet dans sa
préface sur le rôle de l’intuition en histoire de
l’art et sur la vanité fréquente des recherches
d’archives. M. Alazard croit (p. 26) que dans la
f resque du Louvre provenant de la villa Lcmmi le
personnage principal est Giovanna degli Albizzi;
il ne semble pas connaître les articles de MM.
Ephrussi (Gazelle des Beaux-Arts, 1882, t. XXV,
p. 475), et Ulrich Thieme (Zeitschrift für bild.
Kunst., 1897-98, p. 192-200); or leurs argu-
ments ne sont pas dénués de force. 11 dit que
Mona Lisa était une Napolitaine: si son père
est né à Naples, elle-même, comme l’a prouvé
M. Poggi, était Florentine. Il date (p. 167) la